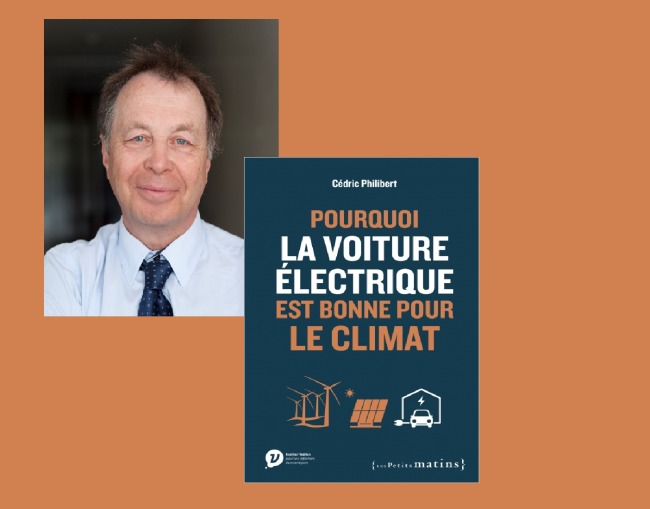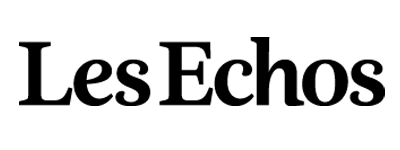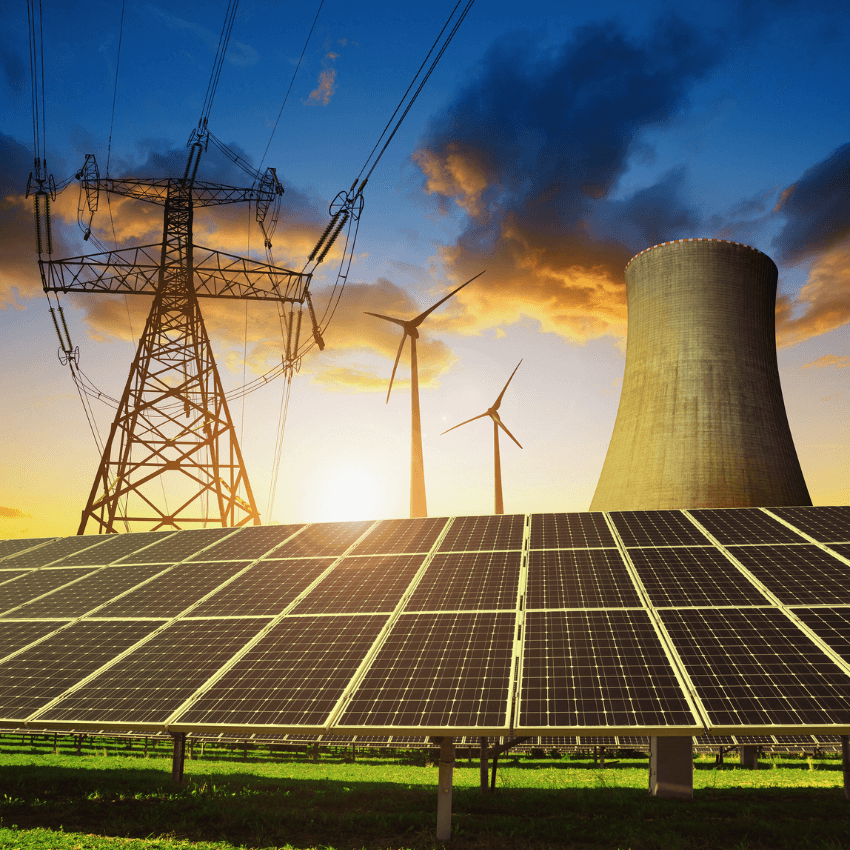Énergie - Climat
Face à l’urgence climatique et aux confrontations géopolitiques, comment concilier sécurité d’approvisionnement, compétitivité, accessibilité, décarbonation et acceptabilité ? Quelles politiques pour y répondre ?
Sujets liés

Canada : le grand réveil ?

Le modèle économique canadien – voire le modèle canadien plus largement –, est traversé depuis sa création en 1867 de tensions inhérentes qui semblent avoir empêché, jusqu’à aujourd’hui, la réalisation de son plein potentiel. Chef du Service économique régional (SER) de l’ambassade de France à Ottawa, Morgan Larhant en dénombre cinq, liées aux matières premières, à la proximité des États-Unis, au manque d’intégration entre les 13 provinces et territoires, au fonctionnement du système fédéral, et à l’importance de l’immigration, comme source de son développement.
COP29 : le climat se négocie à Bakou
La COP29 qui s'est ouverte hier à Bakou en Azerbaïdjan ne sera pas, ou probablement pas, une grande COP. L'économie de son pays hôte dépend largement des hydrocarbures. La question du financement de la transition écologique va se poser sérieusement alors que l'Europe doit financer davantage sa propre défense. La Chine ne souhaite pas mettre la main à la pâte alors que le pays n'est plus "en développement". L'élection récente de Donald Trump ne donne aucun signe en faveur du climat de la part de la première économie mondiale. Un dernier obstacle dont on parle encore trop peu : tous les pays comptent sur des technologies de décarbonation qui ne sont pas encore abouties.
Élection de Trump: "Pour les COP climat, il faut envisager un retrait américain"
Le retour de Donald Trump à la Maison Blanche apparaît comme la pire des nouvelles pour la lutte contre le dérèglement climatique. Connu pour sa défense des énergies fossiles, ou son retrait de l’accord de Paris, jusqu’où le futur président américain peut-il remettre en cause des efforts… déjà insuffisants ?
Le Centre énergie et climat de l’Ifri (Institut français des relations internationales) mène des recherches sur l’enjeu géopolitique des transitions énergétiques. Marc-Antoine Eyl-Mazzega en est le directeur. Docteur de l'institut d'études politiques de Paris, il a travaillé six ans à l'Agence Internationale de l'énergie (AIE)


États-Unis : le pays de l’oncle Sam est-il toujours une superpuissance énergétique ?
En quelques années, les États-Unis sont devenus le premier producteur mondial d’hydrocarbures et les élections ne devraient rien y changer. Il y a un consensus dans le pays pour que l’énergie reste bon marché et l’abondance du gaz et du pétrole donne un avantage compétitif énorme aux entreprises américaines.


Mines de charbon, plus grande éolienne du monde : où en est la Chine de sa « transition » écologique ?
Alors que va bientôt s’ouvrir la COP29 à Bakou, en Azerbaïdjan, le chercheur Thibaud Voïta fait le point sur la trajectoire énergétique chinoise, à laquelle le monde est suspendu.

Les crédits carbone, une fausse bonne idée ?
À dix jours de la COP29 à Bakou en Azerbaïdjan, la délicate question des crédits carbone fait de nouveau parler d'elle. Cet outil permet notamment à des pays, des entreprises ou à des particuliers de compenser leurs émissions de gaz à effet de serre en finançant des projets qui visent à les réduire ailleurs dans le monde.
Turquie 2050 : Charbon ; Proche-Orient ; santé mentale
Repères sur la Turquie n° 24 - Le programme « Turquie 2050 » développe une analyse prospective sur les thèmes de la diplomatie, de la politique intérieure et de l’économie turques afin d’y anticiper les dynamiques des trente prochaines années.
Les marchés du carbone peuvent-ils faire une percée à la COP29 ?
Les marchés volontaires du carbone (MVC) ont un potentiel élevé, notamment pour réduire le déficit de financement de la lutte contre le changement climatique, en particulier en Afrique.
Le dérèglement climatique dans la campagne présidentielle aux Etats-Unis : quelles seraient les conséquences en cas de victoire de Donald Trump ou de Kamala Harris
Comment expliquer que le climat n’a pas été un thème majeur de la campagne ? Marc-Antoine Eyl-Mazzega, directeur du Centre énergie et climat de l’Institut français des relations internationales (IFRI), est l’invité de ce direct pour répondre à toutes vos interrogations.
L’approvisionnement énergétique de Taïwan : talon d’Achille de la sécurité nationale
Faire de Taïwan une « île morte » à travers « un blocus » et une « rupture de l’approvisionnement énergétique » qui mènerait à un « effondrement économique ». C’est ainsi que le colonel de l’Armée populaire de libération et professeur à l’université de défense nationale de Pékin, Zhang Chi, décrivait en mai 2024 l’objectif des exercices militaires chinois organisés au lendemain de l’investiture du nouveau président taïwanais Lai Ching-te. Comme lors des exercices ayant suivi la visite de Nancy Pelosi à Taipei en août 2022, la Chine avait défini des zones d’exercice faisant face aux principaux ports taïwanais, simulant de fait un embargo militaire de Taïwan. Ces manœuvres illustrent la pression grandissante de Pékin envers l’archipel qu’elle entend conquérir et poussent Taïwan à interroger sa capacité de résilience.
Les renouvelables peuvent-elles supplanter les énergies fossiles ?
Les sources d’énergie à faibles émissions devraient produire plus de la moitié de l'électricité mondiale avant 2030.
L'industrie solaire photovoltaïque européenne : ultime déclin ou espoir de renaissance ?
Alors que les installations solaires photovoltaïques sont en plein essor en Europe (et dans d'autres parties du monde), les industries locales mettent la clé sous la porte. Au cours des deux dernières années, la capacité solaire photovoltaïque installée en Europe a été multipliée par deux. De l’autre côté, les derniers fabricants européens de panneaux solaires photovoltaïques sont en train de disparaître.
Global Gateway : vers une stratégie européenne extérieure en matière de sécurité climatique ?
Les infrastructures liées au transport, à l’énergie, à l’eau et aux télécommunications sont essentielles au développement économique. Ces infrastructures sont également fondamentales pour remplir les objectifs de développement durable prévus pour 2030, lesquels ont récemment connu des revers avec la pandémie de Covid-19, les guerres et les performances économiques en berne.
Pourquoi la voiture électrique est bonne pour le climat
Dans cet ouvrage publié en partenariat avec l'Institut Veblen pour les réformes économiques, Cédric Philibert examine et bat en brèche les nombreuses critiques adressées aux véhicules électriques.
La diplomatie climatique allemande. La recherche d’un équilibre entre développement durable et sécurité énergétique
Avec la guerre en Ukraine, la coalition feu tricolore a dû adapter sa politique climatique aux bouleversements que cette guerre entraîne pour son modèle économique, énergétique et militaire. Dans un contexte de coûts élevés de l’énergie et à l’heure où les appels à la relocalisation (« reshoring ») en Europe se font entendre de plus en plus, l’industrie allemande s’interroge sur la façon de préserver sa compétitivité tout en décarbonant son industrie.
Véhicules électriques : Une performance solide et pourtant sous-estimée
Les véhicules électriques (VE) sont plus bénéfiques pour le climat, même dans les scénarios les plus défavorables. Tout au long de leur cycle de vie, une voiture électrique européenne typique émet moins de gaz à effet de serre (GES) et de polluants atmosphériques ou sonores que son équivalent à essence ou diesel. Bien que les émissions soient généralement plus élevées lors de la phase de production, celles-ci sont largement compensées au fil du temps par des émissions plus faibles lors de la phase d'utilisation. Selon le rapport de l'Agence européenne pour l'environnement sur les VE, les émissions de GES sur l'ensemble du cycle de vie des VE sont environ 17 à 30 % inférieures à celles des voitures essence et diesel.
Minerais critiques : une diversification problématique
Devant l'explosion de la demande en ressources métalliques générée par les technologies de pointe, les États-Unis et l'Europe sont contraints de réviser une géographie des approvisionnements synonyme de dépendance stratégique.

Le Sud contre l’Occident ?
2023 a vu se multiplier les forums amplifiant, de plus en plus, la voix d’un « Sud global ». Pour contradictoires et divisés qu’ils soient, ces forums (Brics+, OCS, G20, groupe des 77, sommet des Nouvelles routes de la soie…) expriment de nouveaux rapports de force, et surtout de nouvelles diplomaties, refusant l’alignement sur les puissances hier dominantes et privilégiant les intérêts d’États. Un nouveau monde se dessine, aux contours mouvants, encore incertains.
L’impératif de sécurité économique requiert mobilisation et planification
Ursula von der Leyen appelait de ses vœux en 2019 l’avènement d’une Commission européenne géopolitique. C’était indispensable alors que l’Union européenne (UE) était en voie de périphérisation dans un monde dont l’épicentre a basculé en Asie et structuré par la rivalité sino-américaine. Encore fallait-il que les États membres soutiennent cette transformation, et que la Commission en ait les moyens politiques, institutionnels, juridiques.
Après le boom de l’éolien offshore en Europe : quelles conditions pour un redémarrage ?
La filière de l’éolien en mer connaît aujourd’hui, comme bien d’autres, des difficultés majeures consécutives à la double crise du Covid-19 et de la guerre en Ukraine, sur le fond des tensions sur les chaînes d’approvisionnement et des difficultés des fournisseurs d’équipements, des pressions inflationnistes, mais également des éléments plus techniques comme le design des appels d’offre par les gouvernements et l’importance des critères non-relatifs aux prix.
La relance du nucléaire dans le monde. Préface de Marc-Antoine Eyl-Mazzega
Face au retour brutal de la géopolitique, une stratégie industrielle est indispensable. Sécurité d’approvisionnement, souveraineté économique, décarbonation… À l’heure où le mythe de la globalisation heureuse est derrière nous et où la transition devient douloureuse, l’Europe doit faire face à tous ces défis alors qu’elle n’y est guère préparée. Elle doit s’appuyer sur ses atouts existants, dont le nucléaire, première source d’électricité bas carbone du continent, dans le cadre d’une véritable politique industrielle.
L’Ukraine ferme les robinets du pétrole et du gaz russes, provoquant la colère de la Hongrie et de la Slovaquie
Le pétrole du géant russe Lukoil ne transite plus par le territoire ukrainien, en application de sanctions prises par Kiev. La Hongrie et la Slovaquie, les deux principaux destinataires, demandent à l’UE d’intervenir.
Énergie, climat et développement : quel visage pour l’Afrique en 2030 ?
La tension entre l’exigence de lutter contre le réchauffement climatique et la nécessité d’assurer le développement économique juste du continent était au cœur des débats, le 31 mai à l’Institut français des relations internationales (Ifri), lors d’une conférence qui a réuni acteurs économiques, décideurs politiques et chercheurs.
Voitures électriques : l'enfer environnemental de l'extraction de nickel en Indonésie
Déforestation, lessivage des sols, asphyxie des océans, utilisation intensive de charbon… L'extraction de nickel en Indonésie génère des impacts colossaux sur l'environnement. L'archipel est devenu le premier producteur au monde de ce métal en quelques années.


Le RN peut-il vraiment empêcher les éoliennes de tourner ?
Le parti d’extrême droite compte démonter ces infrastructures cruciales pour la transition énergétique du pays. Les experts interrogés par «Libération» mettent en garde contre une mesure climaticide, ruineuse et qui pourrait même plonger la France dans le noir.
Quel équilibre entre développement durable et sécurité énergétique ?
Pour combattre le changement climatique et trouver de nouvelles formes de coopération énergétique plus durable pour la planète, le gouvernement fédéral a mis en place une stratégie de diplomatie climatique qui regroupe ses actions de collaboration avec les pays partenaires.


Le nickel, un minerai essentiel au coeur de la crise en Nouvelle-Calédonie
La Nouvelle-Calédonie possède l'une des plus grandes réserves mondiales de nickel et en a fait un pilier de son économie. La chute du cours mondial de ce minerai a fait le lit de la crise que traverse actuellement l'archipel, alors que l'exploitation de cette ressource est au coeur de son processus de décolonisation.
Deux ans de guerre en Ukraine: comment la Russie parvient à maintenir ses recettes issues des hydrocarbures
Malgré les multiples embargos mis en place par les puissances occidentales depuis deux ans, Moscou a trouvé plusieurs relais afin de continuer à exploiter ses ressources énergétiques... pour l'instant.


Les besoins de métaux critiques liés à la transition vers la mobilité électrique
La transition écologique et les objectifs de neutralité climatique ont rendu incontournable l’évolution vers la mobilité électrique — via notamment l’abandon programmé de la vente des véhicules thermiques neufs d’ici 2035 en Europe. Toutefois, deux études récentes soulignent l’impact du basculement vers un parc automobile tout-électrique sur la demande de métaux critiques — des matériaux pour lesquels la France comme l’Europe dépendent largement d’approvisionnements étrangers (principalement chinois). Elles présentent toutes les deux divers scénarios d’évolution de cette demande de métaux critiques, et leurs conclusions convergent : on ne pourra pas réussir une transition soutenable vers la mobilité électrique sans un accroissement de la sobriété, qu’il s’agisse de la taille des véhicules, de la puissance des batteries, de l’intensité d’utilisation des véhicules…


Aux États-Unis, les projets de terminaux de GNL foisonnent
En 2024, les capacités d’export de gaz naturel liquéfié (GNL) des États-Unis vont de nouveau augmenter. Une vague de projets d’infrastructures devrait commencer à se concrétiser en fin d’année.


L’hydrogène vert dans les pays du Sud, un nouveau colonialisme ?
Poussés par les pays du Nord pour lutter contre le changement climatique et répondre à la nécessité de décarboner les économies, les projets de production localisés dans les pays du Sud font l’objet de vives critiques.
Laurent Fabius - Après la COP23, quelles perspectives pour l'environnement ?
Entretien vidéo mené par l'Ifri, dans le cadre d'un dîner-débat autour de Laurent Fabius (président du Conseil constitutionnel), présidé par Thierry de Montbrial (fondateur et président de l'Ifri), le 23 novembre 2017 au Cercle de l'Union interalliée (Paris).
Quelle place pour l'énergie nucléaire aux Etats-Unis ?
Entretien avec le Directeur Général de l'agence de l'OCDE pour l'énergie nucléaire, William MAGWOOD.
RTE et la transformation du système électrique européen - Vincent THOUVENIN
Vincent Thouvenin, Director for European Affairs of RTE, explains the role and challenges faced by transmission system operators in the energy transition at the 2030 horizon, and how the Clean Energy Package will accompany the transformation of our electricity systems.
La transformation du système électrique français à l’horizon 2030 - Mario PAIN
L'Ifri a interrogé Mario PAIN, directeur adjoint à l'énergie au Ministère de la transition écologique et solidaire, en marge de la conférence du Centre Energie du 4 juillet à Bruxelles autour de deux questions :
- Quels sont les principaux défis du système électrique français à l’horizon 2030 ?
- Quel est le bon niveau d’harmonisation européenne pour conduire la transition énergétique à moindre coût ?
Video - De la COP21 à la COP22 : comment gagner le combat climatique ?
3 questions à Carole MATHIEU, auteur de la note : De la COP21 à la COP22 : comment gagner le combat climatique ? Octobre 2016
Innovation as a catalyst for Energy markets? An interview with Andris Piebalgs
What are the key technology areas that can make the difference to achieve our decarbonization targets ?
An interview with Andris Piebalgs, former EU Commissioner for Energy and member of the Global Agenda Council on Decarbonizing Energy.
Innovation as a Catalyst for Energy Markets? Interview with Andris Piebalgs
Innovation as a Catalyst for Energy Markets? Special Address by Andris Piebalgs, Senior Fellow Florence School of Regulation, Member of the Global Agenda Council on Decarbonizing Energy, Former EU Commissioner for Energy, during an Ifri conference in Brussels on June 22nd 2016.
Le gaz au Nigeria : quelles leçons pour le Mozambique ?
Benjamin Augé, chercheur associé au Programme Afrique subsaharienne et au Centre Energie de l'Ifri, est intervenu sur le gaz au Nigeria et au Mozambique lors du séminaire "Politique et gestion des ressources naturelles: Dimensions africaines et asiatiques" organisé par l'Ifri et l'OCP Policy Center le 13 novembre 2015 à Rabat.
La Chine à la quête d'une sécurisation des ressources naturelles
John Seaman, chercheur au Centre Asie de l'Ifri, est intervenu sur l'approvisionnement de la Chine en matières pemières lors du séminaire "Politique et gestion des ressources naturelles: Dimensions africaines et asiatiques" organisé par l'Ifri et l'OCP Policy Center le 13 novembre 2015 à Rabat.
Les politiques indiennes dans le secteur des phosphates et des engrais
Isabelle Saint-Mézard, chercheur associé au Centre Asie de l'Ifri, est intervenue sur le secteur des phosphates et des engrais en Inde lors du séminaire "Politique et gestion des ressources naturelles: Dimensions africaines et asiatiques" organisé par l'Ifri et l'OCP Policy Center le 13 novembre 2015 à Rabat.
RAMSES 2016 : S'adapter aux effets du réchauffement climatique. Interview de Marie-Claire Aoun
Marie-Claire Aoun, directeur du Centre Énergie de l'Ifri, commente les grands enjeux et les perspectives de la Conférence de Paris (COP21) de décembre 2015.
L'Indonésie: une puissance économique décevante?
Françoise Nicolas, directeur du Centre Asie de l'Ifri, est intervenue sur l'émergence économique de l'Indonésie lors de la 2e session du séminaire "Ifri-OCP Policy Center Roundtables" du 22 mai 2015 à Paris.
Nigeria, première puissance économique africaine en 2014
Jacques Manlay, conseiller du commerce extérieur de la France au Conseil français des investisseurs en Afrique, est intervenu sur l'émergence économique du Nigeria lors de la 2e session du séminaire "Ifri-OCP Policy Center Roundtables" du 22 mai 2015 à Paris.
Soutenez une recherche française indépendante
L'Ifri, fondation reconnue d'utilité publique, s'appuie en grande partie sur des donateurs privés – entreprises et particuliers – pour garantir sa pérennité et son indépendance intellectuelle. Par leur financement, les donateurs contribuent à maintenir la position de l’Institut parmi les principaux think tanks mondiaux. En bénéficiant d’un réseau et d’un savoir-faire reconnus à l’international, les donateurs affinent leur compréhension du risque géopolitique et ses conséquences sur la politique et l’économie mondiales. En 2024, l’Ifri accompagne plus de 70 entreprises et organisations françaises et étrangères.