La politique de sécurité maritime du Gabon au prisme d’une stratégie intégrée
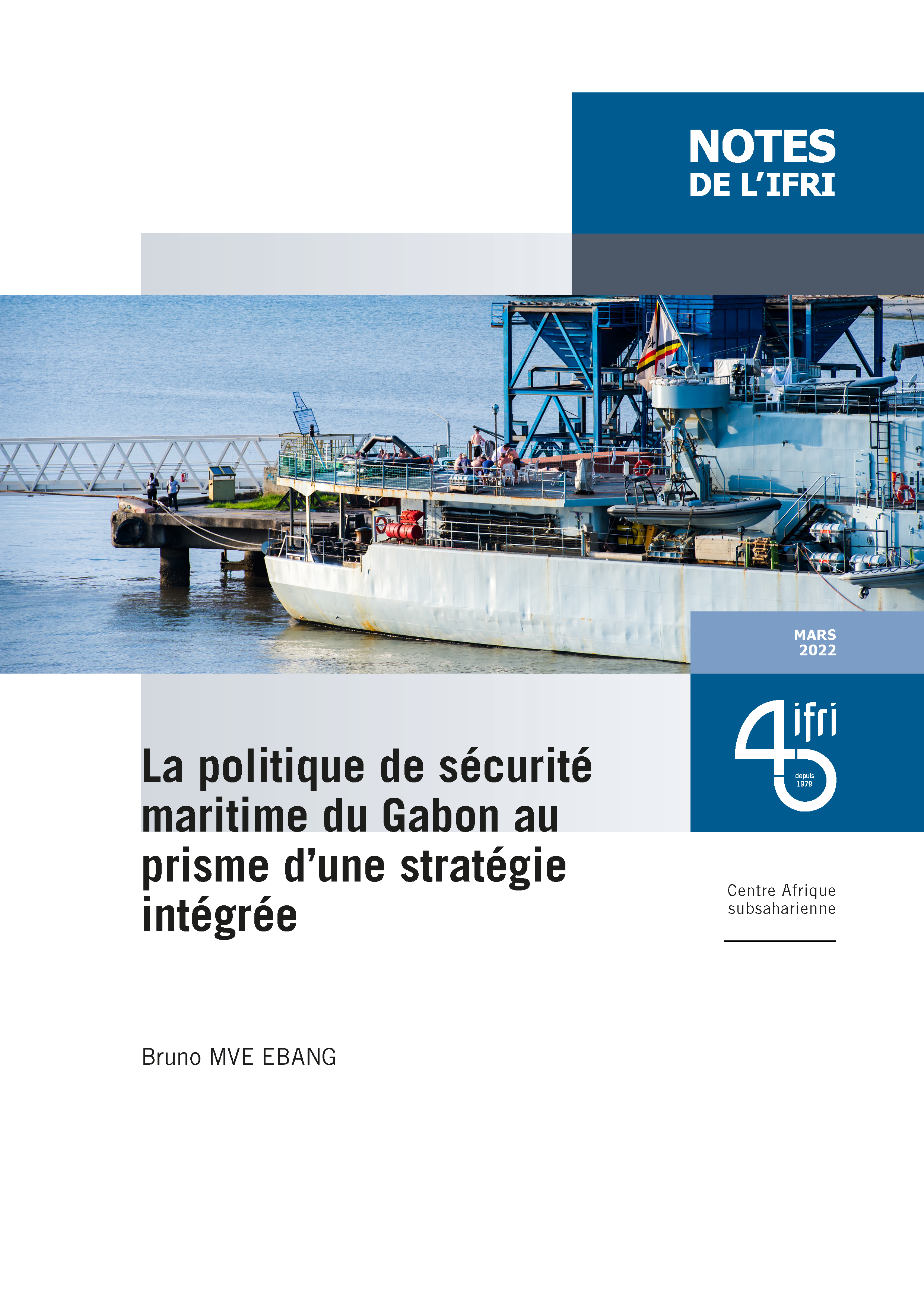
Entendue comme l’ensemble des activités cohérentes et coordonnées mis en œuvre par l’État afin d’assurer l’intégrité du territoire national, la politique de sécurité maritime revêt une importance majeure. Avec l’ambition de protéger sa biodiversité et de sécuriser ses richesses maritimes indispensables au développement du pays, la politique de sécurité maritime du Gabon oscille entre le militaire et le civil.

Le Gabon s’étend sur une superficie de 267 667 kilomètres carrés (km²), avec un littoral de 850 km de long, un plateau continental de 40 600 km² et une zone économique exclusive de 213 000 km. Riche d’importantes ressources offshore (pétrole, gaz, ressources halieutiques, etc.), son domaine maritime, quasi équivalent à ses terres, est confronté à des menaces et convoitises diverses (piraterie et brigandage, pêche illégale, immigration clandestine, litige frontalier, etc.).
La politique de sécurité maritime est une innovation récente au Gabon qui s’incarne dans la Stratégie maritime intégrée du Gabon (SMIG). La SMIG oscille entre intégrité territoriale, souveraineté nationale et développement économique. Cette politique récente fait suite à la montée en puissance des enjeux économiques et sécuritaires maritimes dans le Golfe de Guinée. Cette stratégie constitue une première réponse institutionnelle à ces enjeux et est fondée sur une coordination inter-administrative sous l’autorité du président. Néanmoins les défis de mise en œuvre de la SMIG sont nombreux.
La sécurité maritime au Gabon a fait l’objet d’une pluralité d’études. Sur la base d’une recherche qualitative faite de recherches documentaires et d’observations sur le terrain, cette note présente la politique de sécurité maritime du Gabon au regard du large éventail de menaces réelles et potentielles qui affectent les eaux gabonaises. Après avoir rappelé la dimension internationale dans laquelle s’inscrit la politique maritime gabonaise, cette note analyse sa dynamique interne et ses problèmes dans une perspective institutionnelle. La recherche, dans un domaine caractérisé par la difficulté d’accès aux sources, s’est aussi opérée par des entretiens semi-directifs et anonymes compte tenu de la sensibilité de la question.

Contenu disponible en :
Régions et thématiques
ISBN / ISSN
Utilisation
Comment citer cette publicationPartager
Téléchargez l'analyse complète
Cette page ne contient qu'un résumé de notre travail. Si vous souhaitez avoir accès à toutes les informations de notre recherche sur le sujet, vous pouvez télécharger la version complète au format PDF.
La politique de sécurité maritime du Gabon au prisme d’une stratégie intégrée
Centres et programmes liés
Découvrez nos autres centres et programmes de rechercheEn savoir plus
Découvrir toutes nos analysesNouvelle commission de l’Union africaine de Mahamoud Ali Youssouf. Le désenchantement des pays membres
La candidature de Raila Odinga, sans expérience diplomatique et tourné vers la politique nationale, affaiblit la crédibilité de l’institution. L’enseignement principal de cette élection est que l’Union africaine (UA), dans sa forme actuelle, ne véhicule plus le même enthousiasme que lors des premières années de la réforme initiée en 2018. Celle-ci avait notamment pour but de mettre en place une organisation plus efficace et d’atteindre une plus grande indépendance financière.
Éthiopie-Somalie : une paix sous patronage turc
Après une année de tensions dans la Corne de l’Afrique, 2024 s’est conclue par un apaisement diplomatique entre l’Éthiopie et la Somalie, ouvrant l’année 2025 sur des perspectives politiques régionales encourageantes.
Relations anglo-kényanes (1920-2024) : conflit, alliance et un arc rédempteur
Cet article propose une analyse des relations diplomatiques à l’ère postcoloniale entre le Royaume-Uni et l’une de ses anciennes colonies de peuplement, le Kenya.
La diplomatie, un outil pour aider les villes à gérer les risques géopolitiques
Les crises et la polarisation croissante des relations internationales font de l'analyse des risques politiques une ressource indispensable pour les entités publiques et privées actives au niveau international.











