L’engouement international pour les terres agricoles. Vers un nouveau front productif ?
Plus de dix ans après la parution des premiers rapports sur l’appropriation massive des terres par des entreprises transnationales dans des pays du Sud, les espaces de discussion autour de ce phénomène se sont multipliés.
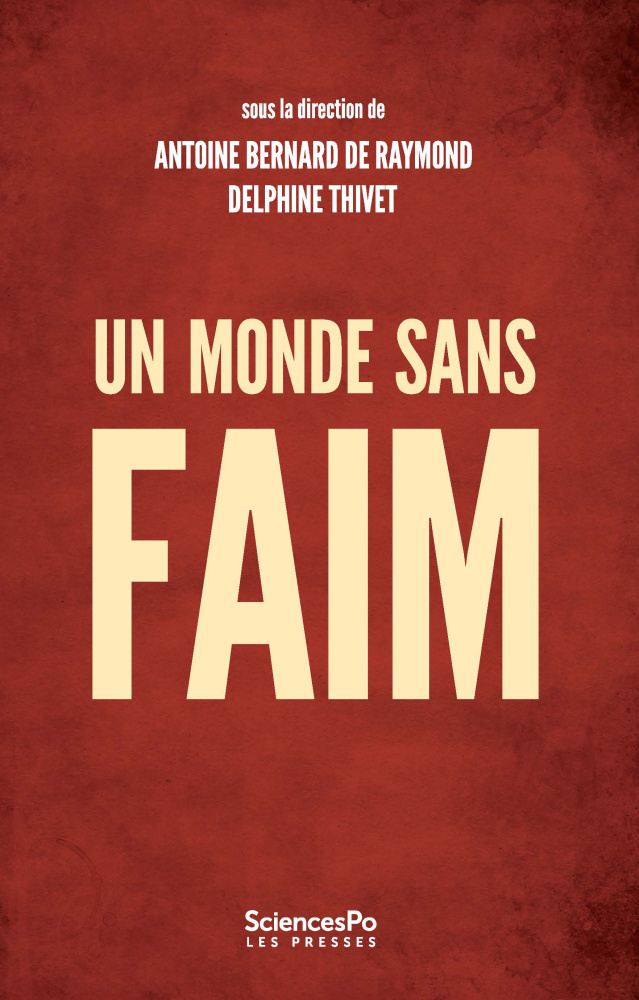
Les différents termes utilisés pour le définir reflètent l’hétérogénéité des acteurs qui participent à la construction du problème. Alors que l’expression « accaparement des terres » (land grabbing) est fortement promue par les acteurs de la société civile, les autorités publiques, les experts ou encore les entreprises qualifient le phénomène d’« investissements agricoles ». Les travaux scientifiques, quant à eux, proposent des notions plus neutres comme « transactions et acquisitions foncières » notamment dans un souci de déconstruction et d’analyse plus fine d’un objet de recherche en vogue.
L’envolée des transactions foncières à partir de la fin des années 2000 est généralement considérée comme un effet de la conjonction des crises globales financière, alimentaire, climatique et de sous-investissement dans l’agriculture.
La crise financière amorcée en 2007 entraîne une réorientation des placements financiers vers des investissements alternatifs au rang desquels les matières premières, et donc le foncier, ont pu constituer des valeurs refuge. L’engouement pour les terres est aussi encouragé par la diffusion d’une rhétorique productionniste, incitant à augmenter les disponibilités alimentaires au nom du « nourrir la planète » (chapitre 4). Dans un environnement exposé aux changements climatiques, où les ressources naturelles viennent à manquer et où la population augmente et diversifie sa consommation alimentaire, les terres présentées comme abondantes et sous-exploitées semblent dessiner la nouvelle frontière de la production alimentaire globale…
Sina Schlimmer est chercheuse au Centre Afrique subsaharienne.
Matthieu Brun est directeur scientifique de la fondation FARM
Ce chapitre d'ouvrage intitulé "L’engouement international pour les terres agricoles Vers un nouveau front productif ?" fait partie de l'ouvrage Un monde sans faim : gouverner la securité alimentaire codirigé par Antoine Bernard de Raymond et Delphine Thivet qui est paru en 2021 dans les Presses de Sciences Po.

Contenu disponible en :
Régions et thématiques
Utilisation
Comment citer cette publicationPartager
Centres et programmes liés
Découvrez nos autres centres et programmes de rechercheEn savoir plus
Découvrir toutes nos analysesNouvelle commission de l’Union africaine de Mahamoud Ali Youssouf. Le désenchantement des pays membres
La candidature de Raila Odinga, sans expérience diplomatique et tourné vers la politique nationale, affaiblit la crédibilité de l’institution. L’enseignement principal de cette élection est que l’Union africaine (UA), dans sa forme actuelle, ne véhicule plus le même enthousiasme que lors des premières années de la réforme initiée en 2018. Celle-ci avait notamment pour but de mettre en place une organisation plus efficace et d’atteindre une plus grande indépendance financière.
Éthiopie-Somalie : une paix sous patronage turc
Après une année de tensions dans la Corne de l’Afrique, 2024 s’est conclue par un apaisement diplomatique entre l’Éthiopie et la Somalie, ouvrant l’année 2025 sur des perspectives politiques régionales encourageantes.
Relations anglo-kényanes (1920-2024) : conflit, alliance et un arc rédempteur
Cet article propose une analyse des relations diplomatiques à l’ère postcoloniale entre le Royaume-Uni et l’une de ses anciennes colonies de peuplement, le Kenya.
La diplomatie, un outil pour aider les villes à gérer les risques géopolitiques
Les crises et la polarisation croissante des relations internationales font de l'analyse des risques politiques une ressource indispensable pour les entités publiques et privées actives au niveau international.













