Le changement de paradigme de la politique de sécurité et de défense de l’Allemagne après l’invasion russe de l’Ukraine
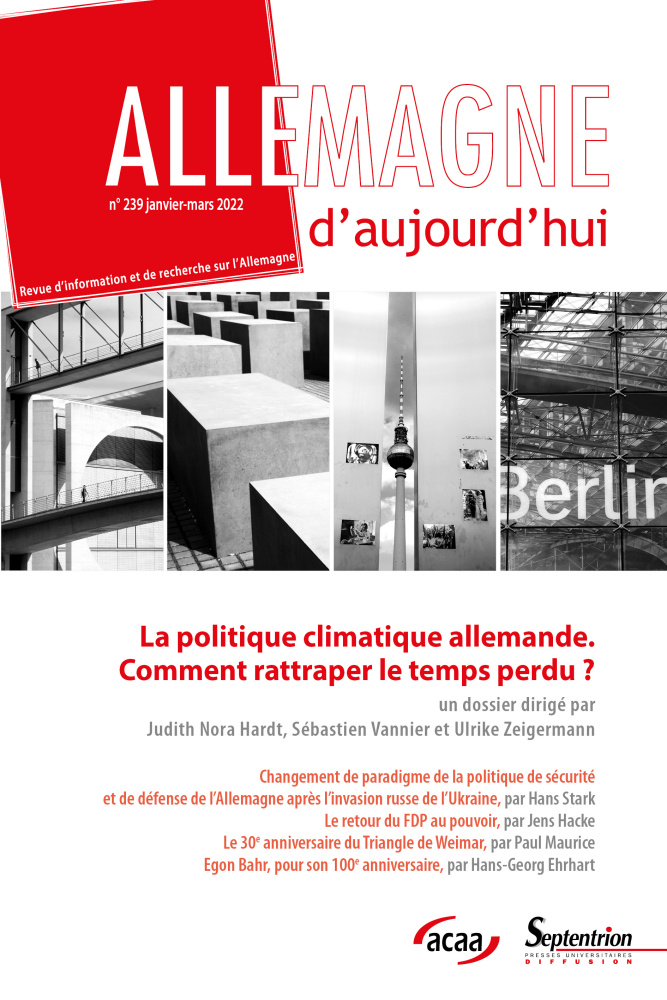
Le gouvernement allemand a longtemps hésité à prendre position face à la crise entre la Russie et l’Ukraine. Il a refusé de remettre en question le projet de mise en service de Nord Stream 2 et d’approvisionner l’Ukraine en armes.

Cette attitude était certainement motivée par la crainte d’une baisse sensible de l’approvisionnement d’énergie et d’une nouvelle hausse de l’inflation. En outre, Berlin ne voulait pas non plus mettre en péril le dialogue avec le Kremlin, dans l’espoir de ne pas compromettre les accords de Minsk de 2014 et 2015. Berlin ne s’attendait certainement pas non plus à une invasion de l’Ukraine par les troupes russes, en tout cas pas au-delà de la région du Donbass. L’invasion russe de l'Ukraine à partir du 24 février 2022 et le bombardement de villes ukrainiennes par l’armée russe dans le but de renverser le gouvernement ukrainien librement élu ont eu un impact massif sur le gouvernement fédéral. Un changement complet de paradigme a été amorcé à Berlin. Cela concerne l’aide militaire à l’Ukraine, la politique énergétique et surtout la politique de défense allemande. Les dépenses pour l’armée allemande vont augmenter massivement à partir de cette année. Le budget de la défense dépassera 2 % du produit intérieur brut. La politique étrangère et de sécurité allemande est entrée dans une nouvelle réalité et Berlin s’y adapte.
Hans Stark est Professeur de civilisation allemande à Sorbonne Université et conseiller pour les relations franco-allemandes à l’Institut français des relations internationales (Ifri).
Cet article est paru dans le numéro de la revue Allemagne d'aujourd'hui, n° 239, janvier-mars 2022 (pages 3 à 16), intitulé "La politique climatique allemande. Comment rattraper le temps perdu ?", co-dirigé par Judith Nora Hardt, Sébastien Vannier, Ulrike Zeigermann.

Contenu disponible en :
Régions et thématiques
ISBN / ISSN
Utilisation
Comment citer cette publicationPartager
Centres et programmes liés
Découvrez nos autres centres et programmes de rechercheEn savoir plus
Découvrir toutes nos analysesSous le feu des normes : comment encadrer sans désarmer la défense européenne ?
Face à la diversité et la complexité de l’environnement normatif, le secteur de la défense doit pouvoir faire valoir sa singularité militaire. Dépassant une approche par la seule simplification, qui a montré ses limites face au caractère incontournable des normes juridiques et techniques à l’international, un équilibre est nécessaire entre un « trop-plein normatif » et l’absence de normes.
La brigade franco-allemande et la relance de la défense européenne
Une chose est claire depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche : le projet d’unification européenne est menacé dans son existence même. À moins d’élaborer une politique de défense souveraine pour parer à la guerre en Ukraine et à l’affaiblissement des garanties de sécurité américaines, l’Union européenne verra se poursuivre l’érosion de sa dynamique de cohésion interne et de son attractivité externe.

Daech au pays des merveilles
Ce livre mêle fiction et non-fiction. Il invite à réfléchir, de manière originale, aux effets de polarisation engendrés par la multiplication des attaques terroristes. Il tire la sonnette d’alarme sur les fragilités de la France, exacerbées par les extrémistes de tous bords.
Une base industrielle de défense transatlantique ? Deux analyses contrastées
L'évolution du paysage de la coopération mondiale en matière de défense met la relation transatlantique au défi. Alors que les tensions géopolitiques augmentent et que l'environnement de menaces devient plus complexe, la capacité de l'Europe à assurer au mieux sa sécurité tout en maintenant sa relation avec les États-Unis est devenue primordiale. Ce Focus stratégique offre deux points de vue contrastés sur la dynamique des relations industrielles de défense entre les États-Unis et l'Europe, en soulignant les défis et les opportunités qui attendent les deux parties.













