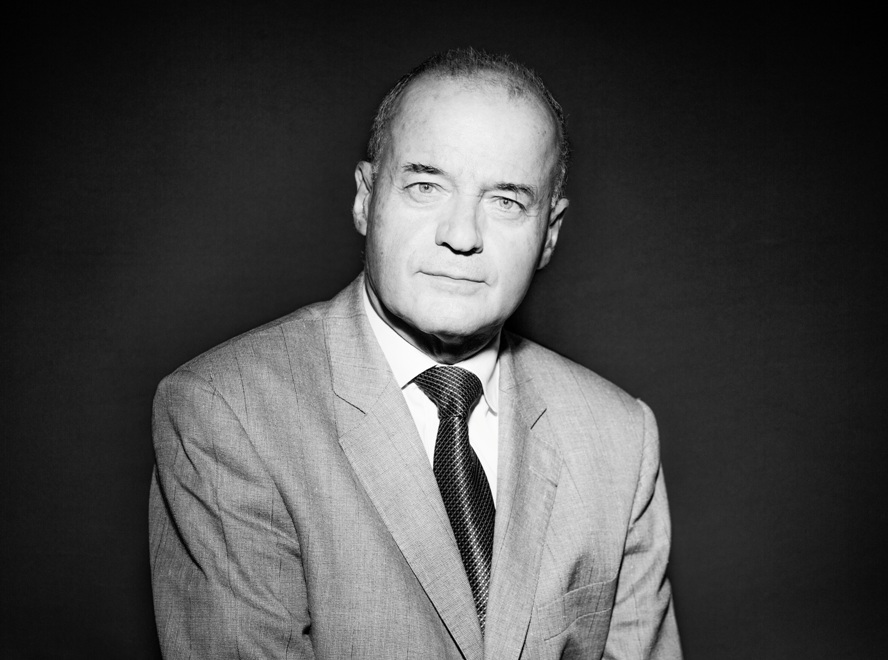Ukraine : la crise commence
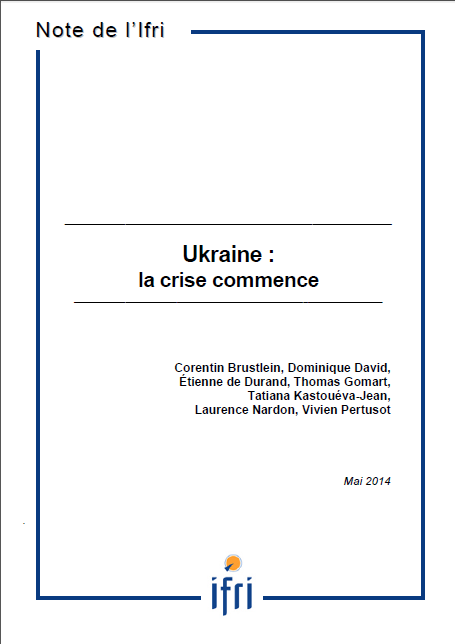
Sept chercheurs de l'Ifri dressent le meilleur panorama possible d'une crise qui annonce un véritable basculement. Il y aura un avant et un après. En Ukraine, en Russie, dans toute l’Europe, ailleurs.
Introduction par Dominique DAVID
La disparition de l’Ukraine comme entité souveraine – on en est plus près que jamais – serait un coup de tonnerre en Europe. Parce que l’espace qui lui survivrait serait très difficilement gérable, ouvrant le risque d’une longue guerre civile dans le style Balkans-années 1990. Et parce que la Russie est incapable de gérer seule cet espace où les Occidentaux n’ont guère l’envie de s’investir profondément.
Si l’Ukraine survit comme telle, ce que tout le monde devrait souhaiter y compris à Moscou, ce sera sans la Crimée, et dans un statut au moins provisoirement dominé, dans le meilleur des cas sous la tutelle d’un accord international l’aidant à se relever économiquement et redéfinissant sa position géopolitique (entre UE et Russie…) ; dans le plus mauvais, sous une tutelle directe de Moscou, qui ne pourrait être que contestée, et violemment, en interne.
La Russie poutinienne est-elle le monstre de rationalité, le champion d’échecs que s’effraient à décrire certains médias ? Voire… Les échecs ne sont pas toujours ceux qu’on pense : les difficultés s’annoncent grandioses pour Moscou. Contre le gain de la Crimée et la garantie (enfin !) que Kiev n’intégrera pas l’Organisation du traité de l’Atlantique nord (OTAN), le Kremlin hérite d’un voisin chaotique, d’un net refroidissement de ses relations avec l’UE et les États-Unis, d’une marginalité nouvelle dans les instances internationales. Certes, la Russie dit clairement sa volonté de redéfinir les rapports politiques en Europe, de redessiner un système institutionnel qui la prendrait davantage en compte. Mais après avoir viré en arrière toute vers l’ancienne Europe des rapports de forces, que pourra-t-on crédiblement négocier ? Et la tentation des renforcements, des « réassurances » militaires, pourra-t-elle être évitée ?
Le bruit de fond militaire n’est pour l’heure pas trop prenant. Mais il existe bien. Au niveau nucléaire : n’est-ce pas ce nucléaire qui, au fond, nous garantit contre la duplication, un siècle après, de 1914 ? Sans oublier que l’aventure actuelle pourrait avoir quelque effet sur le « désir de nucléaire », et donc sur le rythme de la prolifération, ainsi que sur les projets de désarmement, voire de dénucléarisation… Les implications militaires existent aussi au niveau conventionnel : que nous dit la crise actuelle de la force russe, et quelles conséquences en tirer pour nos propres dispositifs militaires, au premier chef dans une Europe qui aime s’imaginer dans un monde postnational et postmilitaire ?
Une Europe aux abonnés quasi-absents. La crise prend à contre-pied une Politique européenne de voisinage (PEV) brouillonne, éclaire l’impuissance militaire de l’Union de Lisbonne et son incapacité à s’entendre sur une stratégie commune face à un problème fondamental dans son voisinage, tant demeurent prégnants les intérêts nationaux, et non politiques les mécanismes bruxellois.
Et loin, très loin, l’Amérique… Une Amérique finalement assez peu présente dans la crise, mais qui se voit, en un temps d’incertitude sur son propre positionnement stratégique, renvoyer la question fondamentale de ces 20 dernières années – qu’elle n’a pas plus que les autres les moyens de trancher : le système international retourne-t-il à grande vitesse vers une structure d’affrontement classique dont Moscou pourrait, avec Pékin, constituer l’épicentre ? Ou, bon an mal an, reste-t-il stable, avec de bons moyens d’amortir les cahots ici ou là inévitables ?
Sur l’ensemble de ces thèmes et bien d’autres encore, l’Ifri présente ici quelques brèves introductions aux débats ouverts par les événements ukrainiens. La crise ukrainienne ne fait que commencer.

Contenu disponible en :
Régions et thématiques
ISBN / ISSN
Utilisation
Comment citer cette publicationPartager
Téléchargez l'analyse complète
Cette page ne contient qu'un résumé de notre travail. Si vous souhaitez avoir accès à toutes les informations de notre recherche sur le sujet, vous pouvez télécharger la version complète au format PDF.
Ukraine : la crise commence
Centres et programmes liés
Découvrez nos autres centres et programmes de rechercheEn savoir plus
Découvrir toutes nos analysesSous le feu des normes : comment encadrer sans désarmer la défense européenne ?
Face à la diversité et la complexité de l’environnement normatif, le secteur de la défense doit pouvoir faire valoir sa singularité militaire. Dépassant une approche par la seule simplification, qui a montré ses limites face au caractère incontournable des normes juridiques et techniques à l’international, un équilibre est nécessaire entre un « trop-plein normatif » et l’absence de normes.
La brigade franco-allemande et la relance de la défense européenne
Une chose est claire depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche : le projet d’unification européenne est menacé dans son existence même. À moins d’élaborer une politique de défense souveraine pour parer à la guerre en Ukraine et à l’affaiblissement des garanties de sécurité américaines, l’Union européenne verra se poursuivre l’érosion de sa dynamique de cohésion interne et de son attractivité externe.
Daech au pays des merveilles
Ce livre mêle fiction et non-fiction. Il invite à réfléchir, de manière originale, aux effets de polarisation engendrés par la multiplication des attaques terroristes. Il tire la sonnette d’alarme sur les fragilités de la France, exacerbées par les extrémistes de tous bords.
Une base industrielle de défense transatlantique ? Deux analyses contrastées
L'évolution du paysage de la coopération mondiale en matière de défense met la relation transatlantique au défi. Alors que les tensions géopolitiques augmentent et que l'environnement de menaces devient plus complexe, la capacité de l'Europe à assurer au mieux sa sécurité tout en maintenant sa relation avec les États-Unis est devenue primordiale. Ce Focus stratégique offre deux points de vue contrastés sur la dynamique des relations industrielles de défense entre les États-Unis et l'Europe, en soulignant les défis et les opportunités qui attendent les deux parties.