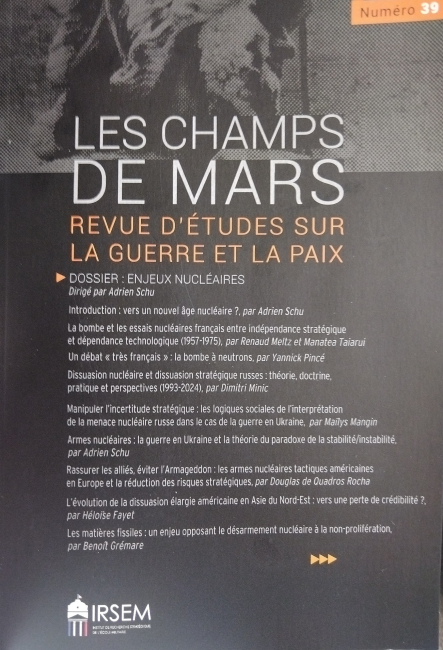Les relations germano-russes : entre changement de paradigme et maintien du statu quo
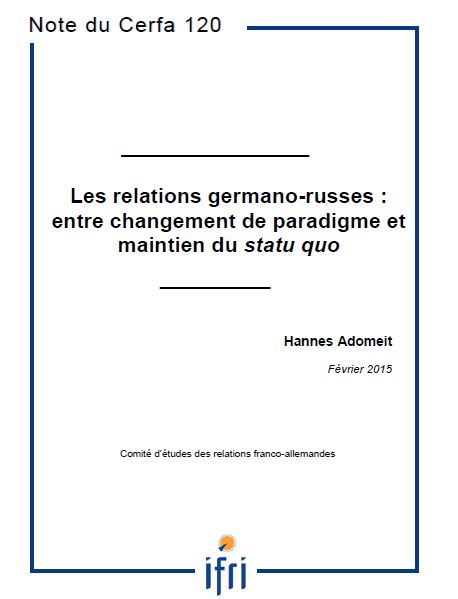
En 2014, les relations entre l’Allemagne et la Russie se sont dégradées, sinon du jour au lendemain, du moins en peu de temps. Les premières tensions sont apparues quelque temps avant l’annexion de la Crimée par la Russie en mars 2014, le soutien du Kremlin aux séparatistes, et l’intervention mal dissimulée de l’armée russe dans l’est de l’Ukraine.

Durant la période allant de l’effondrement de l’Union soviétique (1991) aux mandats de chancelier de Gerhard Schröder (1998-2005), l’Allemagne était le partenaire privilégié de la Russie en Europe. À cet égard, Berlin entretenait une « relation particulière » avec Moscou, qualifiée officiellement de « partenariat stratégique ». Au regard de ces éléments passés, faut-il considérer la crise actuelle des relations germano-russes comme un simple épisode temporaire qui sera bientôt oublié, ou bien comme un changement de paradigme radical, susceptible de perdurer dans un avenir proche ?
Pour tenter de répondre à cette question, la présente Note du Cerfa s’intéressera, dans un premier temps, aux principaux changements de perception et de paradigme qui sont décisifs pour l’élaboration de la politique allemande vis-à-vis de la Russie, à savoir : 1) les effets du nouveau cap fixé par Vladimir Poutine en matière de politique intérieure et étrangère ; 2) la position des Verts allemands sur la politique russe du gouvernement Merkel ; 3) l’évolution des points de vue au sein du SPD ; 4) le consensus adopté par la coalition CDU/CSU-SPD quant à la politique à mener à l’égard de Moscou ; 5) la place de la Russie dans l’industrie et le commerce allemands et la supposée dépendance allemande au gaz russe ; 6) les avis partagés de l’opinion publique vis-à-vis de la Russie.
Dans un second temps, l’analyse portera sur la façon dont le gouvernement allemand conduit sa politique en s’inspirant des leçons du passé. À cet égard, il convient de noter que le gouvernement allemand actuel a fait preuve, dès la formation de la coalition le 17 décembre 2013, d’une fermeté et d’une cohérence remarquables. Cela n’avait pas été le cas lors des crises précédentes, notamment après la guerre en Géorgie en août 2008, puisque Berlin avait alors repris le cours de ses échanges avec Moscou comme si de rien n’était. Dans une certaine mesure, le rôle central joué par l’Allemagne dans la gestion des relations avec la Russie depuis le début de la crise ukrainienne a donné corps aux propos tenus par le Président Joachim Gauck, le ministre des Affaires étrangères Frank-Walter Steinmeier et la ministre de la Défense Ursula von der Leyen lors de la 50e conférence sur la sécurité organisée à Munich en 2014 : à cette occasion, tous trois avaient affirmé que l’Allemagne devait être plus active et assumer davantage de responsabilités sur la scène internationale. Bien que le changement d’attitude de l’Allemagne envers la Russie soit réel par rapport aux épisodes précédents, il reste néanmoins limité dans certains domaines, en particulier sur les questions de sécurité et de défense posées par la crise ukrainienne.
Si les relations de l’Allemagne avec la Russie étaient auparavant fondées sur le partenariat, la coopération et la primauté des intérêts russes, la donne a changé : le nouveau paradigme de la politique allemande à l’égard de la Russie est celui de la gestion de conflit.
Jusqu'en 2013, Hannes Adomeit a été professeur sur le campus de Natolin (Varsovie) du Collège d’Europe où il dispensait des cours sur l’Union européenne et la Russie.

Contenu disponible en :
Régions et thématiques
ISBN / ISSN
Utilisation
Comment citer cette publicationPartager
Téléchargez l'analyse complète
Cette page ne contient qu'un résumé de notre travail. Si vous souhaitez avoir accès à toutes les informations de notre recherche sur le sujet, vous pouvez télécharger la version complète au format PDF.
Les relations germano-russes : entre changement de paradigme et maintien du statu quo
Centres et programmes liés
Découvrez nos autres centres et programmes de rechercheEn savoir plus
Découvrir toutes nos analysesTrump-Poutine : logiques et perspectives d'une négociation sur l'Ukraine
Comme prévu, le nouveau président américain, Donald Trump, semble se montrer conciliant avec son homologue russe, Vladimir Poutine, dont les objectifs restent maximalistes : cession de territoires, changement de régime, finlandisation et démilitarisation de l’Ukraine.
La mer Caspienne, pôle énergétique émergent : Opportunités et limites
La présente note analyse les perspectives d’évolution de la région de la mer Caspienne et de ses acteurs clés, à l’exception de la Russie et de l’Iran, en un pôle énergétique majeur répondant aux besoins de l’Union européenne (UE).
Dissuasion nucléaire et dissuasion stratégique russes : théorie, doctrine, pratique et perspectives (1993 - 2024)
Dimitri Minic, chercheur au Centre Russie/Eurasie à l'Ifri, docteur en histoire des relations internationales et spécialiste de la pensée et de la culture stratégiques russes, retrace dans un article pour Les Champs de Mars l'histoire théorique, doctrinale et pratique de la dissuasion nucléaire et de la dissuasion stratégique russes.
The European Union's Strategic Test in Georgia
La crise politique qui se déroule en Géorgie est de nature existentielle pour le pays. Ce qui est en jeu, c'est l'avenir de la Géorgie en tant que nation européenne, démocratique et souveraine.