Le dilemme des puissances moyennes : Comment AUKUS a remodelé le potentiel d’une coopération E3 dans l’Indo-Pacifique
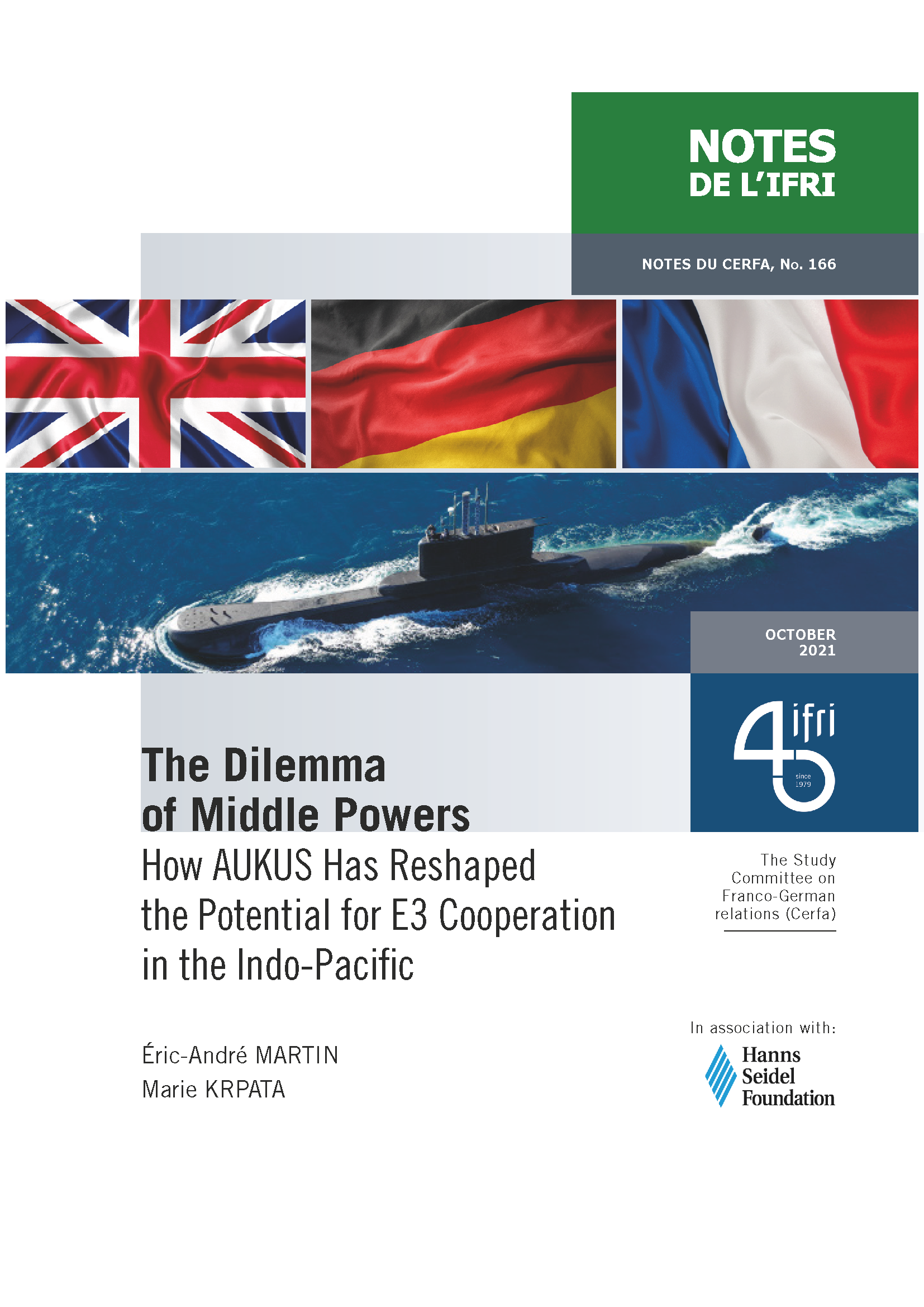
De manière croissante, l’Indo-Pacifique devient le centre de gravité de l’économie et de la géoéconomie mondiale. Cette région couvre 60% de la population mondiale, 30% du commerce international et 60% du produit intérieur brut (PIB) mondial.

De plus, les plus grands ports et aéroports du monde et 20 des 33 plus grandes métropoles du monde se trouvent dans l’Indo-Pacifique. L’océan indien et l’océan Pacifique, qui sont rassemblés dans le concept « Indo-Pacifique » sont devenus une artère commerciale vitale. L’Indo-Pacifique accueille de nombreux marchés de croissance pour des entreprises européennes, et les nombreuses économies émergentes rattrapent leur retard envers leurs équivalents occidentaux.
Reconnu comme poudrière, l’Indo-Pacifique, devient de manière croissante l’objet de tensions accrues et de violations du droit international. De toutes les régions du monde, l’Indo-Pacifique est certainement celle où les conflits géopolitiques sont les plus clairement perçus. Toute disruption peut avoir des impacts sur la région mais aussi au-delà en raison de l’interconnexion des activités économiques et des chaînes d’approvisionnement à l’échelle internationale. La pandémie du Covid-19 l’a démontré de manière édifiante.
C’est aussi une région dans laquelle la rivalité sino-américaine est de plus en plus visible à la suite du pivot asiatique engagé par les Etats-Unis pendant la présidence de Barack Obama en 2011. Dans ce contexte de complexité géopolitique, la région est confrontée à de nombreux défis, en raison de la densité de la population, de la pollution, des menaces à la biodiversité et d’activités néfastes pour le climat. Les répercussions vont bien au-delà de la simple région indo-pacifique et une coopération internationale permettrait de tenter de relever ces défis.
Le succès limité des organisations internationales à s'accorder sur des solutions adéquates a mené à l’émergence de nouveaux formats de coopération pour trouver des solutions efficaces, créatives et durables. Ces formats rassemblent des puissances de taille moyenne concernées par les effets négatifs d’une potentielle bipolarisation du système international. Un de ces formats est le E3 qui rassemble le Royaume-Uni, la France et l’Allemagne. Malgré les différences de ces pays en termes de présence dans la région et de culture stratégique, il existe des domaines d’intérêt commun, notamment en matière de sécurité et de préservation de l’environnement. Ils tentent de jouer le rôle d’ « intermédiaire » et de proposer une troisième voie entre les Etats-Unis et la Chine, en coopération avec des pays de l’Indo-Pacifique, tels que l’Inde ou le Japon, mais aussi l’Indonésie, Singapour ou la Malaisie, dans l’objectif de défendre un ordre mondial basé sur les règles du droit international et de répondre aux défis actuels et futurs et dont l’ampleur pourrait être considérable au vu de la sur-militarisation et du réchauffement climatique.
Les évolutions récentes, et notamment le lancement du partenariat AUKUS, et l’alignement du Royaume-Uni sur les Etats-Unis, ont mis à rude épreuve ce format, et le Royaume-Uni semble avoir perdu sa qualité d’« intermédiaire ». Dans quelle mesure l’Europe peut-elle jouer un rôle dans l’Indo-Pacifique, et quelles actions cela demanderait-il de la part de l’Union européenne ?
Eric-André Martin est Secrétaire général du Cerfa et coordonne l’Initiative européenne spatiale.
Marie Krpata est chercheuse au Cerfa où elle travaille en particulier sur l’Union européenne et le couple franco-allemand dans les relations internationales.
Cette publication est disponible en anglais : “The Dilemma of Middle Powers: How AUKUS Has Reshaped the Potential for E3 Cooperation in the Indo-Pacific”.
Centres et programmes liés
Découvrez nos autres centres et programmes de rechercheEn savoir plus
Découvrir toutes nos analysesPerspectives françaises et allemandes face aux défis géopolitiques dans le contexte de l’agression russe contre l’Ukraine
Les politiques étrangères, de défense et de sécurité de la France et l’Allemagne évoluent dans un contexte très tendu, marqué par le retour de conflits à haute intensité. Impensable au lendemain de la chute du Mur de Berlin qui symbolise la fin du conflit Est-Ouest, la guerre est aujourd’hui de retour en Europe, alors que les espaces terrestres et maritimes qui entourent le continent européen, de l’Arctique à l’Afrique en passant par le Moyen-Orient, sont devenus des théâtres de rivalité géopolitique, de guerres civiles et de conflits aussi bien hybrides que militaires.
La brigade franco-allemande et la relance de la défense européenne
Une chose est claire depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche : le projet d’unification européenne est menacé dans son existence même. À moins d’élaborer une politique de défense souveraine pour parer à la guerre en Ukraine et à l’affaiblissement des garanties de sécurité américaines, l’Union européenne verra se poursuivre l’érosion de sa dynamique de cohésion interne et de son attractivité externe.
Friedrich Merz et la Zeitenwende 2.0. Une « nouvelle ère » pour les relations transatlantiques ?
Le 23 février 2025, près de 60 millions d’électeurs ont été appelés à élire un nouveau Bundestag. Ces élections donneront également naissance à un nouveau gouvernement dans la première économie d’Europe.
Après les élections : l’Allemagne en quête d’une stabilité ébranlée ?
Avec 82,5 % de participation, l’Allemagne a enregistré un taux de mobilisation inédit depuis 1987, une hausse de 6,1 points par rapport à 2021. Comme en 2021, cette forte participation a profité à l’Alternative pour l’Allemagne (AfD), qui a su mobiliser un grand nombre d’anciens abstentionnistes.
















