L'Afrique du Sud en péril ? Une analyse d'économie politique
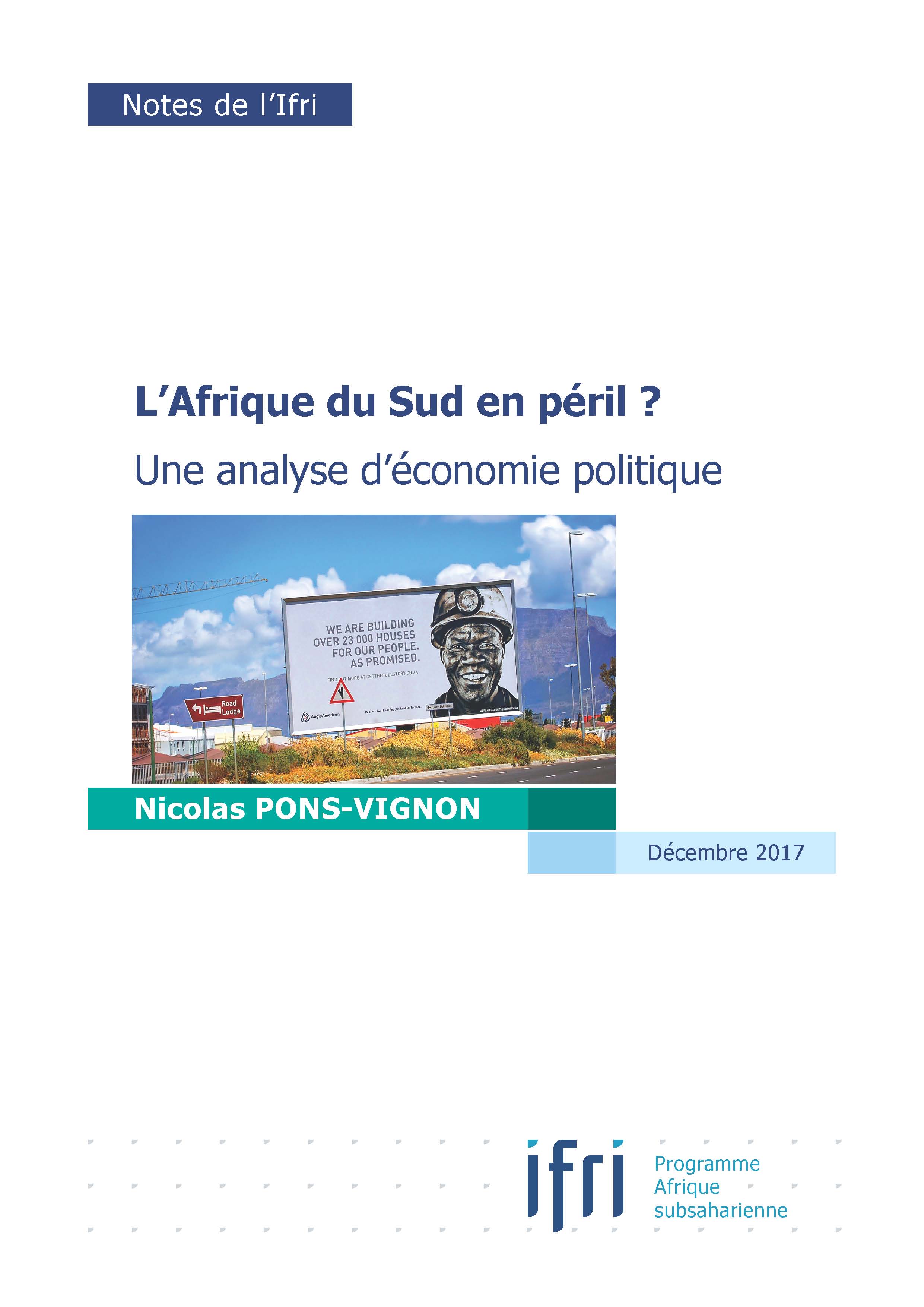
Le président Jacob Zuma a remplacé son respecté ministre des Finances, Pravin Gordhan, le 30 mars 2017. Il s’agit de la seconde tentative en deux ans (cette fois-ci réussie) de mettre à ce poste clé un responsable « conciliant » avec les projets du président.

La conséquence immédiate de ce remaniement ministériel a été l’abaissement de la note de la dette sud-africaine au statut « junk » par Standard & Poor’s et Fitch. Malgré de nombreux appels à démissionner, le président Zuma semble sortir renforcé, en partie grâce à la mobilisation de soutiens disparates. L’Afrique du Sud se trouve néanmoins dans une situation très délicate tant d’un point de vue économique que social.
Afin d’éclairer la crise actuelle, il convient de revenir sur la dégradation marquée des rapports sociaux depuis 1994, avec une montée de la contestation « par le bas » qui a culminé avec l’expulsion du principal syndicat métallurgiste, National Union of Metal Workers of South Africa (NUMSA), du Congress of South African Trade Unions (COSATU) en 2015. Nous développerons l’argument selon lequel l’impasse sud-africaine est la conséquence de l’adoption de politiques néolibérales masquées par une rhétorique prétendant que la croissance et la réduction de la pauvreté sont au cœur du projet gouvernemental. La République d’Afrique du Sud (RSA) ne peut cependant en aucun cas être considérée comme un État développeur, au sens des « tigres » est-asiatiques, et a connu un changement structurel négatif pour la croissance (caractérisé par un processus de désindustrialisation précoce). Nous discuterons également le constat d’une montée des inégalités depuis les années 1990, invalidant l’idée chère à l’ANC selon laquelle le pays cherche à émuler le modèle nord-européen d’État-providence. Dans un contexte de chômage structurel extrêmement élevé, la principale source de solidarité est privée, et est constituée par les transferts entre ménages. L’adoption d’un salaire minimum national de 3 500 rands par mois (environ 250 euros), qui devrait entrer en vigueur en 2018, constitue une avancée positive, quoique peut-être trop tardive. En effet, les conséquences d’une croissance faible et de l’accumulation des frustrations depuis 1994 pourraient bien précipiter le pays dans une grave crise politique et économique.

Contenu disponible en :
Régions et thématiques
ISBN / ISSN
Utilisation
Comment citer cette publicationPartager
Téléchargez l'analyse complète
Cette page ne contient qu'un résumé de notre travail. Si vous souhaitez avoir accès à toutes les informations de notre recherche sur le sujet, vous pouvez télécharger la version complète au format PDF.
L'Afrique du Sud en péril ? Une analyse d'économie politique
Centres et programmes liés
Découvrez nos autres centres et programmes de rechercheEn savoir plus
Découvrir toutes nos analysesNouvelle commission de l’Union africaine de Mahamoud Ali Youssouf. Le désenchantement des pays membres
La candidature de Raila Odinga, sans expérience diplomatique et tourné vers la politique nationale, affaiblit la crédibilité de l’institution. L’enseignement principal de cette élection est que l’Union africaine (UA), dans sa forme actuelle, ne véhicule plus le même enthousiasme que lors des premières années de la réforme initiée en 2018. Celle-ci avait notamment pour but de mettre en place une organisation plus efficace et d’atteindre une plus grande indépendance financière.
Éthiopie-Somalie : une paix sous patronage turc
Après une année de tensions dans la Corne de l’Afrique, 2024 s’est conclue par un apaisement diplomatique entre l’Éthiopie et la Somalie, ouvrant l’année 2025 sur des perspectives politiques régionales encourageantes.
Relations anglo-kényanes (1920-2024) : conflit, alliance et un arc rédempteur
Cet article propose une analyse des relations diplomatiques à l’ère postcoloniale entre le Royaume-Uni et l’une de ses anciennes colonies de peuplement, le Kenya.
La diplomatie, un outil pour aider les villes à gérer les risques géopolitiques
Les crises et la polarisation croissante des relations internationales font de l'analyse des risques politiques une ressource indispensable pour les entités publiques et privées actives au niveau international.











