Comprendre les villes intermédiaires au Nigeria. Les cas d'Ibadan et d'Abeokuta
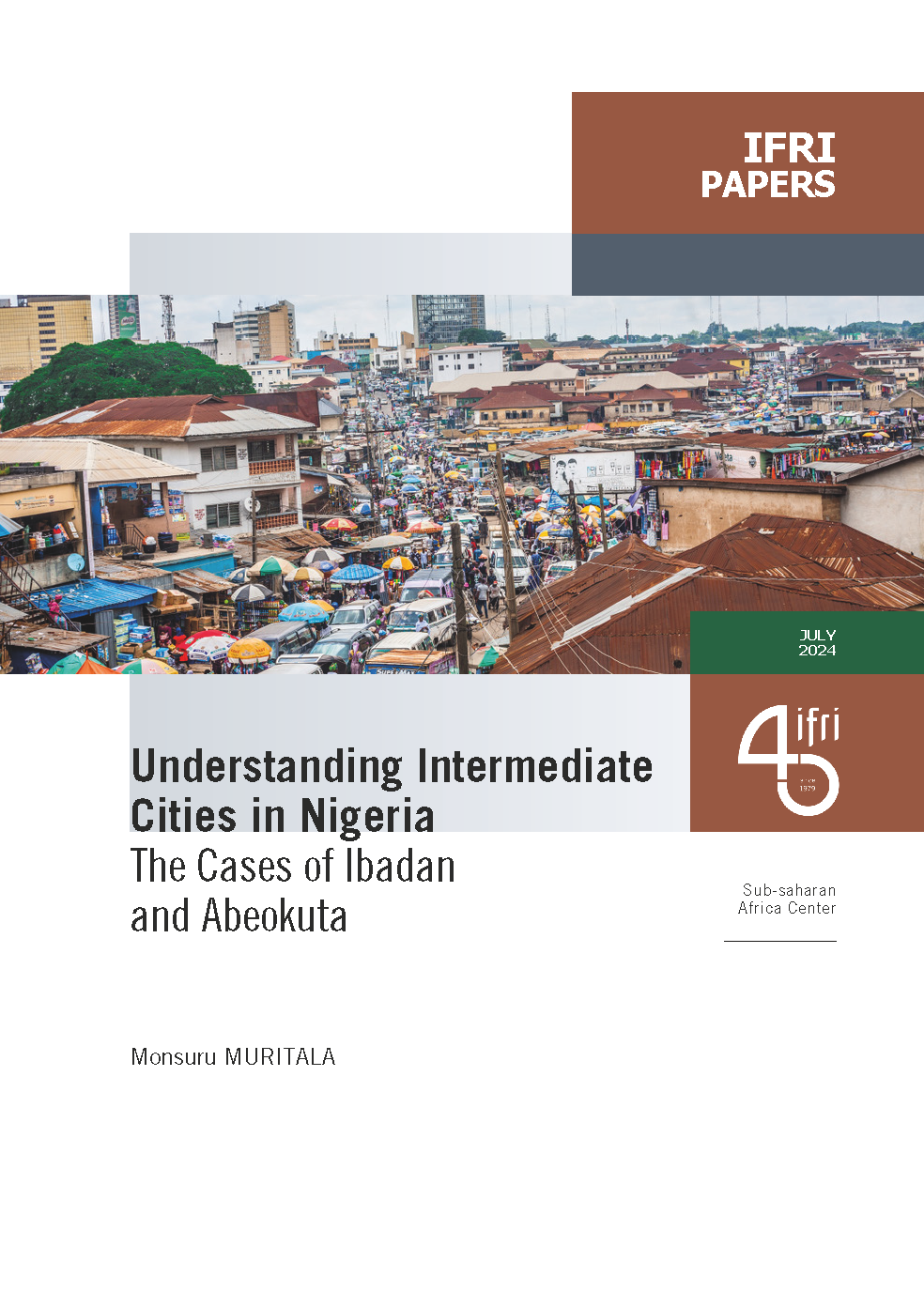
Le Nigeria est connu pour sa rapide croissance démographique et urbaine.

L’attention des médias et des chercheurs s’est concentrée sur l’expansion impressionnante de la mégalopole nigériane de Lagos, dont la population devrait passer de 16 millions d’habitants en 2024 à environ 40 millions en 2035. Par conséquent, il existe moins de données sur les autres catégories de villes au Nigeria, telles que les villes intermédiaires ou secondaires. Pourtant, des recherches plus récentes sur la dynamique de l’urbanisation en Afrique ont mis en évidence les taux de croissance urbaine relativement plus élevés dans les villes dites « intermédiaires ».
Cet papier contribue au débat et vise à fournir une perspective différente sur l’urbanisation au Nigeria : basée sur une approche historique, cette Note de l’Ifri évalue le développement de deux villes-satellites intermédiaires de Lagos : Abeokuta et Ibadan. Elle soutient que Lagos n’est pas une ville autonome mais qu’elle s’appuie sur un réseau urbain plus large composé de villes intermédiaires.
Le papier présente le développement historique d’Ibadan et d’Abeokuta, dont l’évolution est allée de pair avec la croissance de Lagos. Il montre que les infrastructures de transport, établies depuis la période coloniale, ont joué un rôle clé dans les relations entre ces villes.
Cette publication est disponible uniquement en anglais : Understanding Intermediate Cities in Nigeria: The Cases of Ibadan and Abeokuta.

Contenu disponible en :
Régions et thématiques
Utilisation
Comment citer cette publicationPartager
Centres et programmes liés
Découvrez nos autres centres et programmes de rechercheEn savoir plus
Découvrir toutes nos analysesNouvelle commission de l’Union africaine de Mahamoud Ali Youssouf. Le désenchantement des pays membres
La candidature de Raila Odinga, sans expérience diplomatique et tourné vers la politique nationale, affaiblit la crédibilité de l’institution. L’enseignement principal de cette élection est que l’Union africaine (UA), dans sa forme actuelle, ne véhicule plus le même enthousiasme que lors des premières années de la réforme initiée en 2018. Celle-ci avait notamment pour but de mettre en place une organisation plus efficace et d’atteindre une plus grande indépendance financière.
Éthiopie-Somalie : une paix sous patronage turc
Après une année de tensions dans la Corne de l’Afrique, 2024 s’est conclue par un apaisement diplomatique entre l’Éthiopie et la Somalie, ouvrant l’année 2025 sur des perspectives politiques régionales encourageantes.
Relations anglo-kényanes (1920-2024) : conflit, alliance et un arc rédempteur
Cet article propose une analyse des relations diplomatiques à l’ère postcoloniale entre le Royaume-Uni et l’une de ses anciennes colonies de peuplement, le Kenya.
La diplomatie, un outil pour aider les villes à gérer les risques géopolitiques
Les crises et la polarisation croissante des relations internationales font de l'analyse des risques politiques une ressource indispensable pour les entités publiques et privées actives au niveau international.













