La France dans l’OTAN : de l’allié difficile au contributeur essentiel
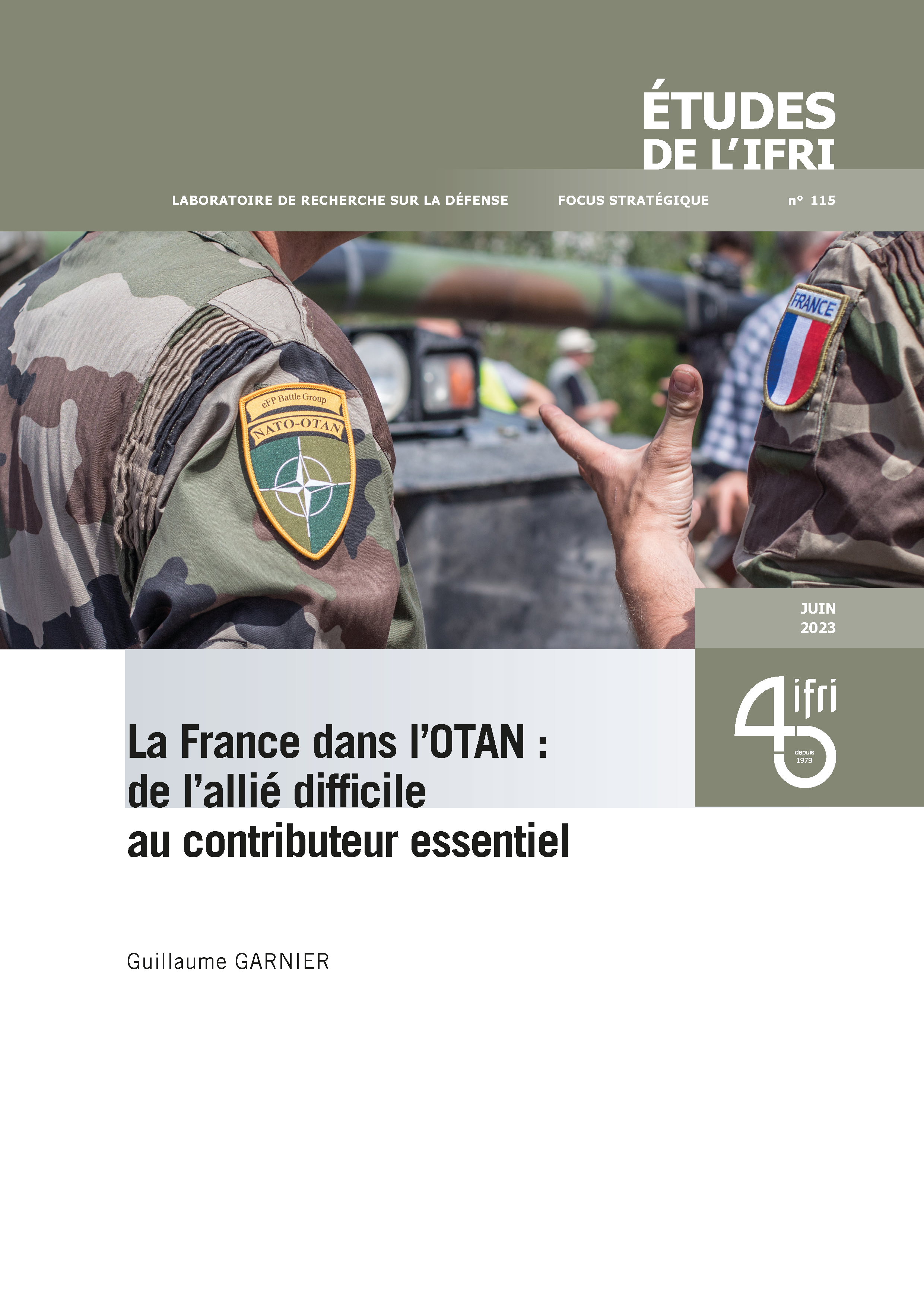
Dégradation rapide du contexte sécuritaire et retrait chaotique d’Afghanistan, différends internes éclatant au grand jour, questionnements sur son périmètre de responsabilité en matière de sécurité, l’Organisation du traité de l’Atlantique nord (OTAN) semblait en fâcheuse posture jusqu’à ce que l’invasion de l’Ukraine le 24 février 2022 vienne la remettre pleinement en selle.

Le nouveau Concept stratégique, agréé au sommet de Madrid de juin 2022, se veut une réponse à ce tournant majeur et représente l’aboutissement d’un processus d’introspection consécutif aux propos du président Emmanuel Macron évoquant, dans une interview au magazine The Economist, la « mort cérébrale » de l’organisation. L’Alliance actualise ainsi dans ce document ses buts politiques et stratégiques. Les effets d’entraînement que suscitera un tel aggiornamento sur la politique de défense de la France et sur ses armées sont souvent sous-estimés depuis Paris.
Plutôt que d’interroger la relation France-OTAN, sujet déjà largement couvert, l’ambition de cette étude est de disséquer les aspects concrets, d’abord militaires mais aussi politiques, découlant de cette adaptation systémique de l’OTAN et d’analyser ses conséquences potentielles sur l’appareil de défense français. Comment ce dernier doit-il appréhender ces changements ? Quel parti peut-il en tirer ? L’élément central du Concept stratégique 2022 est le retour de l’OTAN dans sa fonction première : la défense collective des États membres sur le flanc oriental, face à son rival traditionnel, la Russie, et ce dans les champs conventionnel et nucléaire. Sans occulter les autres sujets du concept, c’est donc d’abord au regard de la future posture « de dissuasion et de défense » (DDA), densifiée et plus réactive, que la France doit se positionner. Les équilibres internes de l’OTAN vont en effet s’en trouver bouleversés, dans un contexte européen où, en dépit de disparités encore notables, les efforts budgétaires de défense repartent à la hausse, ou s’accélèrent encore pour les pays orientaux et nordiques. De ces contributions financières et militaires dépendent le niveau de responsabilité, et donc le poids politique, attribué à chaque allié.
Quelle place peut aujourd’hui revenir à la France dans ce cadre ? Celle-ci dispose de nombreux atouts militaires à faire valoir au sein de l’OTAN : une armée d’emploi éprouvée régulièrement, un système de forces réactif, une expertise sur l’ensemble des sujets de défense et une capacité d’analyse stratégique en dehors de l’espace euro-atlantique. Son poids structurel dans l’organisation est également conséquent, lui conférant souvent la deuxième place derrière les États-Unis, selon les critères. Pourtant, ces leviers d’influence ne semblent pas être utilisés de manière optimale. La France ne parvient pas toujours à élaborer des coalitions internes solides et ne dispose pas d’un club structuré d’affiliés sur le plan militaire.

Contenu disponible en :
Régions et thématiques
ISBN / ISSN
Utilisation
Comment citer cette publicationPartager
Téléchargez l'analyse complète
Cette page ne contient qu'un résumé de notre travail. Si vous souhaitez avoir accès à toutes les informations de notre recherche sur le sujet, vous pouvez télécharger la version complète au format PDF.
La France dans l’OTAN : de l’allié difficile au contributeur essentiel
Centres et programmes liés
Découvrez nos autres centres et programmes de rechercheEn savoir plus
Découvrir toutes nos analysesSous le feu des normes : comment encadrer sans désarmer la défense européenne ?
Face à la diversité et la complexité de l’environnement normatif, le secteur de la défense doit pouvoir faire valoir sa singularité militaire. Dépassant une approche par la seule simplification, qui a montré ses limites face au caractère incontournable des normes juridiques et techniques à l’international, un équilibre est nécessaire entre un « trop-plein normatif » et l’absence de normes.
La brigade franco-allemande et la relance de la défense européenne
Une chose est claire depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche : le projet d’unification européenne est menacé dans son existence même. À moins d’élaborer une politique de défense souveraine pour parer à la guerre en Ukraine et à l’affaiblissement des garanties de sécurité américaines, l’Union européenne verra se poursuivre l’érosion de sa dynamique de cohésion interne et de son attractivité externe.

Daech au pays des merveilles
Ce livre mêle fiction et non-fiction. Il invite à réfléchir, de manière originale, aux effets de polarisation engendrés par la multiplication des attaques terroristes. Il tire la sonnette d’alarme sur les fragilités de la France, exacerbées par les extrémistes de tous bords.
Une base industrielle de défense transatlantique ? Deux analyses contrastées
L'évolution du paysage de la coopération mondiale en matière de défense met la relation transatlantique au défi. Alors que les tensions géopolitiques augmentent et que l'environnement de menaces devient plus complexe, la capacité de l'Europe à assurer au mieux sa sécurité tout en maintenant sa relation avec les États-Unis est devenue primordiale. Ce Focus stratégique offre deux points de vue contrastés sur la dynamique des relations industrielles de défense entre les États-Unis et l'Europe, en soulignant les défis et les opportunités qui attendent les deux parties.















