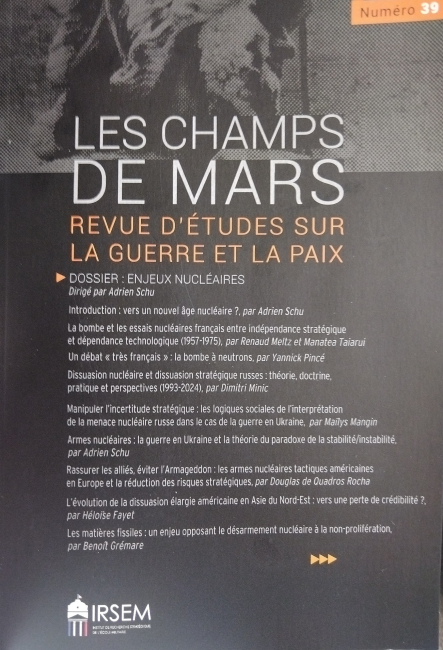Que faire de la Russie ? Que faire avec la Russie ?
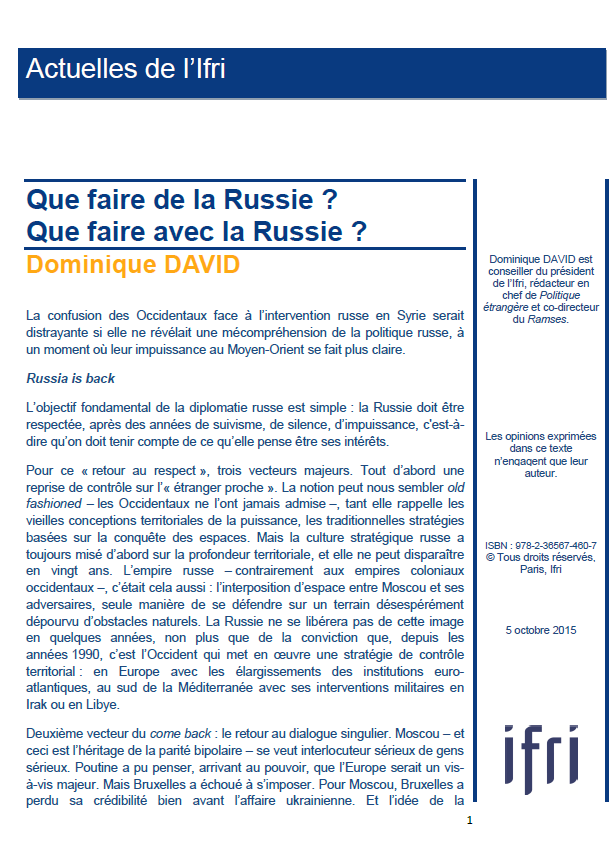
La confusion des Occidentaux face à l’intervention russe en Syrie serait distrayante si elle ne révélait une mécompréhension de la politique russe, à un moment où leur impuissance au Moyen-Orient se fait plus claire.

Russia is back
L’objectif fondamental de la diplomatie russe est simple : la Russie doit être respectée, après des années de suivisme, de silence, d’impuissance, c'est-à-dire qu’on doit tenir compte de ce qu’elle pense être ses intérêts.
Pour ce « retour au respect », trois vecteurs majeurs. Tout d’abord une reprise de contrôle sur l’« étranger proche ». La notion peut nous sembler old fashioned – les Occidentaux ne l’ont jamais admise –, tant elle rappelle les vieilles conceptions territoriales de la puissance, les traditionnelles stratégies basées sur la conquête des espaces. Mais la culture stratégique russe a toujours misé d’abord sur la profondeur territoriale, et elle ne peut disparaître en vingt ans. L’empire russe – contrairement aux empires coloniaux occidentaux –, c’était cela aussi : l’interposition d’espace entre Moscou et ses adversaires, seule manière de se défendre sur un terrain désespérément dépourvu d’obstacles naturels. La Russie ne se libérera pas de cette image en quelques années, non plus que de la conviction que, depuis les années 1990, c’est l’Occident qui met en œuvre une stratégie de contrôle territorial : en Europe avec les élargissements des institutions euro-atlantiques, au sud de la Méditerranée avec ses interventions militaires en Irak ou en Libye.
Deuxième vecteur du come back : le retour au dialogue singulier. Moscou – et ceci est l’héritage de la parité bipolaire – se veut interlocuteur sérieux de gens sérieux. Poutine a pu penser, arrivant au pouvoir, que l’Europe serait un vis-à-vis majeur. Mais Bruxelles a échoué à s’imposer. Pour Moscou, Bruxelles a perdu sa crédibilité bien avant l’affaire ukrainienne. Et l’idée de la déconnexion entre négociation technico-économique avec Kiev et négociation politique avec Moscou n’a fait que confirmer l’absence de l’UE des vrais circuits de la puissance, ceux qui savent mesurer les rapports de force. Les « gens sérieux », pour Moscou, ne sont, désormais et toujours, que les États-Unis. Une conviction qui n’interdit pas de traiter de temps à autre avec Berlin ou Paris, pour des problèmes plus régionaux ou pour diviser le camp occidental – qui ne demande souvent que cela…
Troisième vecteur du retour russe : la dégradation de la situation moyen-orientale. Le Moyen-Orient est traditionnellement une aire de présence russe – la Russie en est géographiquement proche, et les intérêts occidentaux dans la région font qu’elle s’y est intéressée de près du temps de l’URSS. Le poids de la population russo-israélienne renforce les anciens motifs d’intérêt. Et surtout, prolifèrent dans la région les bouillons de culture de tous les islamismes. La Russie ne s’est achevée historiquement comme empire qu’en intégrant de vastes populations musulmanes. Moscou pense donc avoir quelque chose à dire sur les rapports avec l’Islam – sans doute à juste titre. Et quelque chose à craindre d’une circulation Moyen-Orient/Caucase qui ferait de son territoire le champ d’affrontements djihadistes de grande ampleur – à partir, par exemple, d’une Tchétchénie faussement pacifiée autour d’un régime néo-islamiste.
Si l’on ajoute que ce Moyen-Orient est depuis vingt ans l’aire de jeu privilégiée de la puissance américaine, on a une combinaison de facteurs qui explique le choix de cet espace pour la rentrée diplomatique russe.
Syrie et Ukraine
Au Moyen-Orient, la Russie veut démontrer qu’elle n’est pas isolée et qu’elle est nécessaire. Le récit occidental dit que la Russie s’est, avec son action en Ukraine, coupée du monde, mise au ban de la société internationale. C’est prendre un peu vite ses désirs pour la réalité, et faire des visions occidentales le seul ordre de référence, un ordre supérieur, impératif.
Pour Moscou, le problème n’est pas qu’elle s’est isolée avec ses menées en Ukraine, mais qu’elle y est dans l’impasse. La manœuvre de Crimée fut brillante. Celle du Donbass moins, notamment parce que la Russie y maîtrisait beaucoup moins les acteurs locaux. Le bilan provisoire de l’affaire ukrainienne est pour Moscou contrasté. La Russie a réaffirmé, avec des moyens limités, son poids dans la région. Bloqué tout glissement accéléré de Kiev en direction de l’Ouest. Mais elle a aussi renforcé le nationalisme ukrainien, et échoué à réinstaller à Kiev un gouvernement docile. La crise est donc gelée, avec un double risque pour Moscou : la reprise d’un conflit ouvert qui l’obligerait à hausser le niveau de son intervention ; ou une anarchie généralisée en Ukraine – dont les leaders russes n’entendent nullement se charger. Toute situation qui appellerait en Ukraine un réinvestissement russe, lequel serait obligatoirement suivi d’un réinvestissement occidental, serait négative pour Moscou.
La Russie a pour l’heure intérêt à calmer les événements en Ukraine, en appliquant progressivement les accords de Minsk, tout en sachant que les sanctions à son encontre ne pourront pas être rapidement levées. La liaison entre les deux théâtres, Ukraine et Syrie, est donc implicite. Elle tient à ce que, compte tenu de la situation – hors de considérations morales qui se marient mal avec la décision politique –, nous avons besoin de Moscou. En Ukraine, où la situation ne peut être stabilisée qu’avec la pression de cette dernière sur les indépendantistes et un accord minimal avec les autorités de Kiev. Et en Syrie, où l’approche militaire de la coalition menée par les États-Unis est aussi dans l’impasse. Inversement, Moscou a aussi besoin de nous : le dialogue singulier de la puissance ne peut s’ouvrir que si l’interlocuteur est là, si un minimum de confiance est rétabli.
Comment sortir de l’échec occidental ?
Comment les Occidentaux ont-ils pu plonger si profond dans une situation qui leur échappe tant ? On connaît les origines. L’intervention américaine de 2003 en Irak, relayée par l’intervention anglo-française en Libye, les deux dévaluant globalement l’image de notre efficacité militaire et politique, et la valeur même de la référence à l’Occident, et attisant les feux couvant dans la région ; l’usure du régime fort de Damas face à des oppositions multiples mais dopées par la dynamique des printemps arabes ; le rejet net du régime syrien de la part des grands pays occidentaux – avec pourtant remords et retours décrédibilisant leurs stratégies ; leurs décisions d’intervenir sans volonté d’être décisifs, c'est-à-dire de s’engager vraiment – suite d’options sans stratégie qui se résout en frappes aériennes et en actions « couvertes » à l’efficacité très relative ; une résilience du régime syrien qui s’explique largement par la division des oppositions, et leur islamisation croissante… Moscou n’a nul mal à expliquer que le résultat global est une catastrophe pour les populations syriennes martyrisées, pour les Occidentaux, pour la région, et au-delà quant au risque de diffusion d’islamismes militants et armés.
Que peut changer l’intervention de Moscou ? Sur le terrain sans doute pas grand-chose. Tant qu’elle se limite à des frappes aériennes, pourquoi celles-ci seraient-elles plus efficaces que celles de l’aviation américaine ? Quant à une intervention terrestre, l’armée russe reste sans doute plus proche que les armées occidentales du concept même, et des moyens, d’une intervention de fond, mais l’ombre de l’Afghanistan est encore proche, qui dissuadera les décideurs moscovites. L’apport russe est diplomatique ; le sens des frappes militaires est d’abord diplomatique : il s’agit de s’imposer, et définitivement, à une table de négociation politique où le régime syrien sera aussi présent.
Et cette négociation est inévitable, avec tous les acteurs du drame – y compris avec ce régime dont on nous annonce la mort depuis plusieurs années. Les principaux pays occidentaux ayant fermé officiellement toutes les portes de communication avec celui-ci – hors échanges pratiques sur les frappes aériennes et le terrorisme –, Moscou se trouve de facto dans une position de force. Son soutien à Bachar est clairement une position de début de négociation – l’autre argument étant constitué par les frappes aériennes. Mais la Russie ne s’immolera pas sur le bûcher d’Al-Assad : celui-ci sera dûment mis de côté quand cela sera possible, ou nécessaire. En attendant, Moscou tient la position de facilitateur de la négociation tous azimuts, au moment où chacun convient que seule une négociation peut déboucher sur une solution politique, même bancale, même provisoire. Après avoir aidé à l’accord Washington-Téhéran, le succès est notable pour une puissance isolée, finie, bannie…
Que faire avec Moscou ?
Depuis vingt ans la question dominante à l’Ouest était : que faire de Moscou ? Elle devient : que faire avec Moscou ? La détestation de Vladimir Poutine ne peut longtemps servir de stratégie.
Moscou est-elle la grande puissance qu’elle croit ? Peut-être pas. Et les difficultés s’amoncellent à son horizon : risque d’une dégradation « in-maîtrisée » de la situation en Ukraine, crise économique due à la fois au piétinement des réformes, à la chute des cours des matières premières et à l’effet des sanctions occidentales, « dé-légitimation » du régime si ces difficultés économiques s’aggravaient trop… Mais si Moscou rêve en vain de redevenir une super-puissance, selon une définition hors d’âge, elle reste une puissance qui compte, par son poids objectif et son pouvoir de nuisance dans les zones proches d’elle, où les Occidentaux n’ont ni l’envie ni les moyens de lui succéder ; autant que par l’héritage de son histoire, qui projette son influence loin de son territoire.
Il va falloir nous y faire : on ne peut passer la puissance russe par pertes et profits, ni la considérer comme un élément régional subalterne, et il faut faire avec, c'est-à-dire ici ou là décider et agir avec elle. L’aventurisme parfois, souvent les échecs de bonne volonté, des pays occidentaux depuis trois décennies ne leur garantissent nul monopole sur la pacification du monde.

Contenu disponible en :
Régions et thématiques
ISBN / ISSN
Utilisation
Comment citer cette publicationPartager
Téléchargez l'analyse complète
Cette page ne contient qu'un résumé de notre travail. Si vous souhaitez avoir accès à toutes les informations de notre recherche sur le sujet, vous pouvez télécharger la version complète au format PDF.
Que faire de la Russie ? Que faire avec la Russie ?
Centres et programmes liés
Découvrez nos autres centres et programmes de rechercheEn savoir plus
Découvrir toutes nos analysesTrump-Poutine : logiques et perspectives d'une négociation sur l'Ukraine
Comme prévu, le nouveau président américain, Donald Trump, semble se montrer conciliant avec son homologue russe, Vladimir Poutine, dont les objectifs restent maximalistes : cession de territoires, changement de régime, finlandisation et démilitarisation de l’Ukraine.
La mer Caspienne, pôle énergétique émergent : Opportunités et limites
La présente note analyse les perspectives d’évolution de la région de la mer Caspienne et de ses acteurs clés, à l’exception de la Russie et de l’Iran, en un pôle énergétique majeur répondant aux besoins de l’Union européenne (UE).
Dissuasion nucléaire et dissuasion stratégique russes : théorie, doctrine, pratique et perspectives (1993 - 2024)
Dimitri Minic, chercheur au Centre Russie/Eurasie à l'Ifri, docteur en histoire des relations internationales et spécialiste de la pensée et de la culture stratégiques russes, retrace dans un article pour Les Champs de Mars l'histoire théorique, doctrinale et pratique de la dissuasion nucléaire et de la dissuasion stratégique russes.
The European Union's Strategic Test in Georgia
La crise politique qui se déroule en Géorgie est de nature existentielle pour le pays. Ce qui est en jeu, c'est l'avenir de la Géorgie en tant que nation européenne, démocratique et souveraine.