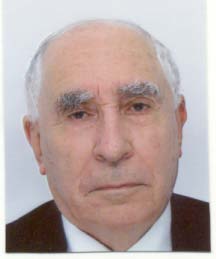L'accès à l'énergie dans l'Afrique subsaharienne

La situation économique, politique et sociale de l"Afrique au sud du Sahara ne cesse d"être évoquée dans les grandes conférences intergouvernementales. Le dernier G8 n"a pas fait exception à cette règle.
L"accès à l"énergie constitue à l"évidence l"une des conditions du développement africain, mais il faut être conscient que ce problème comporte des volets différents. En se limitant au domaine de l"électricité, (car l"accès à cette forme d"énergie a des effets considérables sur les modes de vie), trois questions doivent être séparées : l"efficacité énergétique des systèmes électriques, l"alimentation des grandes centres urbains, la fourniture aux zones rurales d"habitat dispersé.
- Dans de nombreux pays d"Afrique, le rapport entre l"énergie finale dont profitent les utilisateurs et l"énergie primaire consommée pour produire l"électricité est faible par suite de pertes importantes tout le long de la chaîne. Travailler à la réduction de ces pertes constitue une action à la rentabilité certaine. Des contrats entre les compagnies locales et des opérateurs techniquement qualifiés des pays développés semblent la voie à explorer.
- Les grandes mégapoles africaines regroupent des populations nombreuses et nécessitent donc, malgré la faible consommation d"électricité par tête, des investissements électriques importants. On a cru, pendant une décennie au moins, pouvoir y faire face en incitant des opérateurs privés du " Nord " à installer à leurs frais des unités de production, les dépenses étant couvertes par le flux des recettes résultant de la vente des kilowatts heure. Mais cette option se heurte au désir des gouvernements -discutable certes mais puissant- d"avoir recours pour des raisons sociales à des faibles tarifs de l"électricité. Dès lors, cette piste aboutit souvent à une impasse et, on peut se demander si, comme ce fut le cas dans les pays européens après la seconde guerre mondiale, les gouvernements africains ne devraient pas consacrer une plus grande part de l"épargne nationale à l"édification du système électrique en complétant d"ailleurs cet apport par des emprunts auprès des banques étrangères.
- Toute autre est la question du rural diffus dont l"alimentation ne peut être couverte par l"extension des réseaux à partir des villes. Pour couvrir les besoins essentiels (pompage de l"eau, conservation des aliments, des médicaments, accès à la télévision, éclairage minima) la seule voie est de s"adresser à des sources de production ponctuelles (le photo voltaïque par exemple). Certes, le coût au kWh est élevé, mais l"impact sur l"épanouissement des collectivités rurales est si élevé que l"aide privée et l"aide publique au développement devraient accentuer leur implication dans ce domaine.
C"est dans ces directions que devrait s"orienter l"assistance internationale au développement de l"accès à l"énergie dans cette région du monde.

Contenu disponible en :
Régions et thématiques
Utilisation
Comment citer cette publicationPartager
Centres et programmes liés
Découvrez nos autres centres et programmes de rechercheEn savoir plus
Découvrir toutes nos analysesNouvelle commission de l’Union africaine de Mahamoud Ali Youssouf. Le désenchantement des pays membres
La candidature de Raila Odinga, sans expérience diplomatique et tourné vers la politique nationale, affaiblit la crédibilité de l’institution. L’enseignement principal de cette élection est que l’Union africaine (UA), dans sa forme actuelle, ne véhicule plus le même enthousiasme que lors des premières années de la réforme initiée en 2018. Celle-ci avait notamment pour but de mettre en place une organisation plus efficace et d’atteindre une plus grande indépendance financière.
Éthiopie-Somalie : une paix sous patronage turc
Après une année de tensions dans la Corne de l’Afrique, 2024 s’est conclue par un apaisement diplomatique entre l’Éthiopie et la Somalie, ouvrant l’année 2025 sur des perspectives politiques régionales encourageantes.
Relations anglo-kényanes (1920-2024) : conflit, alliance et un arc rédempteur
Cet article propose une analyse des relations diplomatiques à l’ère postcoloniale entre le Royaume-Uni et l’une de ses anciennes colonies de peuplement, le Kenya.
La diplomatie, un outil pour aider les villes à gérer les risques géopolitiques
Les crises et la polarisation croissante des relations internationales font de l'analyse des risques politiques une ressource indispensable pour les entités publiques et privées actives au niveau international.