La démocratie en Afrique : tours et détours
La démocratie est un produit complexe, qui articule un cadre juridique et une base sociale lui permettant de s’enraciner.
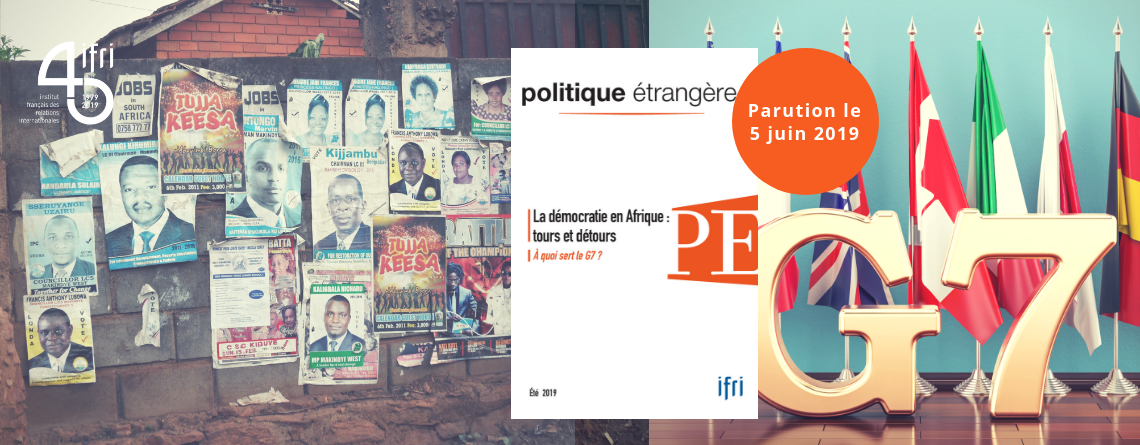
Loin des naïves espérances des années 1990, les expériences de plusieurs pays d’Afrique décrivent un chemin qui demeure, à des degrés divers, chaotique : en Mauritanie, en République démocratique du Congo, en Centrafrique ou au Nigeria par exemple… Le dossier de Politique étrangère rappelle que la mise en place d’institutions supposées permettre la démocratie n’est qu’un signe, un prélude. Les avancées, sur le terrain, devront beaucoup plus aux sociétés qu’aux intervenants extérieurs, quelle que soit la bonne volonté de ces derniers. Le constat, une fois de plus, devrait inciter ces intervenants à redéfinir des politiques prenant mieux en compte des conditions politiques locales.
Sur une scène internationale où la revendication de puissance se fait plus bruyante, quelle place occupe le G7, que préside cette année Paris ? Reste-il pertinent, seul forum brassant les grands problèmes du monde, des politiques économiques au statut des femmes, en passant par la sauvegarde des océans ? Témoigne-t-il seulement de la volonté de voir perdurer un Occident divisé et isolé dans un monde qui le nie ? La rubrique Contrechamps confronte une vision canadienne – le Canada a présidé le G7 en 2018 –, et une vision russe – la Russie a été exclue du G8 en 2014… Bonne occasion de réfléchir sur la conception qu’a Moscou de ses propres intérêts, et sur la nouvelle hiérarchie des puissances.
DOSSIER
LA DÉMOCRATIE EN AFRIQUE : TOURS ET DÉTOURS
Vers un retour de l'autoritarisme en Afrique ?, par Victor Magnani et Thierry Vircoulon (lire l'article)
Nigéria : les méfaits de la democrazy, par Marc-Antoine Pérouse de Montclos
La démocratisation « post-conflit » en Afrique centrale: les causes d'un échec, par Thierry Vircoulon
Les évolutions paradoxales de la démocratie mauritanienne, par Alain Antil
CONTRECHAMPS
À QUOI SERT LE G7 ?
De l'utilité du G7 : témoignage d'un sherpa, par Peter M. Boehm
Moscou et le G7 : un drame en trois actes, prologue, et épilogue, par Andrey Kortunov
ACTUALITÉS
Guerre au Yémen : an V, par François Frison-Roche (lire l'article)
Le djihadisme au Sahel après la chute de Daech, par Djallil Lounnas
Brésil : la politique étrangère de Jair Bolsonaro, par Mathilde Chatin
REPÈRES
Révolution numérique et transformation de l'action publique, par Carlos Santiso
LIBRES PROPOS
L'Union européenne vue de Russie, par Roman Volkov
L'après-poutinisme en Russie : une succession ouverte ?, par Vladimir Tchernega
LECTURES
Sous la responsabilité de Marc Hecker
The Empty Throne: America's Abdication of Global Leadership, de Ivo Daalder et James Lindsay
A New Foreign Policy: Beyond American Exceptionalism, de Jeffrey D. Sachs
The Jungle Grows Back: America and Our Imperiled World, de Robert Kagan
Par Laurence Nardon

Contenu disponible en :
Régions et thématiques
ISBN / ISSN
Utilisation
Comment citer cette publicationPartager
Téléchargez l'analyse complète
Cette page ne contient qu'un résumé de notre travail. Si vous souhaitez avoir accès à toutes les informations de notre recherche sur le sujet, vous pouvez télécharger la version complète au format PDF.
La démocratie en Afrique : tours et détours
Centres et programmes liés
Découvrez nos autres centres et programmes de rechercheEn savoir plus
Découvrir toutes nos analysesNouvelle commission de l’Union africaine de Mahamoud Ali Youssouf. Le désenchantement des pays membres
La candidature de Raila Odinga, sans expérience diplomatique et tourné vers la politique nationale, affaiblit la crédibilité de l’institution. L’enseignement principal de cette élection est que l’Union africaine (UA), dans sa forme actuelle, ne véhicule plus le même enthousiasme que lors des premières années de la réforme initiée en 2018. Celle-ci avait notamment pour but de mettre en place une organisation plus efficace et d’atteindre une plus grande indépendance financière.
Éthiopie-Somalie : une paix sous patronage turc
Après une année de tensions dans la Corne de l’Afrique, 2024 s’est conclue par un apaisement diplomatique entre l’Éthiopie et la Somalie, ouvrant l’année 2025 sur des perspectives politiques régionales encourageantes.
Relations anglo-kényanes (1920-2024) : conflit, alliance et un arc rédempteur
Cet article propose une analyse des relations diplomatiques à l’ère postcoloniale entre le Royaume-Uni et l’une de ses anciennes colonies de peuplement, le Kenya.
La diplomatie, un outil pour aider les villes à gérer les risques géopolitiques
Les crises et la polarisation croissante des relations internationales font de l'analyse des risques politiques une ressource indispensable pour les entités publiques et privées actives au niveau international.











