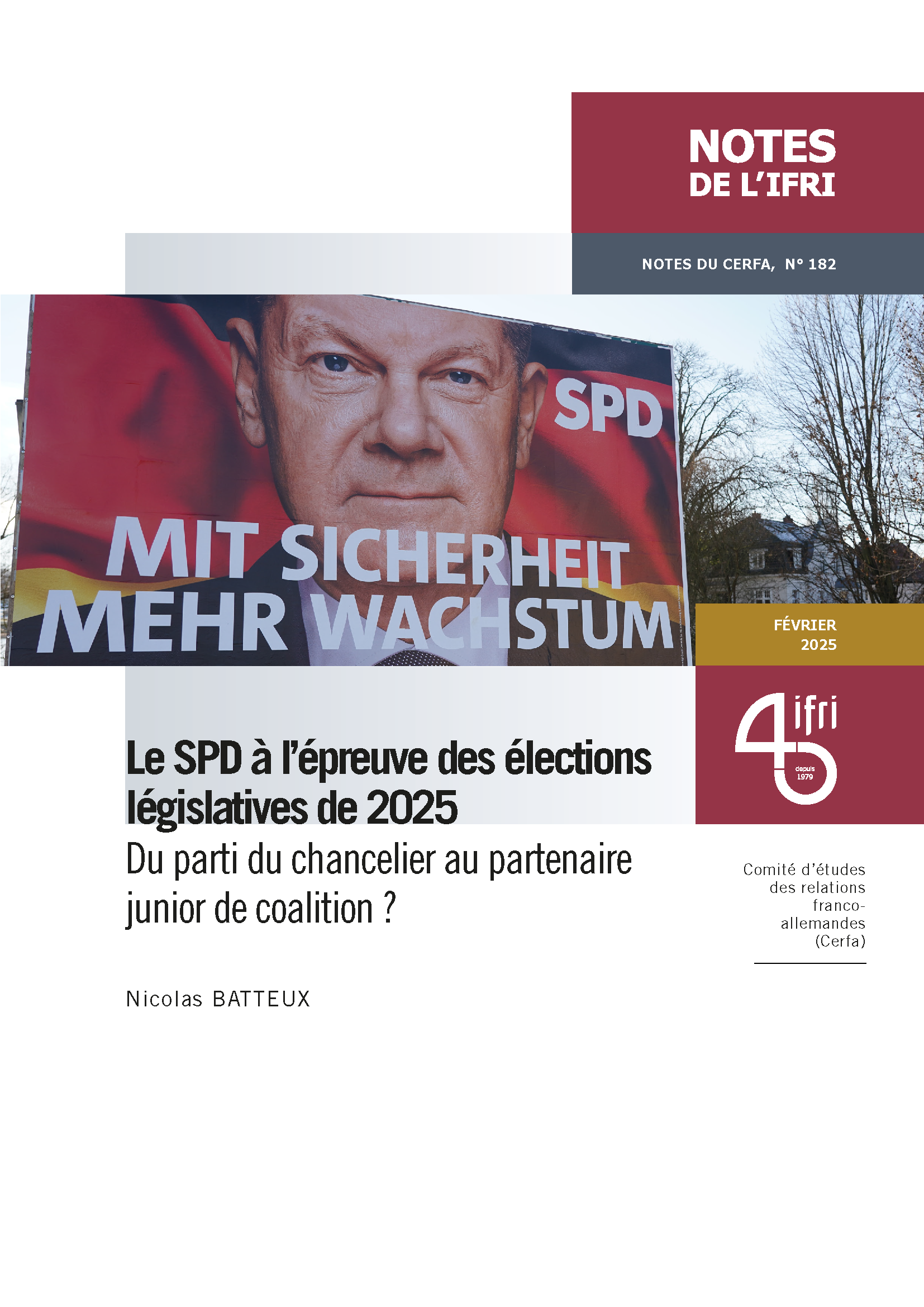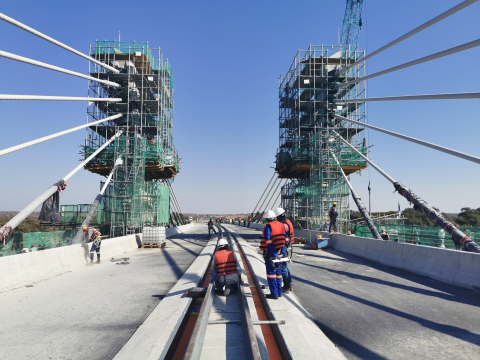Thierry de Montbrial : « Une Sainte-Alliance des démocraties libérales »
Pour Thierry de Montbrial, fondateur et président de l’Institut français des relations internationales, il ne faut pas attendre d’inflexion majeure dans les relations Europe - États-Unis, à la suite de l’élection de Joe Biden. Si le ton va changer, la priorité américaine demeure chinoise.
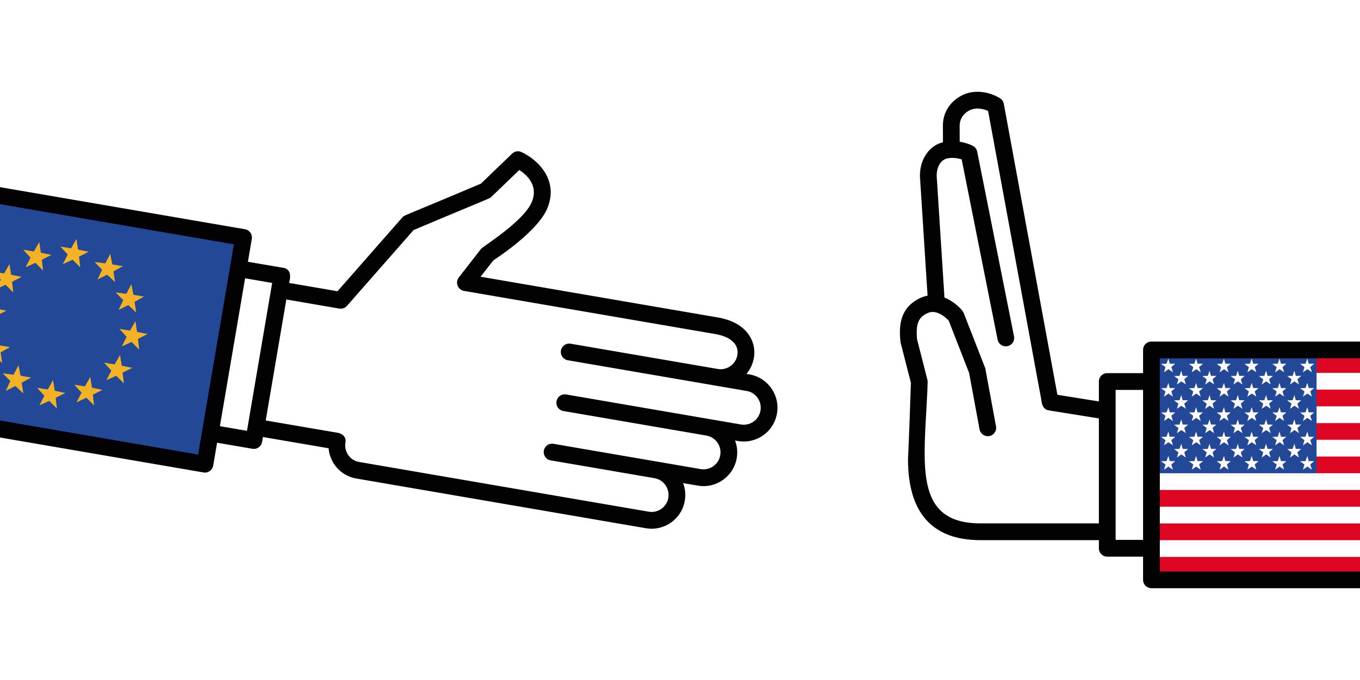
SAY : En Europe, le soulagement a été unanime lors de l'élection de Joe Biden. Son administration marquera-t-elle un renouveau des relations de proximité avec l’Europe ?
TH. de M. : En apparence, oui. Mais les tendances lourdes l'emporteront toujours et la présidence de Joe Biden aura pour toile de fond la pandémie et la Chine. L’appartenance de Joe Biden à la vieille école, le fait qu’Anthony Blinken, chef de la diplomatie, parle français comme vous et moi... rien de tout cela ne changera les intérêts américains. Les personnalités ont beau jouer un rôle important dans l'histoire, elles s'adaptent à la réalité.
Or, le phénomène international dominant du XXIe siècle, c'est la montée en puissance de la Chine. Sauf accident toujours possible, celle-ci dispose de tous les atouts pour devenir la première puissance mondiale. Elle s’est même donné une échéance précise pour cela : au plus tard 2049, le centième anniversaire de la victoire de Mao Zedong. C’est un défi majeur pour les Américains. Lorsqu'en décembre 1991, l'Union Soviétique s'est écroulée, donnant naissance au nouveau monde dans lequel nous vivons actuellement, la Chine avait déjà commencé à décoller. Déjà, en 2000, lorsque George W. Bush a été élu, le dossier prioritaire que la CIA lui avait présenté concernait la Chine.
Les attentats du 11 septembre ont détourné l'attention générale vers la radicalisation islamiste, mais la priorité est revenue en force. L’Europe est passée au second plan. L'élection de Joe Biden n'y changera rien.
En outre, Kamala Harris jouera certainement un rôle important pendant la présidence Biden. Le président a lui-même déclaré qu'il ne briguerait pas un second mandat et qu'il ferait réellement tandem avec sa vice-présidente. Elle sera probablement associée aux processus de décision, voyagera davantage et assumera des missions diplomatiques. Or, Kamala Harris, qui sera normalement la candidate démocrate dans quatre ans, représente l'Amérique du XXIe siècle qui a largement perdu ses racines européennes et sa proximité culturelle avec le vieux continent.
SAY : Comment interpréter alors l'arrêt du retrait partiel des troupes américaines d'Allemagne?
TH. de M. : Joe Biden envoie un signal à tous les Européens qui croient au retour des bonnes vielles relations transatlantiques : il leur signifie qu'il n'est pas souhaitable qu’ils se lancent dans des aventures comme celle de l'autonomie stratégique. Les Américains ont toujours été extrêmement réservés face à toute velléité de puissance européenne. Ils étaient par exemple vent debout contre l'euro, considéré comme un potentiel instrument de puissance. Pour eux, l’Union européenne et l'Alliance atlantique sont deux facettes d'une même réalité : ils parlent d’ailleurs d'institutions euro-atlantiques.
Je pense que le projet américain non encore formulé explicitement consiste à transformer l'Alliance atlantique en une sorte de Sainte-Alliance des démocraties libérales – au sens large – contre le collectif des États autoritaires et illibéraux, au premier rang desquels, la Chine. Et les États-Unis, république impériale (comme disait Raymond Aron) qui se veut maîtresse du jeu sur le plan de la sécurité, entend que les Européens la suivent. Mais cela risque de coincer : nous n'accepterons pas facilement de devenir encore plus dépendants des Etats-Unis qu’à l'époque soviétique, où c'était le prix à payer pour le protectorat américain. Depuis la chute de l'URSS, l'Alliance atlantique connaît les plus grandes difficultés à désigner l'ennemi. La Russie post-soviétique n'est que l'ombre de ce que fut l’Union soviétique.
SAY : Cela pose la question de l’unité des Européens. Par ses excès, Trump avait poussé les pays européens à se coaliser : Josep Borrell parle de l’entrée de l’Europe dans la politique de puissance ; Emmanuel Macron invoque la souveraineté européenne. L’arrivée à la Maison-Blanche d’un « président normal » pourrait-elle tout remettre en cause ?
TH. de M. : Oui, sans doute. Il faut voir que Josep Borrell ne parle pas la langue de bois des atlantistes traditionnels. En cela, il rejoint les Français, qui ont toujours tenu le discours de l'Europe puissance. Mais la plupart des Européens, Allemands, Italiens et a fortiori Polonais, ne souhaitent en aucune manière déplaire aux États-Unis. La politique « anormale » de Trump les avait forcés, la mort dans l'âme, à envisager l’hypothèse d'une autonomie européenne. En réalité, ils n'ont pas envie de s'y engager sérieusement. C'est pourquoi l'annonce de l'élection de Joe Biden a provoqué, pourrait-on dire, un lâche soulagement. Même quand ils se rendent compte que la prise de distance avec les États-Unis est inéluctable.
SAY : Les accords de Paris : au moins un intérêt commun ?
TH. de M. : La lutte contre le réchauffement climatique est l'un des rares sujets à propos desquels on peut parler de bien commun de l’humanité. Rompant avec Donald Trump, Joe Biden rejoint une vision de l'avenir partagée par la majorité des États. Toutefois, le fait que les États-Unis reviennent dans les accords de Paris ne constitue pas vraiment un acte diplomatique marquant. Il s'agit de déclarations d'intentions, d'engagements pris à de très longues échéances. Cela n'est pas comparable à un traité au sens traditionnel du terme, comme celui sur le nucléaire en Iran. Dans cette affaire, les Etats-Unis vont reconsidérer leur politique énergétique dans le sens de leurs intérêts à long terme.
SAY : La détente dans les relations commerciales, pour tourner la page de la pandémie, peut-il en être un autre, si la taxations des Gafam ne vient pas tout empoisonner ?
TH. de M. : Joe Biden n’a pas levé les taxes mises en place par Trump sur des produits européens. Mais il s'agit là de différends qui devraient s'aplanir dans le cadre de l'OMC. Le commerce n'est qu'une façon de voir les choses : le véritable protectionnisme, c'est celui des investissements. Il n'y a jamais eu d'accord international dans ce domaine. Quoi qu’on en dise, les entreprises ont une nationalité. Les Américains ont toujours su préserver leurs entreprises et empêcher un rachat, si cela affectait leurs intérêts stratégiques. En revanche, les Européens ont jusqu’à présent fait preuve d’un véritable aveuglement dans ce domaine. Ce n’est qu’aujourd'hui, avec la pandémie et la Chine, que l’on redécouvre la notion d'intérêt national dans le domaine économique.
Quant aux grandes plates-formes numériques, on peut craindre que la montagne n’accouche d’une souris. Il est délicat d'anticiper le résultat de négociations en cours à l'OCDE, mais il semble probable que l'on n’arrive qu’à un accord a minima. Les États-Unis continueront à défendre leurs intérêts bec et ongles. Et en face, les Européens qui renâclent à aller vers une politique fiscale cohérente entre eux, sont désunis. De plus, le Royaume-Uni est en train d'envisager un cadre fiscal qui casse les reins de l'Union Européenne.
SAY : Pourtant, les relations entre Joe Biden et Boris Johnson semblent tout sauf idylliques…
TH. de M. : C'est un signal qui indique qu’au moins sur un point on revient au monde d'avant Trump, qui favorisait la multiplication dans la politique internationale de populistes à son image. Le nouveau président montre qu'il est temps de revenir aux règles de la politesse en matière de diplomatie. Le protocole est très important dans les relations internationales. Boris Johnson, qui comptait sur la réélection de Trump pour faire des deals, devra adapter son comportement.

Propos recueillis par Anne Daubrée et Jean Rognetta
> Lire l'intégralité de l'entretien sur le site de la revue SAY

Média
Partager