Réduire la taille des portions : Les guerres alimentaires aux États-Unis
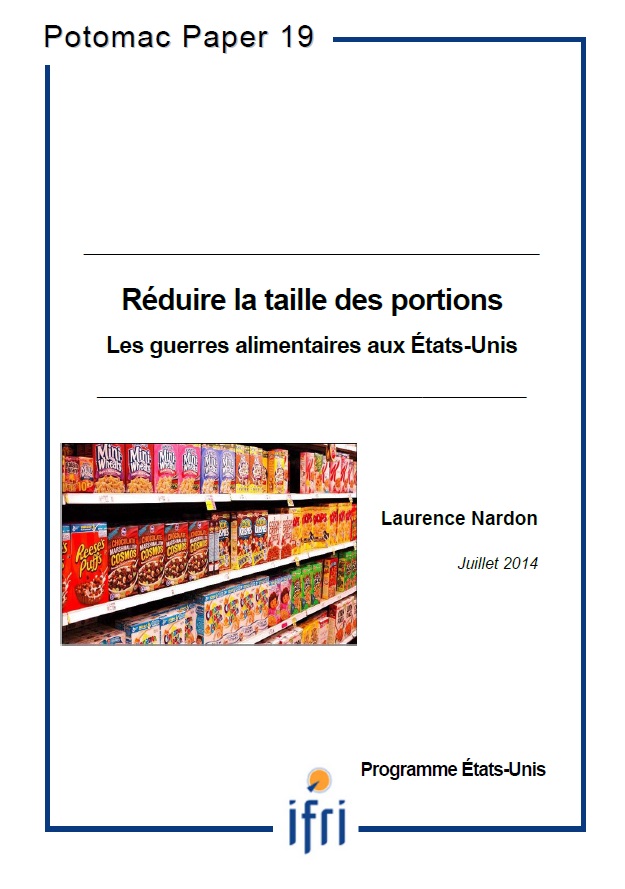
A l'heure des négociations sur le TTIP, l'industrie agro-alimentaire américaine fait peur aux Européens. Ayant mis au point des pratiques marketing et des produits alimentaires également malsains, elle est tenue en grande partie responsable de l'épidémie d'obésité qui frappe les Etats-Unis depuis les années 1980. Or, la société civile américaine s'est organisée et les industriels doivent désormais se montrer plus prudents. Quel est l'état du rapport de force aujourd'hui ?
Un vaste processus d’industrialisation de la production de nourriture a démarré aux États-Unis à la fin du XIXe siècle, renforcé par l’apparition des fast-foods dans l’après-guerre.
Dans les années 1970 et 1980, la consommation de junk food s’emballe, entraînée par la mode du supersizing. Consistant à proposer des portions démesurées à un prix réduit, cette technique marketing est rendue possible par l’adoption d’une nouvelle politique agricole qui subventionne la production de maïs et de soja. Son succès tient aussi à la baisse du niveau de vie des petites classes moyennes et l’apparition des « travailleurs pauvres » qui ne peuvent s’offrir qu’une nourriture de mauvaise qualité.
Dans les années 1980, les chiffres de l’obésité explosent. Inégalement répartie dans la population, celle-ci touche surtout les plus pauvres et les plus vulnérables. Elle est donc statistiquement plus élevée dans les communautés noires et latinos. En 2012, 34,9% de la population américaine adulte est obèse et l’épidémie s’est répandue dans le monde entier.
À partir des années 2000, experts et journalistes sonnent l’alarme et la population commence à prendre conscience du problème. Une légère modification des habitudes semble d’ailleurs avoir récemment entraîné un ralentissement de l’épidémie. Mais le problème n’est pas réglé pour autant.
Pour les plus radicaux des food activists, il faut non seulement effacer de la prochaine Farm Bill les subventions fédérales aux grandes exploitations de maïs et de soja, mais aussi rehausser le salaire minimum dans tout le pays. Une réglementation de la publicité pour la junk food, notamment lorsqu’elle cible les minorités, est également proposée sur le modèle des interdictions imposées à l’industrie du tabac.
Les conservateurs, hostiles par principe aux réglementations, préfèrent laisser les individus et les entreprises prendre leurs responsabilités. L’effort lancé en 2010 par la first lady Michelle Obama se situe plutôt sur cette ligne. Elle encourage d’une part la poursuite de larges programmes d’éducation nutritionnelle, et d’autre part le dialogue avec les acteurs du secteur agroalimentaire.
Ces derniers sont bien conscients que leur image est désormais écornée. Ils semblent hésiter entre un lobbying résolu contre toute atteinte à leur business model, et la recherche de bonne foi de solutions qui respectent à la fois leurs intérêts et la santé publique.

Contenu disponible en :
Régions et thématiques
ISBN / ISSN
Utilisation
Comment citer cette publicationPartager
Téléchargez l'analyse complète
Cette page ne contient qu'un résumé de notre travail. Si vous souhaitez avoir accès à toutes les informations de notre recherche sur le sujet, vous pouvez télécharger la version complète au format PDF.
Réduire la taille des portions : Les guerres alimentaires aux États-Unis
Centres et programmes liés
Découvrez nos autres centres et programmes de rechercheEn savoir plus
Découvrir toutes nos analysesL’eau au Mexique : une urgence, qui attendra
L’accès à l’eau est déjà et va devenir de plus en plus problématique pour les acteurs économiques mexicains, en raison de la raréfaction progressive de la ressource résultant du changement climatique, d’une répartition géographique qui ne coïncide ni avec celle de la population, ni avec celle de l’activité économique, et d’une gestion jusqu’ici bien trop laxiste.
Les migrations entre le Mexique et les États-Unis : "más de los mismo" ou fuite en avant ?
Alors que Trump s’apprête à renforcer les contrôles à la frontière avec le Mexique et expulser massivement les immigrés illégaux, le Mexique s’interroge sur les conséquences économiques de cette politique migratoire, et s’attend à devoir négocier cette question en lien avec les tarifs douaniers engagés par l’administration Trump.
Canada : le grand réveil ?
Le modèle économique canadien – voire le modèle canadien plus largement –, est traversé depuis sa création en 1867 de tensions inhérentes qui semblent avoir empêché, jusqu’à aujourd’hui, la réalisation de son plein potentiel. Chef du Service économique régional (SER) de l’ambassade de France à Ottawa, Morgan Larhant en dénombre cinq, liées aux matières premières, à la proximité des États-Unis, au manque d’intégration entre les 13 provinces et territoires, au fonctionnement du système fédéral, et à l’importance de l’immigration, comme source de son développement.
Donald Trump contre les États fédérés : le cas de New York
Si les politiques disruptives de l’administration Trump 2 se déploient au niveau fédéral et sur la scène internationale, elles se font également sentir dans les États fédérés et les grandes villes du pays. Au printemps 2025, plusieurs affaires concernant l’État et la ville de New York démontrent ainsi que les attaques du camp présidentiel contre la protection de l’environnement, la séparation des pouvoirs, la liberté d’expression, etc., sont également engagées au niveau local.













