RDC : le changement à pas feutrés
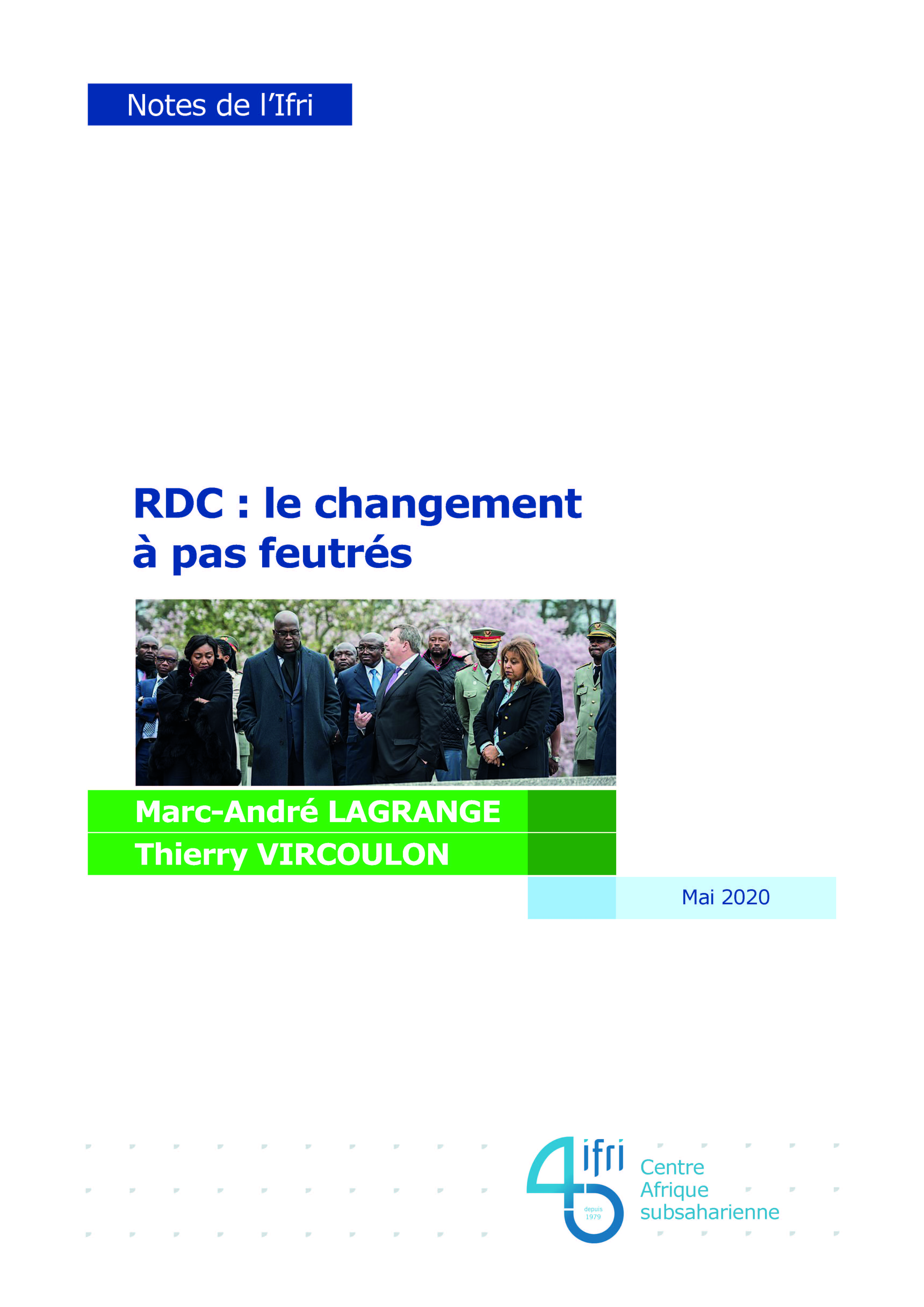
Depuis qu’il est devenu le président de la République Démocratique du Congo (RDC) le 24 janvier 2019 dans des circonstances controversées, Félix Tshisekedi essaie de convaincre qu’il incarne l’alternance, i.e l’espoir d’un développement de la RDC.

Mais ces élections frauduleuses ont abouti à une cohabitation insolite et non à un véritable changement de pouvoir. Étant de facto un président minoritaire, il se trouve face à la quadrature du cercle : il doit convaincre la population et les partenaires étrangers de sa capacité à changer le paradigme de gouvernance de la RDC tout en composant avec le clan Kabila et ses intérêts. L’euphorie de la première passation de pouvoir pacifique de l’histoire de la RDC est vite retombée au fur et à mesure que se dessinaient les contours de la cohabitation entre le Front Commun pour le Congo (FCC), pro-Kabila, et la coalition Cap pour le Changement (CACH), pro-Tshisekedi, et que s’instaurait un rapport de force politico-institutionnel défavorable au président. Un an après sa prestation de serment, force est de reconnaître que le changement promis se réduit à des effets d’annonce et au recyclage de promesses, d’idées et de projets laissés en jachère par les gouvernements précédents. Ainsi, la désillusion et la frustration des Congolais sont déjà perceptibles et risquent d’être exacerbées par la crise mondiale du COVID-19.

Contenu disponible en :
Régions et thématiques
ISBN / ISSN
Utilisation
Comment citer cette publicationPartager
Téléchargez l'analyse complète
Cette page ne contient qu'un résumé de notre travail. Si vous souhaitez avoir accès à toutes les informations de notre recherche sur le sujet, vous pouvez télécharger la version complète au format PDF.
RDC : le changement à pas feutrés
Centres et programmes liés
Découvrez nos autres centres et programmes de rechercheEn savoir plus
Découvrir toutes nos analysesNouvelle commission de l’Union africaine de Mahamoud Ali Youssouf. Le désenchantement des pays membres
La candidature de Raila Odinga, sans expérience diplomatique et tourné vers la politique nationale, affaiblit la crédibilité de l’institution. L’enseignement principal de cette élection est que l’Union africaine (UA), dans sa forme actuelle, ne véhicule plus le même enthousiasme que lors des premières années de la réforme initiée en 2018. Celle-ci avait notamment pour but de mettre en place une organisation plus efficace et d’atteindre une plus grande indépendance financière.
Éthiopie-Somalie : une paix sous patronage turc
Après une année de tensions dans la Corne de l’Afrique, 2024 s’est conclue par un apaisement diplomatique entre l’Éthiopie et la Somalie, ouvrant l’année 2025 sur des perspectives politiques régionales encourageantes.
Relations anglo-kényanes (1920-2024) : conflit, alliance et un arc rédempteur
Cet article propose une analyse des relations diplomatiques à l’ère postcoloniale entre le Royaume-Uni et l’une de ses anciennes colonies de peuplement, le Kenya.
La diplomatie, un outil pour aider les villes à gérer les risques géopolitiques
Les crises et la polarisation croissante des relations internationales font de l'analyse des risques politiques une ressource indispensable pour les entités publiques et privées actives au niveau international.













