Politique budgétaire en France et en Allemagne : des divergences insurmontables ?
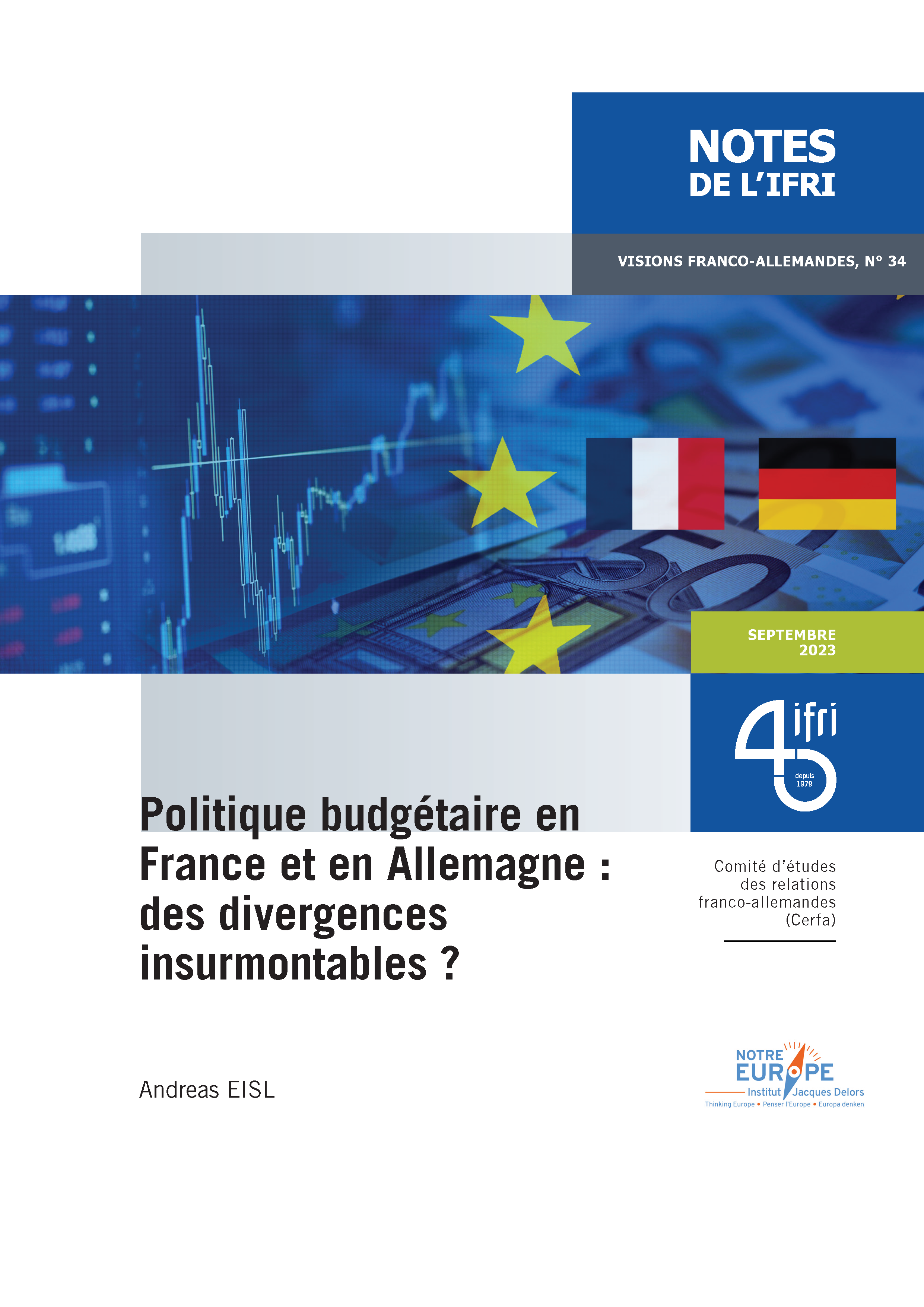
On a souvent tendance à opposer la situation des finances publiques en France et en Allemagne. Cette dernière est considérée comme un modèle de rigueur, à travers sa capacité à contenir ses déficits et à dégager des excédents, notamment entre 2012 et 2019, grâce à l’introduction dans sa constitution d’un mécanisme de frein à l’endettement.

A l’inverse, la France fait figure de mauvais élève, avec un budget régulièrement en déficit depuis 1975. C’est toutefois à partir du milieu des années 2000 que les trajectoires budgétaires des deux pays ont nettement divergé, ce qui se mesure à travers le solde budgétaire et le niveau de la dette publique.
Pour autant, dans le contexte de polycrise que connaît l’Europe depuis la crise de la zone euro en 2010, jusqu’à la guerre d’Ukraine en 2022, en passant par la pandémie de Covid-19, les conséquences de la gestion de la dette publique se traduisent de façon différente dans chaque pays. La réalité est plus nuancée au regard des effets produits par les politiques suivies :
Côté allemand, des investissements publics trop faibles qui pèsent aujourd’hui sur la qualité des infrastructures, notamment dans l’énergie et les transports, mais aussi le niveau opérationnel des armées. Des excédents qui reposaient sur un modèle de croissance, désormais fortement exposé aux risques internationaux, et une réticence face au renforcement de la coordination de la politique économique au niveau européen.
Côté français, une vulnérabilité budgétaire qui s’est amplifiée dans la période actuelle, marquée par une faible croissance et une forte augmentation des taux d’intérêt, après une longue période de taux nuls, voire négatifs.
Alors que les besoins de financement sont considérables dans les deux pays comme dans l’ensemble de l’Europe, pour achever la transition énergétique, relocaliser certaines productions et renforcer la défense, quelles mesures de politique budgétaire l’Allemagne et la France devraient-elles prendre et quels sont les points de convergence possibles ? Des compromis sont indispensables pour assurer la réforme du Pacte de stabilité et de croissance et, au-delà, pour assurer une meilleure gouvernance de la politique économique européenne.
- Cette note a été rédigée en partenariat avec l'Institut Jacques Delors, un think tank européen.
Andreas Eisl est chercheur en politique économique européenne à l'Institut Jacques Delors et chercheur associé à l'Institut d'études politiques de Paris (Sciences Po).
Cette publication est également disponible en allemand : Unüberwindbare Divergenzen in der Haushaltspolitik Deutschlands und Frankreichs? (pdf)

Contenu disponible en :
Régions et thématiques
ISBN / ISSN
Utilisation
Comment citer cette publicationPartager
Téléchargez l'analyse complète
Cette page ne contient qu'un résumé de notre travail. Si vous souhaitez avoir accès à toutes les informations de notre recherche sur le sujet, vous pouvez télécharger la version complète au format PDF.
Politique budgétaire en France et en Allemagne : des divergences insurmontables ?
Centres et programmes liés
Découvrez nos autres centres et programmes de rechercheEn savoir plus
Découvrir toutes nos analysesPerspectives françaises et allemandes face aux défis géopolitiques dans le contexte de l’agression russe contre l’Ukraine
Les politiques étrangères, de défense et de sécurité de la France et l’Allemagne évoluent dans un contexte très tendu, marqué par le retour de conflits à haute intensité. Impensable au lendemain de la chute du Mur de Berlin qui symbolise la fin du conflit Est-Ouest, la guerre est aujourd’hui de retour en Europe, alors que les espaces terrestres et maritimes qui entourent le continent européen, de l’Arctique à l’Afrique en passant par le Moyen-Orient, sont devenus des théâtres de rivalité géopolitique, de guerres civiles et de conflits aussi bien hybrides que militaires.
La brigade franco-allemande et la relance de la défense européenne
Une chose est claire depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche : le projet d’unification européenne est menacé dans son existence même. À moins d’élaborer une politique de défense souveraine pour parer à la guerre en Ukraine et à l’affaiblissement des garanties de sécurité américaines, l’Union européenne verra se poursuivre l’érosion de sa dynamique de cohésion interne et de son attractivité externe.
Friedrich Merz et la Zeitenwende 2.0. Une « nouvelle ère » pour les relations transatlantiques ?
Le 23 février 2025, près de 60 millions d’électeurs ont été appelés à élire un nouveau Bundestag. Ces élections donneront également naissance à un nouveau gouvernement dans la première économie d’Europe.
Après les élections : l’Allemagne en quête d’une stabilité ébranlée ?
Avec 82,5 % de participation, l’Allemagne a enregistré un taux de mobilisation inédit depuis 1987, une hausse de 6,1 points par rapport à 2021. Comme en 2021, cette forte participation a profité à l’Alternative pour l’Allemagne (AfD), qui a su mobiliser un grand nombre d’anciens abstentionnistes.











