Où va l'École américaine ?
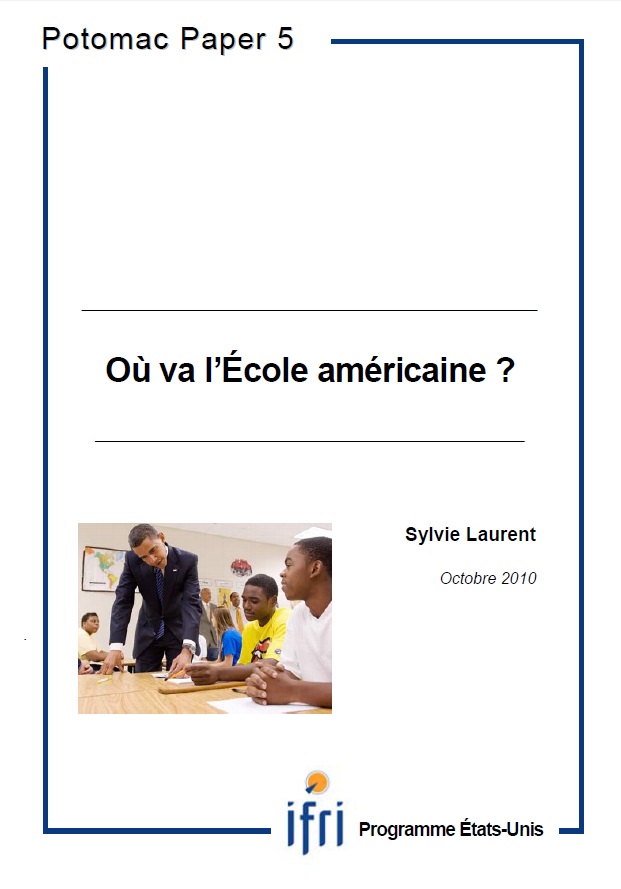
La réforme de l'école secondaire est un chantier peu remarqué à l'étranger, mais central dans le projet du président Obama. Pour remédier aux mauvais résultats de nombreux collèges et lycées publics, notamment auprès des minorités, l'administration introduit des méthodes de gestion inspirées du secteur privé. Cette démarche, qui se situe dans la continuité des politiques précédentes, ne peut manquer de frapper des observateurs français.
Depuis deux ans, les États-Unis sont engagés dans une réforme rigoureuse de l’école secondaire qui suscite la controverse parmi les progressistes. Les maîtres mots de la réforme scolaire de Barack Obama feraient frissonner en France : concurrence entre les établissements pour obtenir un financement public, renforcement des charter schools au fonctionnement autonome, évaluation des résultats pédagogiques, paie au mérite pour des enseignants du secondaire qui doivent renoncer à l’emploi à vie et accepter d’être renvoyés en cas d’« incompétence »… L’école doit rechercher son efficacité dans les méthodes du secteur privé et surtout elle doit rendre des comptes : accountability, tel est le maître mot de la réforme.
L’école américaine est, il est vrai, incapable d’offrir les mêmes opportunités à tous ses élèves : un enfant pauvre n’a qu’une chance sur dix d’accéder à l’université, bien moins encore s‘il est de couleur. Au centre du mouvement des réformes éducatives se trouve donc l’ambition exprimée depuis 30 ans de réduire l’achievement gap (« écart de réussite ») entre les élèves défavorisés et les autres, sous-tendu par la question raciale. Ce déni démocratique que constitue la condamnation à l’échec des jeunes noirs et/ou latinos est le grand arrière-plan de la réforme.
L’État fédéral est fortement prescripteur dans le secteur de l’éducation. La réforme de l’école telle qu’elle est proposée par B. Obama – et son secrétaire d’État à l’Éducation, Arne Duncan – s’inscrit d’ailleurs dans la continuité de la politique de son prédécesseur, qui avait lancé la réforme No Child Left Behind en 2002. Cependant, la gestion administrative, comme financière, de l’Éducation secondaire incombe aux États fédérés dont les difficultés financières aggravent bien entendu la situation.
Cette réforme radicale de l’Éducation a sans doute beaucoup moins attiré l’attention internationale que les réformes de l’assurance maladie et du système financier. C’est pourtant, peut-être, le chantier le plus décisif d’une présidence Obama qui se veut résolument transformatrice.

Contenu disponible en :
Régions et thématiques
Utilisation
Comment citer cette publicationPartager
Téléchargez l'analyse complète
Cette page ne contient qu'un résumé de notre travail. Si vous souhaitez avoir accès à toutes les informations de notre recherche sur le sujet, vous pouvez télécharger la version complète au format PDF.
Où va l'École américaine ?
Centres et programmes liés
Découvrez nos autres centres et programmes de rechercheEn savoir plus
Découvrir toutes nos analysesLes migrations entre le Mexique et les États-Unis : "más de los mismo" ou fuite en avant ?
Alors que Trump s’apprête à renforcer les contrôles à la frontière avec le Mexique et expulser massivement les immigrés illégaux, le Mexique s’interroge sur les conséquences économiques de cette politique migratoire, et s’attend à devoir négocier cette question en lien avec les tarifs douaniers engagés par l’administration Trump.
Canada : le grand réveil ?
Le modèle économique canadien – voire le modèle canadien plus largement –, est traversé depuis sa création en 1867 de tensions inhérentes qui semblent avoir empêché, jusqu’à aujourd’hui, la réalisation de son plein potentiel. Chef du Service économique régional (SER) de l’ambassade de France à Ottawa, Morgan Larhant en dénombre cinq, liées aux matières premières, à la proximité des États-Unis, au manque d’intégration entre les 13 provinces et territoires, au fonctionnement du système fédéral, et à l’importance de l’immigration, comme source de son développement.
Donald Trump contre les États fédérés : le cas de New York
Si les politiques disruptives de l’administration Trump 2 se déploient au niveau fédéral et sur la scène internationale, elles se font également sentir dans les États fédérés et les grandes villes du pays. Au printemps 2025, plusieurs affaires concernant l’État et la ville de New York démontrent ainsi que les attaques du camp présidentiel contre la protection de l’environnement, la séparation des pouvoirs, la liberté d’expression, etc., sont également engagées au niveau local.
Les États-Unis de Trump, adversaires stratégiques et idéologiques de l’Europe
Le pire cauchemar sécuritaire des Européens semble se produire : mardi 18 février 2025, les ministres des affaires étrangères américain et russe Marco Rubio et Sergueï Lavrov se sont retrouvés en Arabie saoudite pour engager la normalisation des relations entre leurs deux pays. La réunion avait aussi pour objectif de mettre en place des négociations de paix pour l’Ukraine. Susceptibles d’affecter tout le vieux continent, les échanges se sont néanmoins déroulés sans les Européens ni les Ukrainiens.













