L’opposition burundaise en exil
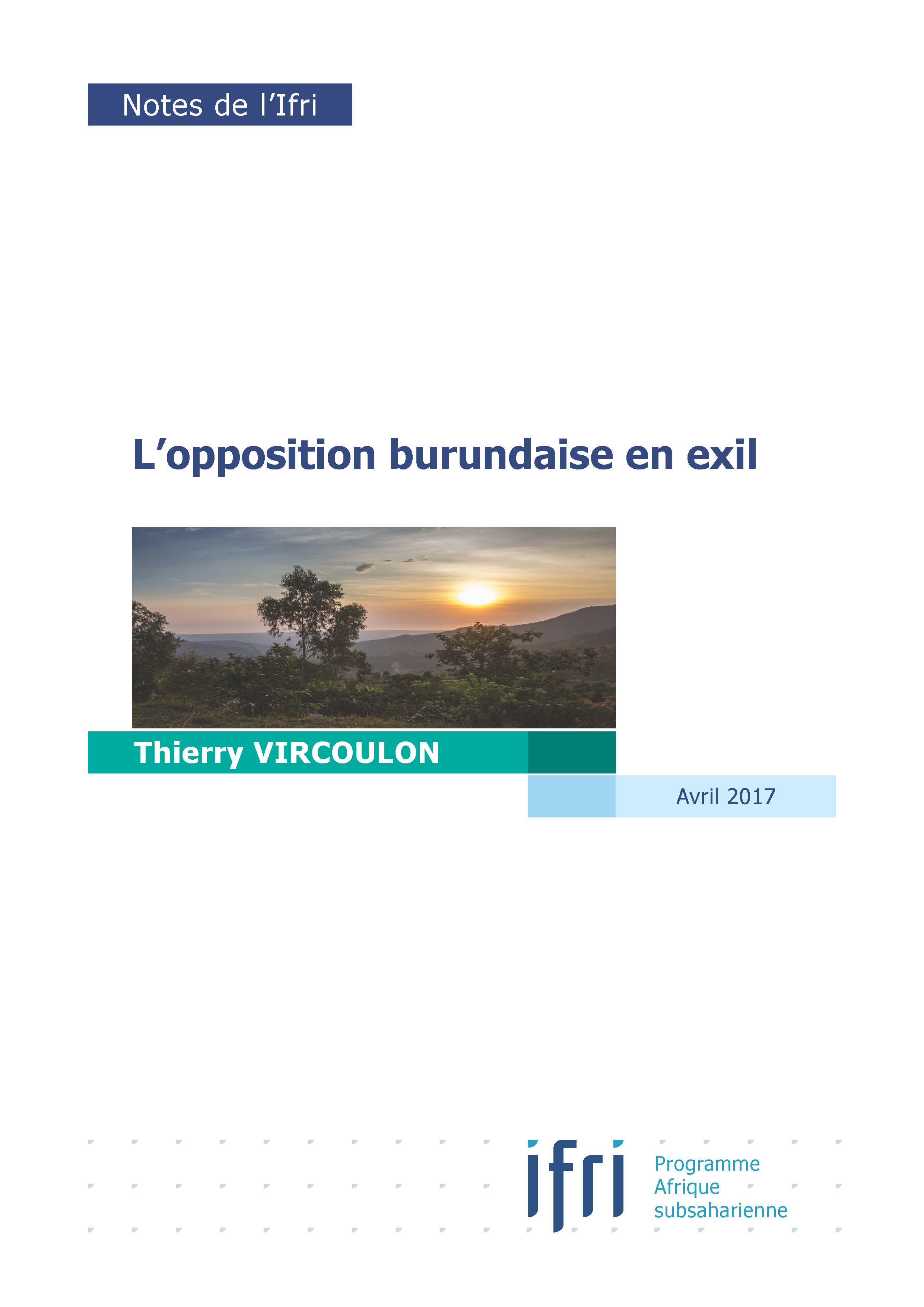
Dès 2015, la crise burundaise a jeté sur les chemins de l’exil presque tous les politiciens et leaders de la société civile. Deux principales vagues de départ ont eu lieu.

D’abord celle des « frondeurs » : il s’agit des cadres du Conseil national pour la défense de la démocratie-Forces de défense de la démocratie (CNDD-FDD) qui s’opposaient à la candidature du président Pierre Nkurunziza pour un troisième mandat, et qui ont quitté le pays après l’annonce de sa candidature (fin avril/début mai 2015).Puis une seconde vague de départs composée d’officiers et de responsables de l’opposition et de la société civile a été déclenchée par le putsch manqué du 13 mai 2015 (seconde moitié de mai/début juin 2015). Les derniers exilés ont quitté le pays après le durcissement de la répression, l’échec des manifestations contre le troisième mandat et la réélection de Pierre Nkurunziza fin juillet 2015. Depuis lors, trois leaders de l’opposition vivent encore au Burundi : Léonce Ngendakumana du Front pour la démocratie du Burundi (FRODEBU), Charles Nditije de l’Union pour le progrès national (UPRONA) et Agathon Rwasa des Forces nationales de libération (FNL). Ils sont tous les trois hutus. Les autres grandes figures de l’opposition burundaise sont en exil entre l’Europe et l’Afrique où elles forment une nouvelle diaspora politique.
Les rangs de l’opposition en exil sont alimentés par le gouvernement dont la politique de répression permanente ne laisse le choix qu’entre le silence et l’exil. Par conséquent, les départs continuent et le nombre de réfugiés burundais a dépassé les 300 000 personnes en octobre 2016 pour atteindre les 328 000 au début de l’année 2017.
Dans l’urgence de la fuite, les opposants se sont dispersés en fonction de leurs ressources et de leurs réseaux familiaux ou amicaux. Les précédents conflits étant à l’origine d’une importante diaspora, de nombreux opposants avaient déjà vécu en exil et/ou avaient de la famille installée à l’étranger : ils se sont donc éparpillés de l’Australie au Canada en passant par l’Europe et l’Afrique. Ces réseaux diasporiques ont permis à beaucoup d’exilés politiques d’avoir un point de chute et ces derniers sont souvent revenus là où eux ou leur famille avaient déjà vécu en exil. De ce fait, bien que la géographie de la diaspora politique burundaise soit mondiale, elle a actuellement deux principaux pays de concentration : la Belgique et le Rwanda. Il y a également une importante diaspora burundaise au Canada, ce pays ayant eu une politique généreuse d’accueil des réfugiés burundais durant le précédent conflit.
Cette note présente les trois composantes de l’opposition en exil : les partis politiques, les groupes armés et les mouvements de la société civile. Ces trois composantes partagent un objectif commun, mettre fin au régime illégitime du président Pierre Nkurunziza, mais ils sont divers et seuls les mouvements de la société civile ont un succès notable en 2016.

Contenu disponible en :
Régions et thématiques
Utilisation
Comment citer cette publicationPartager
Téléchargez l'analyse complète
Cette page ne contient qu'un résumé de notre travail. Si vous souhaitez avoir accès à toutes les informations de notre recherche sur le sujet, vous pouvez télécharger la version complète au format PDF.
L’opposition burundaise en exil
Centres et programmes liés
Découvrez nos autres centres et programmes de rechercheEn savoir plus
Découvrir toutes nos analysesNouvelle commission de l’Union africaine de Mahamoud Ali Youssouf. Le désenchantement des pays membres
La candidature de Raila Odinga, sans expérience diplomatique et tourné vers la politique nationale, affaiblit la crédibilité de l’institution. L’enseignement principal de cette élection est que l’Union africaine (UA), dans sa forme actuelle, ne véhicule plus le même enthousiasme que lors des premières années de la réforme initiée en 2018. Celle-ci avait notamment pour but de mettre en place une organisation plus efficace et d’atteindre une plus grande indépendance financière.
Éthiopie-Somalie : une paix sous patronage turc
Après une année de tensions dans la Corne de l’Afrique, 2024 s’est conclue par un apaisement diplomatique entre l’Éthiopie et la Somalie, ouvrant l’année 2025 sur des perspectives politiques régionales encourageantes.
Relations anglo-kényanes (1920-2024) : conflit, alliance et un arc rédempteur
Cet article propose une analyse des relations diplomatiques à l’ère postcoloniale entre le Royaume-Uni et l’une de ses anciennes colonies de peuplement, le Kenya.
La diplomatie, un outil pour aider les villes à gérer les risques géopolitiques
Les crises et la polarisation croissante des relations internationales font de l'analyse des risques politiques une ressource indispensable pour les entités publiques et privées actives au niveau international.













