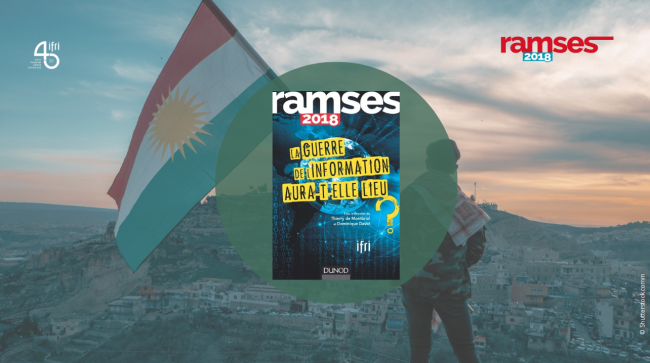Les coalitions partisanes en Turquie avant l’AKP, une culture politique inaccomplie
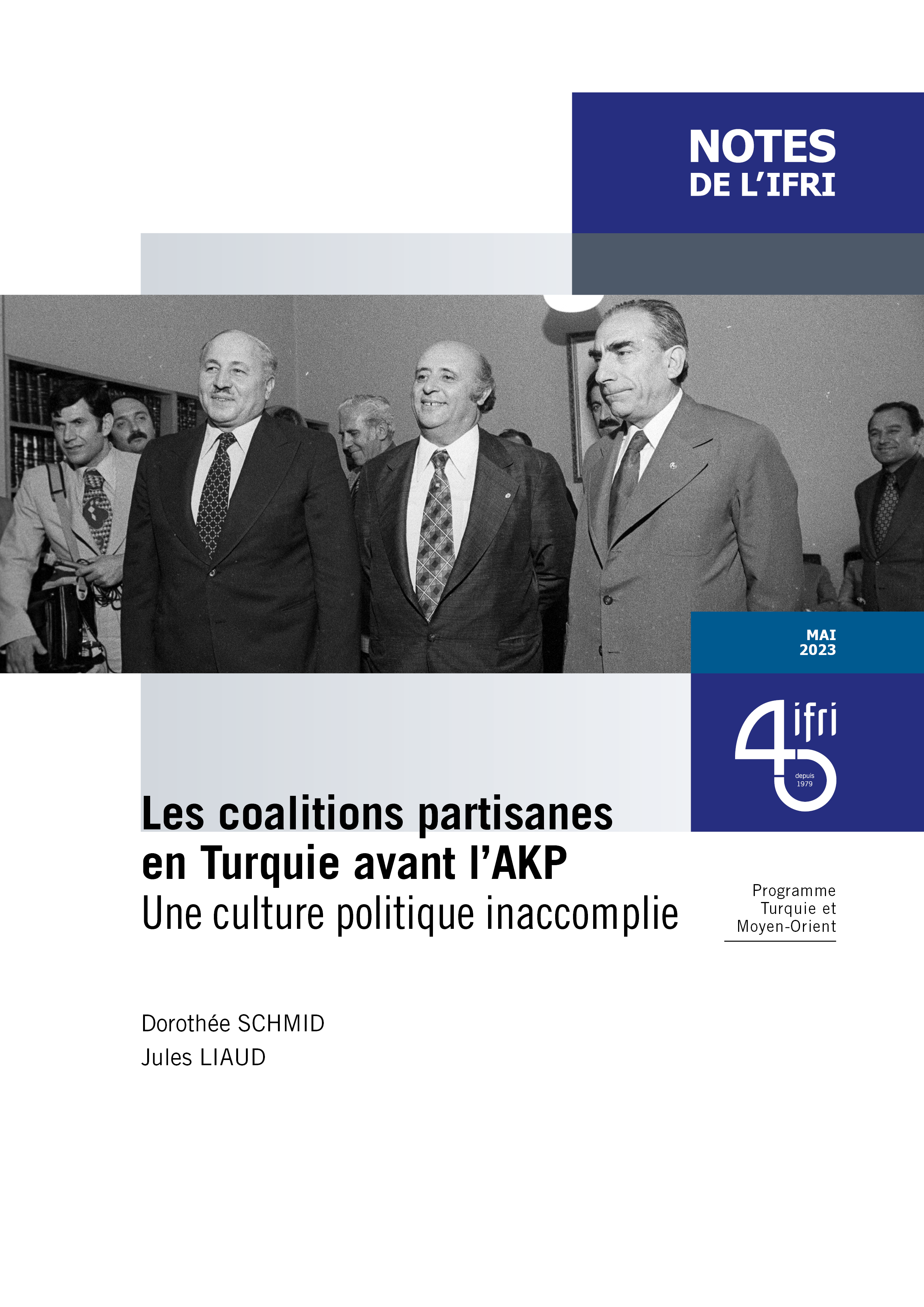
Les élections turques de 2023, un double scrutin présidentiel et parlementaire, coïncident avec le 100e anniversaire de la République fondée par Mustafa Kemal. Depuis la révision constitutionnelle de 2017, le régime parlementaire a été aboli en Turquie au profit d’un présidentialisme fort, faisant de l'élection présidentielle le moment charnière de la politique turque.

Cette élection se fait au suffrage universel seulement depuis 2014, et le système partisan s’adapte progressivement à ces nouvelles conditions. L’alliance de l’opposition s’est ainsi pour la première fois mise d’accord en 2023 sur un candidat commun.
Les alliances en vue des élections législatives ont en revanche une longue histoire en Turquie, qu’il convient de rappeler pour raisonner sur la dynamique présente. Nous nous intéresserons ici aux périodes où la vie politique turque a été dominée par des coalitions gouvernementales, depuis l’avènement du multipartisme à la fin des années 1940, jusqu’au triomphe du Parti de la justice et du développement (AKP) en 2002. Le parti de Recep Tayyip Erdoğan gouverne seul depuis cette date, sans avoir besoin de partenaires de coalition au sein du gouvernement, et en se présentant justement comme le garant de la stabilité du pays face au risque du désordre associé à ces dernières.
Il s’agit alors de saisir les raisons de l’instabilité gouvernementale au temps des coalitions, plus particulièrement dans les années 1970 et 1990. Trois grandes explications émergent : la fragmentation partisane du champ politique, sa polarisation idéologique, et enfin les défaillances du cadre institutionnel parlementariste. Ce bilan critique des coalitions ne doit cependant pas occulter leur apport dans le cadre d’une réflexion sur l’approfondissement démocratique. Les gouvernements multipartites permettent un partage du pouvoir dans les sociétés divisées et préviennent les dérives autoritaires. La mise en place d’un régime hyper-présidentiel en Turquie a progressivement marginalisé ce débat, qui ressurgit en 2023 grâce aux efforts de l’opposition pour s’unir et au souhait qu’elle exprime de revenir au parlementarisme.

Contenu disponible en :
Régions et thématiques
ISBN / ISSN
Utilisation
Comment citer cette publicationPartager
Téléchargez l'analyse complète
Cette page ne contient qu'un résumé de notre travail. Si vous souhaitez avoir accès à toutes les informations de notre recherche sur le sujet, vous pouvez télécharger la version complète au format PDF.
Les coalitions partisanes en Turquie avant l’AKP, une culture politique inaccomplie
Centres et programmes liés
Découvrez nos autres centres et programmes de rechercheEn savoir plus
Découvrir toutes nos analysesTurquie 2050 : Tourisme turc ; PKK ; enjeu spatial
Repères sur la Turquie n°27 - Le programme « Turquie 2050 » développe une analyse prospective sur les thèmes de la diplomatie, de la politique intérieure et de l’économie turques afin d’y anticiper les dynamiques des trente prochaines années.
Adiyaman, la « ville sans propriétaire » : récit d’une émancipation politique
La ville d’Adıyaman a fait les grands titres ces deux dernières années en raison d’une part de sa dévastation par le séisme du 6 février 2023 entre la Turquie et la Syrie et d’autre part de son tournant politique partisan après le scrutin municipal du 31 mars 2024.
Turquie 2050 : Enrichissement individuel en Turquie ; Mavi Vatan 2025 ; forêt de Belgrade
Repères sur la Turquie n°26 - Le programme « Turquie 2050 » développe une analyse prospective sur les thèmes de la diplomatie, de la politique intérieure et de l’économie turques afin d’y anticiper les dynamiques des trente prochaines années.
Les fragilités du Kurdistan irakien
Le Kurdistan irakien arbore les institutions d’un État. Mais ses divisions politiques et ses faiblesses économiques minent ses prétentions à plus d’autonomie. Ses relations avec les acteurs de la région et au-delà ne semblent guère pouvoir concrétiser un appui à une marche vers l’indépendance qui demeure incertaine.