Entre soutien et conflits, les échanges agricoles transatlantiques depuis 1945
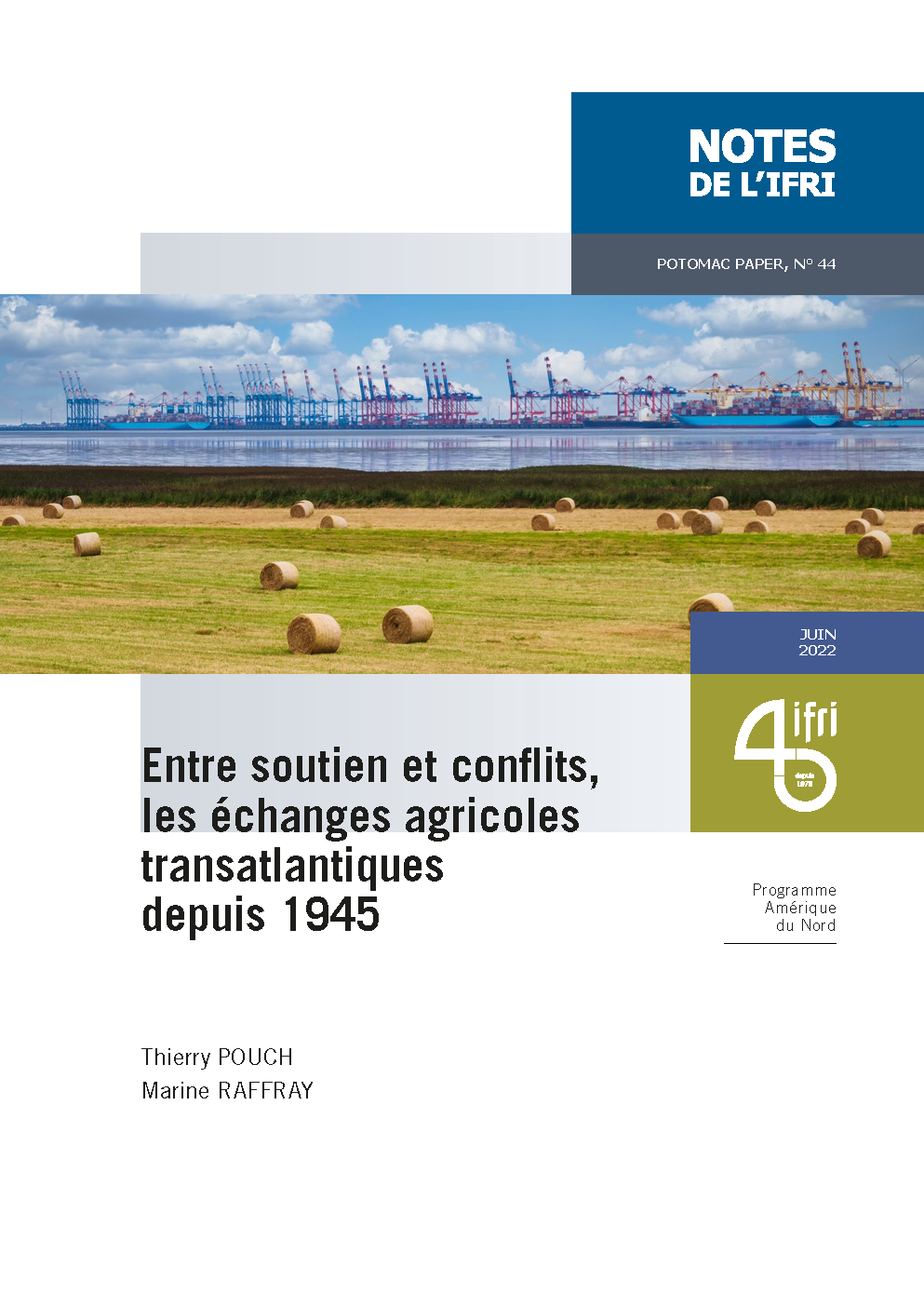
L’agriculture est un domaine d’importance stratégique, où l’entraide et la compétition alternent entre les États-Unis et l’Union européenne (UE).

Dans l’immédiat après-guerre, les États-Unis sont venus à l’aide de l’Europe en exportant de précieuses denrées alimentaires. Avec la naissance du marché commun et la mise en place de la Politique agricole commune (PAC), qui crée des mécanismes que l’on pourrait qualifier de protectionnistes, la dépendance européenne s’est peu à peu réduite. Les États-Unis ont cependant imposé à l’Europe, lors du Dillon Round, des importations de soja conséquentes (graines et tourteaux) qui vont nourrir les élevages européens.
À partir des années 1970, l’UE devient une puissance agricole exportatrice, et dépasse les États-Unis. Au travers des différents cycles de négociation de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) puis de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), les deux ensembles géographiques se livre une concurrence sans merci à coups de subventions. Les Accords de Marrakech en 1994 engagent une accalmie temporaire.
En 2013 commencent de vastes négociations pour un accord de libre-échange transatlantique (Partenariat transatlantique de commerce et d'investissement [TTIP], dit aussi TAFTA). Côté américain, elles sont menées parallèlement à des négociations pour un accord similaire sur le versant pacifique, l’Accord de partenariat transpacifique (TPP). Mais la question des « indications géographiques » des produits et la méfiance des opinions publiques envers les Mécanismes de règlement des différends entre investisseurs et États (RDIE) empêchent toute avancée sur le TTIP. L’arrivée à la Maison-Blanche du président populiste Donald Trump sonne le glas des négociations, sans espoir de redémarrage avec son successeur démocrate Joe Biden.
Un déséquilibre subsiste : lors de la guerre tarifaire entre la Chine et l’administration Trump (2017-2019), les Européens sont venus au secours de la filière soja américaine en doublant leurs importations. Au même moment, les États-Unis s’en prenaient à l’UE à propos de subventions supposées aux olives espagnoles, puis en imposant des taxes importantes sur les vins européens dans le cadre du contentieux Boeing-Airbus. Aujourd’hui, le Secrétaire à l’agriculture américain Tom Vilsack critique le vaste projet européen du Green Deal et défend une position bien différente, celle du « développement durable de la productivité » et de la poursuite du recours à un éthanol à base de maïs.
La situation pourrait-elle s’arranger aujourd’hui ? Il serait bien temps de construire un bloc occidental pour parer aux risques de crise alimentaire mondiale liés aux agissements de la Russie et à la guerre en Ukraine.

Contenu disponible en :
Régions et thématiques
ISBN / ISSN
Utilisation
Comment citer cette publicationPartager
Téléchargez l'analyse complète
Cette page ne contient qu'un résumé de notre travail. Si vous souhaitez avoir accès à toutes les informations de notre recherche sur le sujet, vous pouvez télécharger la version complète au format PDF.
Entre soutien et conflits, les échanges agricoles transatlantiques depuis 1945
Centres et programmes liés
Découvrez nos autres centres et programmes de rechercheEn savoir plus
Découvrir toutes nos analysesVenezuela : un pouvoir affermi
Nicolás Maduro semble plus impopulaire que jamais dans la population vénézuélienne, mais il verrouille aussi de manière toujours plus affirmée le système politique et institutionnel du pays. À l’extérieur, Donald Trump semble engager un nouveau bras de fer avec le gouvernement vénézuélien, dans une logique qui paraît très imprévisible.
De l'IRA à l'OBBA : les entreprises françaises de l'énergie aux États-Unis
Adopté en 2022 sous l’administration Biden, l’Inflation Reduction Act (IRA) a marqué un tournant historique dans la politique énergétique américaine, offrant une visibilité supposée de long terme et attirant les investissements. De 2022 à 2024, les investissements américains dans les énergies propres ont atteint près de 500 milliards de dollars (+ 71 % en deux ans).
Le Brésil à un an des élections générales d’octobre 2026
Les élections générales brésiliennes auront lieu le 4 octobre 2026 afin d’élire le président, le vice-président, les membres du Congrès national, les gouverneurs, les vice-gouverneurs et les assemblées législatives des états de la fédération. Pour les élections du président et des gouverneurs, un second tour sera organisé le 25 octobre si aucun candidat n’obtient la majorité des suffrages au premier tour.
États-Unis : la liberté d’expression face aux attaques du mouvement MAGA
La séquence ouverte par l’assassinat de l’influenceur conservateur Charlie Kirk le 10 septembre 2025 illustre l’importance et la relative fragilité du principe de liberté d’expression dans la société américaine.














