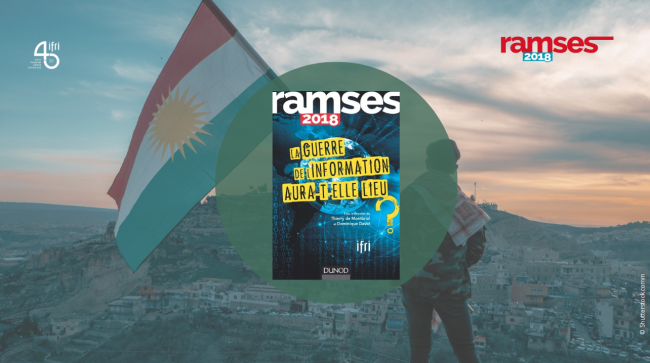Les Etats arabes face à la contestation islamiste
Pour une analyse approfondie des relations complexes entre les Etats arabes (Algérie, Arabie Saoudite, Egypte, Jordanie, Liban, Maroc, Palestine, Syrie, Tunisie, Yémen) et les mouvements de contestation islamistes.
Les Etats arabes sont-ils aujourd'hui armés pour faire face à la vague de contestation politique à fondement religieux, autrement dit l'islamisme, qui au cours de ces deux dernières décennies a fini par s'imposer comme la principale force d'opposition aux pouvoirs en place ? L'éventail des stratégies étatiques de répression, d'endiguement, de cooptation ou d'alliance déployé constitute-t-il la réponse appropriée à la crise de légitimité profonde que traversent ces régimes? Dans quelle mesure la nature de la relation entre l'Etat et l'islamisme détermine-t-elle l'évolution des structures du pouvoir, de sa relation avec la société civile et de ses choix politiques internes comme externes, en un mot sa stabilité ?
Pour répopndre à ces questions, cet ouvrage s'est résolument situé dans l'optique de l'acteur étatique lui-même, prenant ainsi à contre-pied les nombreux travaux qui s'étaient surtout attachés à analyser sle phénomène islamiste en tant que tel, ses origines, sa nature, les causes de son émergence et de son ampleur. L'intérêt légitime, mais quelque peu exclusif, accordé jusque-là à l'acteur islamiste semblait suggérer que les mouvements islamistes 'menaient la danse' face à des régimes arabes ayant perdu l'initiative sur le terrain, se contentant de réagir ponstuellement aux coups de boutoir ld'une contestation de plus en plus offensive.
A l'inverse, les dix études de cas développées ici –Algérie, Arabie Saoudite, Egypte, Jordanie, Liban, Maroc, Palestine, Syrie, Tunisie, Yémen– se sont attachées à analyser en profondeur le mode de gestion par l'Etat de la contestation islamiste et de ses implications directes sur la légitimité et la stabilité des pouvoirs établis. La diversité et la complexité des expériences en la matière, d'un pays à l'autre, comme à l'intérieur d'un même pays, suggèrent qu'il n'existe pas de stratégies 'clefs-en-mains' pour gérer un phénomène qui, loin d'être uniforme et monotlithique, donc prévisible, n'acquiert désormais de lisibilité et de pertinence que vu sous l'angle spécifiquement national de sa relation à l'Etat.
A propos des auteurs :
Wahid Abdel Meguid est responsable du secteur d'études arabes au Al-Ahram Center for Political and Strategic Studies (Le Caire).
Ziad Abu-Amr est professeur associé en science politique à l’Université de Birzeit (Cisjordanie) et membre du Conseil palestinien.
Hélé Béji, écrivain et philosophe, a enseigné la littérature française à la Faculté des lettres et à l'Ecole normale supérieure de Tunis.
Amina Bekkali, anthropologue, est co-auteur: Le Mouvement national marocain et la question arabe. Essai d'historisation 1947-1986, Beyrouth, 1992.
Nahla Chahal, maître de conférence en sociologie politique à l’Université libanaise, collabore régulièrement à des revues politiques et culturelles arabes.
May Chartouni-Dubarry est chargée de recherche à l'Ifri (Moyen-Orient et monde arabe).
Renaud Detalle est chercheur au Centre français d'études yéménites à Sanaa (Yémen).
Bassma Kodmani-Darwish est responsable des études sur le monde arabe à l'Ifri et maître de conférences à l'université de Marne-la-Vallée.
Gema Martin-Munoz est professeur de sociologie du monde arabe et islamique à l’Université autonome de Madrid et directrice du département Maghreb/Proche-Orient au Centro Español de Relaciones Internacionales.
Madawi al-Rasheed, anthropologue, enseigne au département de théologie et d'études religieuses au King’s College de l'Université de Londres.

Contenu disponible en :
Régions et thématiques
Utilisation
Comment citer cette publicationPartager
Centres et programmes liés
Découvrez nos autres centres et programmes de rechercheEn savoir plus
Découvrir toutes nos analysesTurquie 2050 : Tourisme turc ; PKK ; enjeu spatial
Repères sur la Turquie n°27 - Le programme « Turquie 2050 » développe une analyse prospective sur les thèmes de la diplomatie, de la politique intérieure et de l’économie turques afin d’y anticiper les dynamiques des trente prochaines années.
Adiyaman, la « ville sans propriétaire » : récit d’une émancipation politique
La ville d’Adıyaman a fait les grands titres ces deux dernières années en raison d’une part de sa dévastation par le séisme du 6 février 2023 entre la Turquie et la Syrie et d’autre part de son tournant politique partisan après le scrutin municipal du 31 mars 2024.
Turquie 2050 : Enrichissement individuel en Turquie ; Mavi Vatan 2025 ; forêt de Belgrade
Repères sur la Turquie n°26 - Le programme « Turquie 2050 » développe une analyse prospective sur les thèmes de la diplomatie, de la politique intérieure et de l’économie turques afin d’y anticiper les dynamiques des trente prochaines années.
Les fragilités du Kurdistan irakien
Le Kurdistan irakien arbore les institutions d’un État. Mais ses divisions politiques et ses faiblesses économiques minent ses prétentions à plus d’autonomie. Ses relations avec les acteurs de la région et au-delà ne semblent guère pouvoir concrétiser un appui à une marche vers l’indépendance qui demeure incertaine.