L'Allemagne en campagne pour les élections anticipées du 23 février. Enjeux d’un scrutin à risque
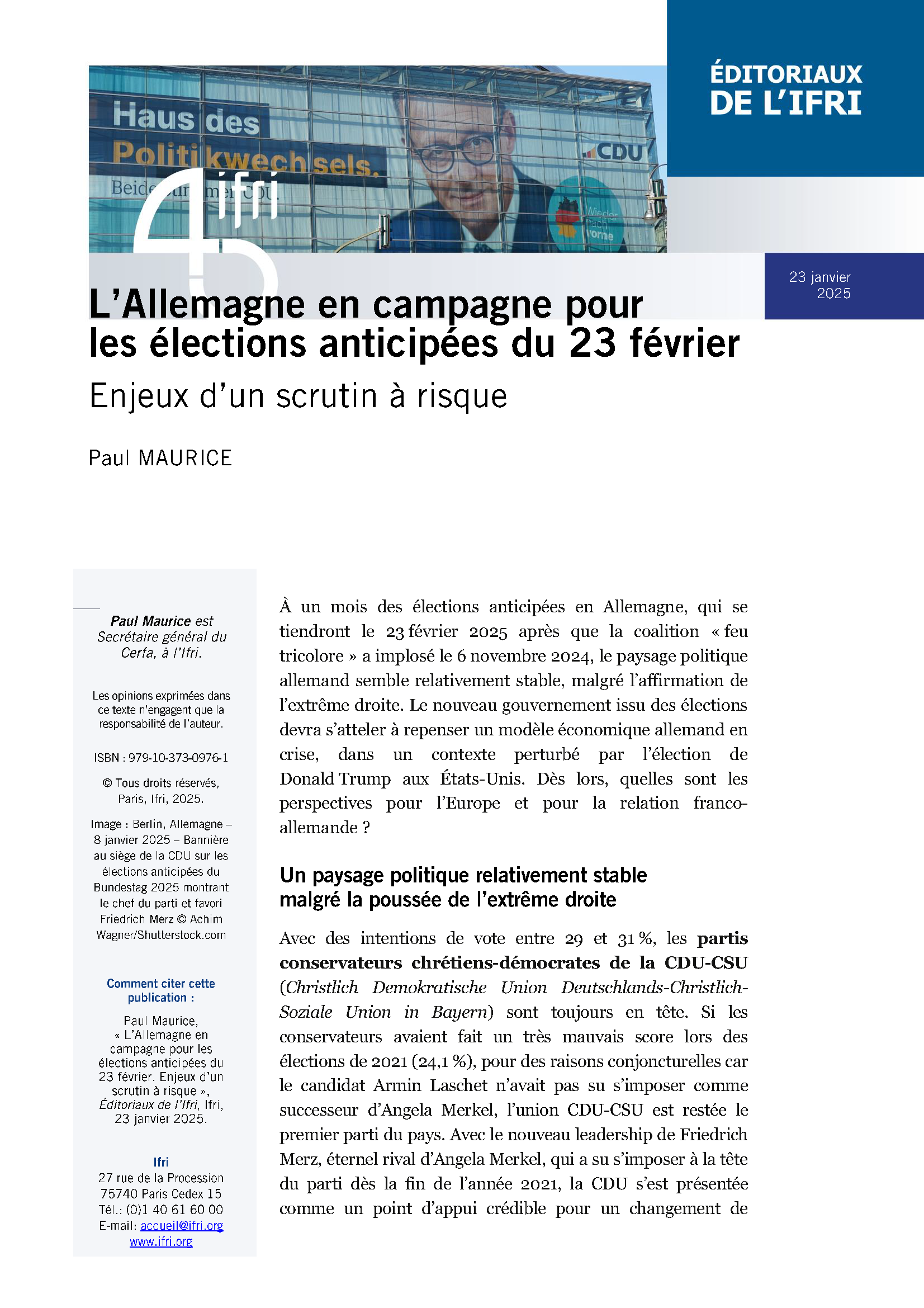
À un mois des élections anticipées en Allemagne, qui se tiendront le 23 février 2025 après que la coalition « feu tricolore » a implosé le 6 novembre 2024, le paysage politique allemand semble relativement stable, malgré l’affirmation de l’extrême droite. Le nouveau gouvernement issu des élections devra s’atteler à repenser un modèle économique allemand en crise, dans un contexte perturbé par l’élection de Donald Trump aux États-Unis. Dès lors, quelles sont les perspectives pour l’Europe et pour la relation franco-allemande ?

Titre Edito
Un paysage politique relativement stable malgré la poussée de l’extrême droite
Un paysage politique relativement stable malgré la poussée de l’extrême droite
Avec des intentions de vote entre 29 et 31 %, les partis conservateurs chrétiens-démocrates de la CDU-CSU (Christlich Demokratische Union Deutschlands-Christlich-Soziale Union in Bayern) sont toujours en tête. Si les conservateurs avaient fait un très mauvais score lors des élections de 2021 (24,1 %), pour des raisons conjoncturelles car le candidat Armin Laschet n’avait pas su s’imposer comme successeur d’Angela Merkel, l’union CDU-CSU est restée le premier parti du pays. Avec le nouveau leadership de Friedrich Merz, éternel rival d’Angela Merkel, qui a su s’imposer à la tête du parti dès la fin de l’année 2021, la CDU s’est présentée comme un point d’appui crédible pour un changement de coalition – y compris donc en cours de législature avec ces élections anticipées. Néanmoins, les dernières semaines ont vu un léger tassement des intentions de vote pour la CDU-CSU, au profit notamment du parti d’extrême droite AfD (Alternative für Deutschland), estimé entre 19 et 22 %.
L’AfD, qui avait perdu un million de voix entre 2017 et 2021 (10,3 %), est en forte progression et pourrait doubler son score. Elle a réussi à s’imposer comme une alternative aux politiques menées par la coalition « feu tricolore », notamment à l’Est face aux conservateurs et aux sociaux-démocrates, qui étaient arrivés en tête en 2021.
Vainqueur surprise des élections de 2021, le parti social-démocrate SPD (Sozialdemokratische Partei Deutschlands) plafonne à 16-17 % des intentions de vote. Le candidat-chancelier Olaf Scholz espérait un sursaut, comme celui qui l’avait fait passer de 16 % en juin 2021 à 25,7 % des suffrages le jour des élections à la fin du mois de septembre 2021. Mais, alors que Scholz avait réussi le tour de force de se présenter comme le successeur naturel d’Angela Merkel, tout en menant campagne sur les questions sociales, il pâtit aujourd’hui de son impopularité. D’une certaine manière, le SPD retrouve son score plancher de ces dernières années (avec un résultat historiquement bas de 15,8 % des suffrages lors des élections européennes de 2019). Le (relativement) bon résultat de 2021 semble être une exception plutôt qu’un sursaut durable de la social-démocratie allemande – dans le sillage de la crise de la social-démocratie européenne.
Les Verts (Bündnis 90/Die Grünen) sont le parti de la coalition sortant qui semble le moins souffrir de la mauvaise image du gouvernement. Avec 13 à 15 %, ils talonnent le SPD et pourraient retrouver leur score de 2021 (14,8 %), alors qu’ils représentent pour beaucoup d’électeurs (de l’AfD et de la CSU notamment) un repoussoir dans la campagne.
Le parti libéral-démocrate FDP (Freie Demokratische Partei) quant à lui, malgré le bon score de 2012 (11,5 %), pourrait être le grand perdant de la coalition et ne plus être représenté au Bundestag en n’atteignant pas la barre fatidique des 5 %.
À moins d’un mois des élections, les conservateurs paraissent solidement installés en tête des sondages et devraient, selon toute vraisemblance, diriger le prochain gouvernement, en coalition avec le SPD dans le cadre d’une « grande coalition » ou, éventuellement, les Verts. Ils souhaitent avant tout éviter – si les résultats le lui permettent – de réitérer l’expérience douloureuse d’une coalition à trois partis.
Titre Edito
Les thèmes de campagne : économie et immigration
Les thèmes de campagne : économie et immigration
Alors que l’économie allemande a enregistré en 2024 sa deuxième année de récession consécutive et qu’elle risque de stagner en 2025, la CDU/CSU et le SPD mettent en avant des programmes concurrents pour relancer l’économie allemande. Les conservateurs ont ainsi complété leur programme les 10 et 11 janvier par un volet spécifiquement dédié à l’économie, intitulé « Agenda 2030 ». Cet intitulé rappelle « l’Agenda 2010 » du chancelier social-démocrate Gerhard Schröder au début des années 2000, qui avait pour objectif de relancer la croissance de l’Allemagne, alors considérée comme « l’homme malade de l’Europe ». Le programme de la CDU-CSU propose un ensemble de réformes qui doivent apporter 2 % de croissance par an au pays. Les conservateurs prônent, notamment, une vaste réforme fiscale destinée à alléger la charge pesant sur les contribuables et les entreprises, couplée à une diminution des dépenses sociales. Friedrich Merz est néanmoins resté très évasif sur la question de la réforme du « frein à la dette ». C’est sur les questions économiques et sociales que le SPD souhaite se démarquer des conservateurs. Au début du mois de janvier 2025, Olaf Scholz a présenté par exemple sa proposition d’une prime « Made in Germany » prenant la forme d’un crédit d’impôt pour tous les investissements industriels sur le sol national.
L’attentat de Magdebourg le 20 décembre, puis celui d’Aschaffenbourg le 22 janvier ont remis le sujet de l’immigration au cœur du débat public. La CDU et, plus encore, la CSU se sont saisies du sujet ne souhaitant pas laisser l’AfD occuper seule le terrain et ont musclé leurs propositions en la matière. L’AfD dont le thème de l’immigration est au cœur du programme depuis la « crise » migratoire de 2015 a amendé son projet de programme pour se prononcer en faveur d’une « remigration » de populations d’origine étrangère. Le parti de gauche populiste BSW (Bündnis Sahra Wagenknecht) plaide également dans son programme pour un « arrêt de la migration incontrôlée ».
Titre Edito
Une campagne brouillée par l’arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche
Une campagne brouillée par l’arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche
Les interventions répétées d’Elon Musk en faveur de l’AfD ont bouleversé le début de la campagne électorale. Après ses appels au vote pour le parti d’extrême droite, sur son réseau social, puis une tribune publiée dans le journal conservateur Die Welt, le milliardaire américain a échangé avec la candidate de l’AfD, Alice Weidel, sur X, le 9 janvier. D’abord mesuré, alors qu’il avait été pris à partie, le chancelier allemand Olaf Scholz a vivement réagi en accusant Elon Musk de « mettre en danger » la démocratie européenne.
Cette ingérence de ce proche de Donald Trump dans la campagne électorale allemande va de pair avec le retour de ce dernier à la Maison blanche le 20 janvier. Si les conservateurs allemands de la CDU, traditionnellement atlantistes, l’ont chaleureusement félicité, la guerre commerciale annoncée par le président américain risque de perturber leurs plans de relance de l’économie à un moment où le modèle économique, commercial et industriel allemand est en crise et a besoin d’un appel d’air.
Par ailleurs, les demandes de Donald Trump aux États européens de porter leurs dépenses de défense à 5 % du produit intérieur brut (PIB) ont aussi fait réagir l’ensemble de la classe politique allemande. Le candidat des Verts, Robert Habeck, qui s’était déclaré favorable à un objectif de 3,5 % du PIB consacré à la défense, a jugé les demandes du président américain « irréalistes ». Il s’est néanmoins emparé du débat pour porter à nouveau sa proposition d’un nouveau fonds spécial consacré à la défense alors que la guerre en Ukraine est un catalyseur dans la campagne électorale. En marge d’une rencontre avec les autres dirigeants des mouvements du Parti populaire européen (PPE) les 17 et 18 janvier, le candidat de la CDU, Friedrich Merz, s’est quant à lui dit ouvert à un endettement commun de l’Union européenne (UE) pour financer le renforcement de l’appareil militaire européen, alors que le gouvernement allemand a jusqu’à présent bloqué les efforts de Bruxelles visant à utiliser une dette commune pour débloquer de nouveaux fonds.
Titre Edito
Compétitivité européenne
Compétitivité européenne
Si les sujets compliqués entre la France et l’Allemagne n’ont pas manqué depuis l’entrée en fonction de la coalition « feu tricolore » en 2021, notamment sur les questions énergétiques, la France et l’Allemagne avaient retrouvé un chemin commun lors du Conseil des ministres franco-allemand de mai 2024. Les deux pays ont produit une initiative franco-allemande pour la compétitivité de l’UE, adoptée à Meseberg le 28 mai 2024, et qui a largement été intégrée depuis dans le programme de travail de la nouvelle Commission européenne. Pour garantir la compétitivité, la prospérité et le rôle mondial de l’Europe en tant qu’acteur géopolitique à long terme, des efforts devront être déployés pour combler les écarts de croissance, de productivité, d’investissement et d’innovation entre l’UE et ses partenaires internationaux et ses principaux concurrents. Dans leurs rapports respectifs, Mario Draghi et Enrico Letta ont alerté sur les défis de l’Europe face à la concurrence des États-Unis et de la Chine. Face au risque de décrochage de l’UE, trois défis sont à relever autour des transitions énergétique, numérique (notamment le quantique et l’Intelligence artificielle) et de sécurité. Cependant, les recommandations ambitieuses de ces rapports suscitent des interrogations sur leur mise en œuvre : dans la situation politique actuelle, l’Allemagne et la France sont-elles en état de s’accorder sur une dynamique commune ?
Titre Edito
Quelles sont les perspectives franco-allemandes d’un nouveau gouvernement allemand ?
Quelles sont les perspectives franco-allemandes d’un nouveau gouvernement allemand ?
Le conservateur Friedrich Merz, possible futur chancelier, est réputé davantage francophile que l’actuel chancelier Olaf Scholz. Friedrich Merz, comme catholique rhénan, est un héritier de la politique franco-allemande de la CDU, de Konrad Adenauer à Helmut Kohl en passant par Wolfgang Schäuble. Il a d’ailleurs souvent reproché au chancelier actuel et au gouvernement de la coalition « feu tricolore » de ne pas faire grand cas de la relation franco-allemande. Le chef de la CDU est très critique des relations du chancelier Scholz avec le président Macron, reprochant le « manque d’alchimie » en promettant de faire mieux, notamment en raison, selon lui, du grand potentiel économique, géopolitique et culturel. La critique est probablement acerbe, car le président de la République et le chancelier ont « joué le jeu » de la relation franco-allemande. Ils se sont consultés très régulièrement avant les prises de décision des crises majeures (récemment encore sur la Syrie ou face aux « défis » de la présidence Trump lors de la visite du chancelier à Paris pour la Journée franco-allemande du 22 janvier 2025). Mais des « fausses notes » ont alerté le public, comme l’annonce non concertée de la European Sky Shield Initiative (ESSI) ou celle d’un plan de soutien de 200 milliards d’euros pour protéger l’économie allemande face à la crise énergétique en octobre 2022.
Si l’arrivée à la chancellerie d’une personnalité plus « francophile » comme Friedrich Merz serait un signal favorable pour les relations franco-allemandes, il faudra qu’il fasse ses preuves rapidement. En son temps, le pourtant très francophile Wolfgang Schäuble avait eu des relations tendues avec la France.
Paul Maurice est secrétaire général du Comité d’études des relations franco-allemandes (Cerfa) à l’Ifri, où il travaille en particulier sur les questions de politique intérieure allemande, les relations franco-allemandes dans le cadre de l’Union européenne et la politique étrangère et de sécurité de l’Allemagne.

Contenu disponible en :
Thématiques et régions
ISBN / ISSN
DOI
Éditoriaux de l'Ifri, 23 janvier 2025
Utilisation
Comment citer cette publicationPartager
Téléchargez l'analyse complète
Cette page ne contient qu'un résumé de notre travail. Si vous souhaitez avoir accès à toutes les informations de notre recherche sur le sujet, vous pouvez télécharger la version complète au format PDF.
L'Allemagne en campagne pour les élections anticipées du 23 février. Enjeux d’un scrutin à risque
Centres et programmes liés
Découvrez nos autres centres et programmes de rechercheEn savoir plus
Découvrir toutes nos analysesPerspectives françaises et allemandes face aux défis géopolitiques dans le contexte de l’agression russe contre l’Ukraine
Les politiques étrangères, de défense et de sécurité de la France et l’Allemagne évoluent dans un contexte très tendu, marqué par le retour de conflits à haute intensité. Impensable au lendemain de la chute du Mur de Berlin qui symbolise la fin du conflit Est-Ouest, la guerre est aujourd’hui de retour en Europe, alors que les espaces terrestres et maritimes qui entourent le continent européen, de l’Arctique à l’Afrique en passant par le Moyen-Orient, sont devenus des théâtres de rivalité géopolitique, de guerres civiles et de conflits aussi bien hybrides que militaires.
La brigade franco-allemande et la relance de la défense européenne
Une chose est claire depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche : le projet d’unification européenne est menacé dans son existence même. À moins d’élaborer une politique de défense souveraine pour parer à la guerre en Ukraine et à l’affaiblissement des garanties de sécurité américaines, l’Union européenne verra se poursuivre l’érosion de sa dynamique de cohésion interne et de son attractivité externe.
Friedrich Merz et la Zeitenwende 2.0. Une « nouvelle ère » pour les relations transatlantiques ?
Le 23 février 2025, près de 60 millions d’électeurs ont été appelés à élire un nouveau Bundestag. Ces élections donneront également naissance à un nouveau gouvernement dans la première économie d’Europe.
Après les élections : l’Allemagne en quête d’une stabilité ébranlée ?
Avec 82,5 % de participation, l’Allemagne a enregistré un taux de mobilisation inédit depuis 1987, une hausse de 6,1 points par rapport à 2021. Comme en 2021, cette forte participation a profité à l’Alternative pour l’Allemagne (AfD), qui a su mobiliser un grand nombre d’anciens abstentionnistes.















