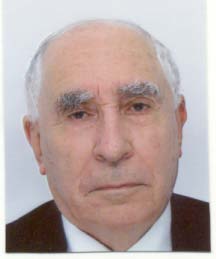En lisant la déclaration "Rio+20"

La lecture des 283 articles de la déclaration de " Rio + 20 " avec leur succession de " Nous approuvons… ", " Nous soutenons… ", " Nous recommandons… " suscite, au-delà d’une sympathie fatiguée, deux réflexions, l’une ponctuelle et l’autre générale.
1. Notre époque, médiatique et simplificatrice, aime s’approprier des concepts inconsistants qui lui paraissent résumer des évolutions infiniment plus complexes. Il en fut ainsi au cours de la décennie 1990 de la notion de " nouvelle économie " où le remplacement des investissements de béton et d’acier par des logiciels immatériels était censé promettre une croissance régulière sans crises conjoncturelles. On sait ce qu’il en fut. Aujourd’hui la conférence de Rio chante les louanges de la croissance verte dont la couleur assure qu’elle présente tous les avantages. Or, ce concept est creux car il évoque des activités disparates, allant du recyclage des métaux à l’expansion des technologies informatiques, des applications des sciences de la vie à l’entrée dans l’ère des technologies des nanotechnologies. Et l’on peut ainsi passer sous silence les facteurs sociaux, économiques et techniques sous-jacents à toute croissance.
2. A une échelle plus vaste, " Rio + 20 " met en évidence l’énorme clivage qui s’approfondit entre deux approches. D’un côté, celle qui énumère des critères, et leur associe des objectifs en partant des trois piliers du développement durable (croissance, éradication de la pauvreté, protection de l’environnement) et en les déclinant en une multitude de thèmes partiels (l’égalité des sexes, l’accès à l’eau potable, la protection du climat, les Etats insulaires, le niveau des océans, etc…) à propos desquels on cite les recommandations de toutes les conférences des Nations-Unies et on annonce des dates illusoires tout en réaffirmant la nécessité de financements introuvables ; de l’autre, celle qui part des acteurs, gouvernements, entreprises, familles ayant des budgets à respecter, des recettes à trouver, des dépenses à contrôler, des intérêts à défendre pour survivre ou éviter des catastrophes les concernant. Certes, il existe parmi ces acteurs, certains d’entre eux qui se sont construits des niches confortables, mais cela ne change rien de fondamental à l’éventail de contraintes auquel les acteurs sont soumis.
3. " Rio + 20 " ignore tout cela et n’aborde en rien les deux questions qui dominent dans toute action concrète : celle du choix des priorités et des compromis possibles, celle de la temporalité et de l’échelonnement des efforts dans le temps. C’est sur ce constat amer que s’est terminée la conférence de Copenhague sur le climat dont les organisateurs nourrissaient l’espoir de voir fixer des plafonds d’émissions de GES alors que l’ordre des priorités des Etats-membres était la croissance, la lutte contre la pauvreté et le chômage et en troisième lieu, la protection du climat.
Il faut suivre avec soin toutes les négociations inter-étatiques mondiales pour comprendre comment pourra se construire progressivement l’indispensable gouvernance, permettant de maîtriser à travers des kermesses universelles et des clubs restreints, les multiples problèmes auxquels notre espèce doit faire face.

Contenu disponible en :
Régions et thématiques
Utilisation
Comment citer cette publicationPartager
Centres et programmes liés
Découvrez nos autres centres et programmes de rechercheEn savoir plus
Découvrir toutes nos analysesIA, centres de données et demande d'énergie : quelles tendances ?
Le secteur des technologies de l’information et de la communication représente aujourd’hui 9 % de la consommation mondiale d’électricité, les centres de données (data centers) 1 à 1,3 % et l’intelligence artificielle (IA) moins de 0,2 %. La demande croissante d’énergie du cloud d’abord, et maintenant de l’IA (10 % de la demande d’électricité des data centers aujourd’hui), a exacerbé cette tendance. À l'avenir, les centres de données à grande échelle gagneront du terrain parmi tous les types de centres de données et l'IA représentera probablement environ 20 % de la demande d'électricité des centres de données d'ici à 2030.
Accélération de la transition énergétique de l’Inde : le défi de la flexibilité des réseaux au cœur des enjeux
L’Inde augmente rapidement sa capacité en énergies renouvelables (EnR), ajoutant 15 à 20 GW par an, mais l’objectif ambitieux de 500 GW de capacité non fossile d’ici 2030 est menacé si le rythme de déploiement des EnR ne s’accélère pas.
Pétrole : incertitudes et perspectives divergentes à moyen et long termes
La crise du marché pétrolier en 2014 a débouché sur une reprise en main du marché par l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP). Celle-ci s’est mise d’accord sur une diminution des quotas de production de tous ses membres, notamment les pays du Moyen-Orient et l’organisation s’est alliée à d’autres producteurs, principalement la Russie, au sein de l’alliance dite « OPEP+ ». Son pouvoir de marché s’est confirmé à l’occasion de la pandémie, après un éclatement temporaire de l’alliance élargie.
France-Allemagne : un sursaut dans l’énergie est indispensable
La France et l’Allemagne doivent surmonter leurs désaccords et travailler ensemble pour limiter les coûts de la transition et renforcer la sécurité énergétique. La complémentarité, plutôt que l’uniformisation des trajectoires, doit être recherchée. Un nouveau départ peut avoir lieu en 2025 à la suite des élections allemandes et implique plus de flexibilité et d’efficacité dans la mise en œuvre des objectifs européens, ainsi que l’ancrage systématique du principe de neutralité technologique.