Augmentation du nombre d’actes d’extrême droite et xénophobes en Allemagne – un nouveau Rostock-Lichtenhagen ?
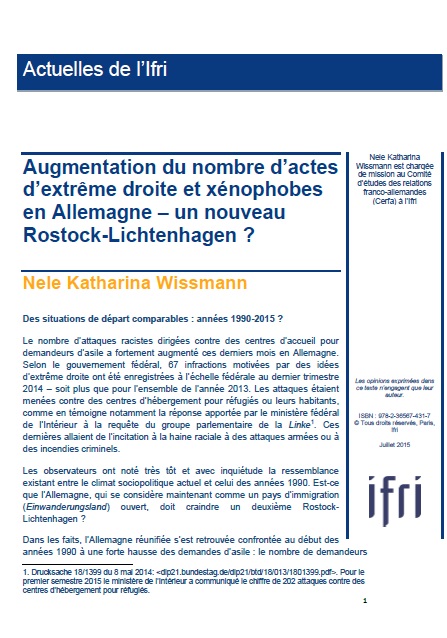
Le nombre d’attaques racistes dirigées contre des centres d’accueil pour demandeurs d’asile a fortement augmenté ces derniers mois en Allemagne. Selon le gouvernement fédéral, 67 infractions motivées par des idées d’extrême droite ont été enregistrées à l’échelle fédérale au dernier trimestre 2014 – soit plus que pour l’ensemble de l’année 2013.
Des situations de départ comparables : années 1990-2015 ?
Le nombre d’attaques racistes dirigées contre des centres d’accueil pour demandeurs d’asile a fortement augmenté ces derniers mois en Allemagne. Selon le gouvernement fédéral, 67 infractions motivées par des idées d’extrême droite ont été enregistrées à l’échelle fédérale au dernier trimestre 2014 – soit plus que pour l’ensemble de l’année 2013. Les attaques étaient menées contre des centres d’hébergement pour réfugiés ou leurs habitants, comme en témoigne notamment la réponse apportée par le ministère fédéral de l’Intérieur à la requête du groupe parlementaire de la Linke. Ces dernières allaient de l’incitation à la haine raciale à des attaques armées ou à des incendies criminels.
Les observateurs ont noté très tôt et avec inquiétude la ressemblance existant entre le climat sociopolitique actuel et celui des années 1990. Est-ce que l’Allemagne, qui se considère maintenant comme un pays d’immigration (Einwanderungsland) ouvert, doit craindre un deuxième Rostock-Lichtenhagen ?
Dans les faits, l’Allemagne réunifiée s’est retrouvée confrontée au début des années 1990 à une forte hausse des demandes d’asile : le nombre de demandeurs a atteint des sommets en 1992 avec 440 000 demandeurs et a ainsi mis l’Allemagne dans une position difficile. En raison de la chute du « rideau de fer » et en particulier de la situation en ex-Yougoslavie, les chiffres ont grimpé au moment même où les problèmes économiques et sociaux liés à la réunification ont gagné en visibilité et ont déclenché des frustrations au sein de la société allemande. Ce climat a été favorisé pour une part non négligeable par la connotation négative donnée aux politiques à l’égard des étrangers et de l’asile lorsqu’elles étaient abordées dans le discours politique dans ces années-là. Dans ce contexte, on peut également noter que les concepts de fraude en matière d’asile (Asylbetrug) et de demandeur d’asile économique (Wirtschaftsflüchtling) avaient déjà conduit à des débats qui avaient déchaîné les passions dans les années 1980 au sein de la CDU et de la CSU. Pour ces raisons, il est donc peu étonnant que le Parti national-démocrate d’Allemagne (Nationaldemokratische Partei Deutschlands, NPD), le parti d’extrême droite Die Republikaner et l’Union populaire allemande (Deutsche Volksunion, DVU) aient connu des succès électoraux importants à l’époque et aient eu ensuite des difficultés dans les années qui suivirent à se maintenir dans le système des partis politiques allemand qui ne laissait aucune place à droite de la CSU.
L’atmosphère xénophobe s’est encore renforcée à l’été 1991 lorsque des exactions ont été menées à Hoyerswerda, en Saxe, contre un foyer pour travailleurs contractuels et un foyer pour réfugiés, prélude à une série d’actes similaires, principalement en Allemagne de l’Est dont le cas le plus connu fut l’attaque de plusieurs jours menée contre une tour habitée par des Vietnamiens à Rostock-Lichtenhagen.
Poursuivez la lecture en téléchargeant le fichier :

Contenu disponible en :
Régions et thématiques
ISBN / ISSN
Utilisation
Comment citer cette publicationPartager
Téléchargez l'analyse complète
Cette page ne contient qu'un résumé de notre travail. Si vous souhaitez avoir accès à toutes les informations de notre recherche sur le sujet, vous pouvez télécharger la version complète au format PDF.
Augmentation du nombre d’actes d’extrême droite et xénophobes en Allemagne – un nouveau Rostock-Lichtenhagen ?
Centres et programmes liés
Découvrez nos autres centres et programmes de rechercheEn savoir plus
Découvrir toutes nos analysesPerspectives françaises et allemandes face aux défis géopolitiques dans le contexte de l’agression russe contre l’Ukraine
Les politiques étrangères, de défense et de sécurité de la France et l’Allemagne évoluent dans un contexte très tendu, marqué par le retour de conflits à haute intensité. Impensable au lendemain de la chute du Mur de Berlin qui symbolise la fin du conflit Est-Ouest, la guerre est aujourd’hui de retour en Europe, alors que les espaces terrestres et maritimes qui entourent le continent européen, de l’Arctique à l’Afrique en passant par le Moyen-Orient, sont devenus des théâtres de rivalité géopolitique, de guerres civiles et de conflits aussi bien hybrides que militaires.
La brigade franco-allemande et la relance de la défense européenne
Une chose est claire depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche : le projet d’unification européenne est menacé dans son existence même. À moins d’élaborer une politique de défense souveraine pour parer à la guerre en Ukraine et à l’affaiblissement des garanties de sécurité américaines, l’Union européenne verra se poursuivre l’érosion de sa dynamique de cohésion interne et de son attractivité externe.
Friedrich Merz et la Zeitenwende 2.0. Une « nouvelle ère » pour les relations transatlantiques ?
Le 23 février 2025, près de 60 millions d’électeurs ont été appelés à élire un nouveau Bundestag. Ces élections donneront également naissance à un nouveau gouvernement dans la première économie d’Europe.
Après les élections : l’Allemagne en quête d’une stabilité ébranlée ?
Avec 82,5 % de participation, l’Allemagne a enregistré un taux de mobilisation inédit depuis 1987, une hausse de 6,1 points par rapport à 2021. Comme en 2021, cette forte participation a profité à l’Alternative pour l’Allemagne (AfD), qui a su mobiliser un grand nombre d’anciens abstentionnistes.













