La France et l'Allemagne face aux enjeux de la politique sociale de l'Union européenne
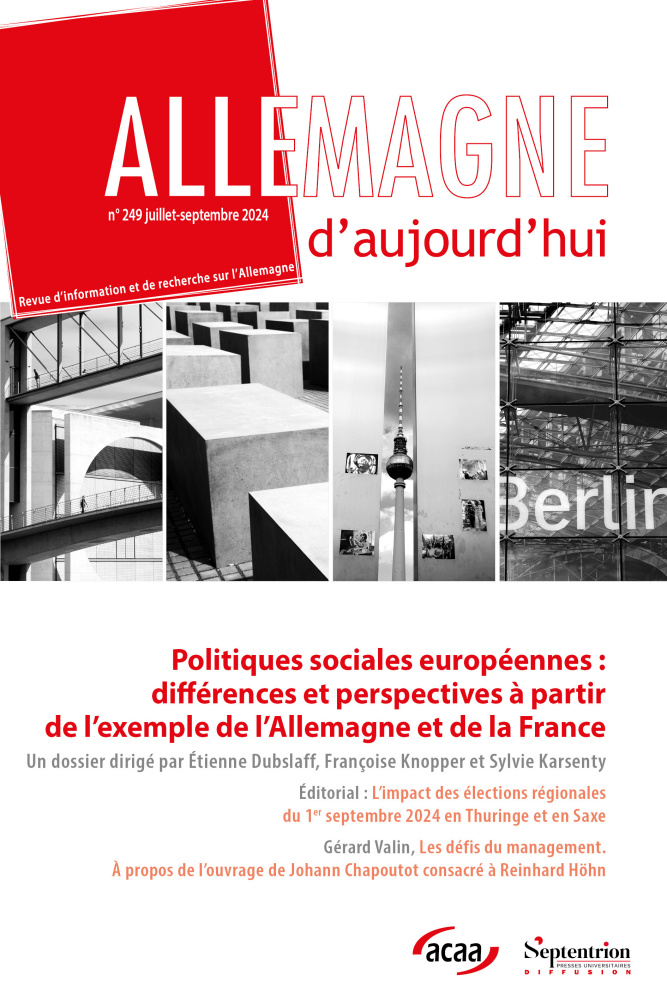
Depuis la signature des Traités de Rome en 1957, la dimension sociale de la construction européenne s'est progressivement imposée dans les négociations entre les États membres et elle fait aujourd'hui partie intégrante de l'acquis communautaire.

Toutefois, elle joue toujours un rôle plutôt secondaire à l'échelle de l'Union. Les domaines prioritaires de l'intégration au niveau économique sont l'union douanière, le marché intérieur ainsi que l'union économique et monétaire. La politique sociale de l'UE consistait plutôt à amortir les effets négatifs de l'intégration commerciale, économique et monétaire qu'à infléchir une philosophie économique clairement axée sur la compétitivité des entreprises et le libre-échange.
La justice sociale, si elle n'est pas étrangère aux valeurs de l'UE rappelées dans l'article 2 du traité de Lisbonne et dans la charte des droits fondamentaux et qui défend aussi la stabilité et la paix intérieures des sociétés des États membres, n'a jamais été une priorité de premier ordre pour l'Union. D'autant qu'il s'agit d'une notion à laquelle tous les États membres n'attachent pas la même importance et qui, de surcroît, fait surtout partie des domaines qui relèvent prioritairement des champs de compétence des États membres, la politique sociale étant par excellence une matière gérée pour l'essentiel à l'échelle nationale.
Hans Stark est professeur à Sorbonne Université et conseiller pour les relations franco-allemandes (Cerfa) à l'Ifri.
Cet article est paru dans le dossier intitulé "Politiques sociales européennes : différences et perspectives à partir de l'exemple de l'Allemagne et de la France", paru dans la revue Allemagne d'aujourd'hui, n° 249, juillet-septembre 2024 et co-dirigé par Étienne Dubslaff, Françoise Knopper, Sylvie Karsenty (p. 11 à 19).

Contenu disponible en :
Thématiques et régions
ISBN / ISSN
DOI
Presses Universitaires du Septentrion
Utilisation
Comment citer cette publicationPartager
Centres et programmes liés
Découvrez nos autres centres et programmes de rechercheEn savoir plus
Découvrir toutes nos analysesPerspectives françaises et allemandes face aux défis géopolitiques dans le contexte de l’agression russe contre l’Ukraine
Les politiques étrangères, de défense et de sécurité de la France et l’Allemagne évoluent dans un contexte très tendu, marqué par le retour de conflits à haute intensité. Impensable au lendemain de la chute du Mur de Berlin qui symbolise la fin du conflit Est-Ouest, la guerre est aujourd’hui de retour en Europe, alors que les espaces terrestres et maritimes qui entourent le continent européen, de l’Arctique à l’Afrique en passant par le Moyen-Orient, sont devenus des théâtres de rivalité géopolitique, de guerres civiles et de conflits aussi bien hybrides que militaires.
La brigade franco-allemande et la relance de la défense européenne
Une chose est claire depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche : le projet d’unification européenne est menacé dans son existence même. À moins d’élaborer une politique de défense souveraine pour parer à la guerre en Ukraine et à l’affaiblissement des garanties de sécurité américaines, l’Union européenne verra se poursuivre l’érosion de sa dynamique de cohésion interne et de son attractivité externe.
Friedrich Merz et la Zeitenwende 2.0. Une « nouvelle ère » pour les relations transatlantiques ?
Le 23 février 2025, près de 60 millions d’électeurs ont été appelés à élire un nouveau Bundestag. Ces élections donneront également naissance à un nouveau gouvernement dans la première économie d’Europe.
Après les élections : l’Allemagne en quête d’une stabilité ébranlée ?
Avec 82,5 % de participation, l’Allemagne a enregistré un taux de mobilisation inédit depuis 1987, une hausse de 6,1 points par rapport à 2021. Comme en 2021, cette forte participation a profité à l’Alternative pour l’Allemagne (AfD), qui a su mobiliser un grand nombre d’anciens abstentionnistes.













