De l’« Institut de Berlin-Brandebourg pour la coopération franco-allemande en Europe » à la fondation Genshagen : organiser le dialogue franco-allemand à l’échelle européenne après 1990
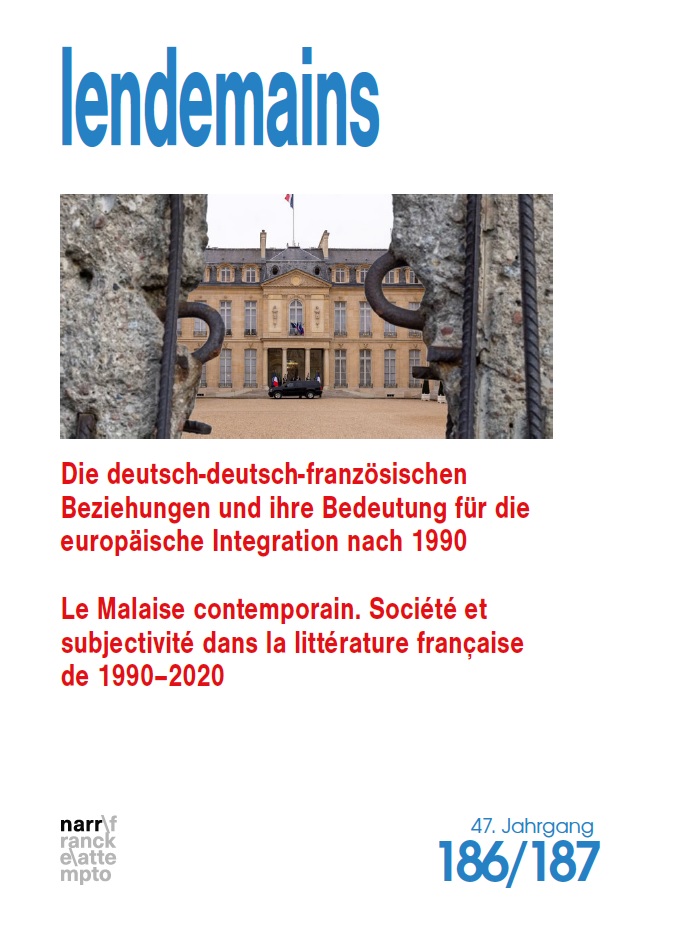
En 1993, Rudolf von Thadden et Brigitte Sauzay ont fondé l’« Institut de Berlin-Brandebourg pour la coopération franco-allemande en Europe » (BBi). L’objectif de cette initiative était d’amener le dialogue franco-allemand dans les nouveaux Länder quatre ans après la chute du mur de Berlin.

En 2005, l’Institut s’est transformé en la Fondation Genshagen, qui s’attache tout particulièrement aux relations franco-allemandes et germano-polonaises dans le cadre du Triangle de Weimar. La Fondation se revendique comme un espace de « décélération » permettant une médiation des différents acteurs à l’échelle européenne afin de promouvoir des projets artistiques et culturels ainsi qu’un dialogue politique. Pour son directeur actuel, Martin Koopmann, « Genshagen est une plateforme de dialogue unique qui n’existe pas sous cette forme en France ». Elle s’est en effet fixé pour objectif de réunir les acteurs de la culture, des médias, de la politique, du monde économique et académique pour jeter des ponts entre la société civile, l’État et la sphère économique.
En raison son histoire et des spécificités de cette institution, nous nous proposons d’analyser le rôle qu’elle a joué, à la fois dans l’intégration des citoyens des nouveaux Länder dans une relation franco-allemande, jusque-là établie à l’Ouest, mais aussi dans la réconciliation franco-germano-polonaise après 1990.
Paul Maurice est chercheur au Comité d’études des relations franco-allemandes (Cerfa) à l’Institut français des relations internationales (Ifri).
>> >> Cet article est paru dans la revue Lendemains - Études comparées sur la France (47, 186/187, 2023), pages 66 à 74.

Contenu disponible en :
ISBN / ISSN
DOI
Lendemains - Etudes comparées sur la France 47, 186/187
Utilisation
Comment citer cette publicationPartager
Centres et programmes liés
Découvrez nos autres centres et programmes de rechercheEn savoir plus
Découvrir toutes nos analysesPerspectives françaises et allemandes face aux défis géopolitiques dans le contexte de l’agression russe contre l’Ukraine
Les politiques étrangères, de défense et de sécurité de la France et l’Allemagne évoluent dans un contexte très tendu, marqué par le retour de conflits à haute intensité. Impensable au lendemain de la chute du Mur de Berlin qui symbolise la fin du conflit Est-Ouest, la guerre est aujourd’hui de retour en Europe, alors que les espaces terrestres et maritimes qui entourent le continent européen, de l’Arctique à l’Afrique en passant par le Moyen-Orient, sont devenus des théâtres de rivalité géopolitique, de guerres civiles et de conflits aussi bien hybrides que militaires.
La brigade franco-allemande et la relance de la défense européenne
Une chose est claire depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche : le projet d’unification européenne est menacé dans son existence même. À moins d’élaborer une politique de défense souveraine pour parer à la guerre en Ukraine et à l’affaiblissement des garanties de sécurité américaines, l’Union européenne verra se poursuivre l’érosion de sa dynamique de cohésion interne et de son attractivité externe.
Friedrich Merz et la Zeitenwende 2.0. Une « nouvelle ère » pour les relations transatlantiques ?
Le 23 février 2025, près de 60 millions d’électeurs ont été appelés à élire un nouveau Bundestag. Ces élections donneront également naissance à un nouveau gouvernement dans la première économie d’Europe.
Après les élections : l’Allemagne en quête d’une stabilité ébranlée ?
Avec 82,5 % de participation, l’Allemagne a enregistré un taux de mobilisation inédit depuis 1987, une hausse de 6,1 points par rapport à 2021. Comme en 2021, cette forte participation a profité à l’Alternative pour l’Allemagne (AfD), qui a su mobiliser un grand nombre d’anciens abstentionnistes.













