Angela Merkel, bilan d’une chancelière
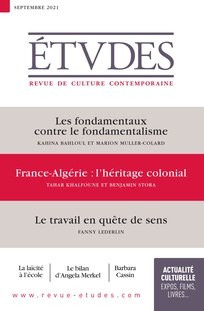
À l’issue de quatre mandats, Angela Merkel s’apprête à quitter son poste de chancelière fédérale d’Allemagne. Retracer son itinéraire permet de comprendre sa manière de faire. Elle s’est trouvée contrainte au compromis politique et son mode de gouvernement est marqué de pragmatisme. De fait, on ne compte que peu de grandes réformes à son actif. Sa seule décision forte, l’accueil des migrants en 2015, a eu des conséquences politiques problématiques. Elle aura assuré la stabilité du pays, mais sa succession est délicate.

À soixante-sept ans, après seize années à la tête de l’Allemagne, Angela Merkel s’apprête à quitter le pouvoir cet automne. Alors qu’elle bénéficie d’une cote de popularité à faire pâlir de jalousie la plupart des dirigeants européens, notamment depuis la première vague de la pandémie de Covid-19, elle a clairement affirmé qu’elle ne sera pas candidate à sa succession après les élections fédérales du 26 septembre 2021. Même Helmut Kohl (1930-2017), le chancelier de la réunification, n’avait pas pu bénéficier d’une position aussi incontestée que celle d’Angela Merkel pendant presque toute la période de ses mandats de chancelière. À la différence de sa successeuse, il avait été battu lors des élections fédérales de 1998. Angela Merkel quitte donc le pouvoir sur une décision réfléchie et non sur un échec : de toute l’histoire de la République fédérale d’Allemagne depuis 1949, jamais un chancelier allemand en exercice n’avait renoncé à être à nouveau candidat à sa succession.
Durant ses quatre mandats successifs, elle a durablement marqué la vie politique au niveau national, aussi bien qu’européen et international. L’Allemagne, en crise au début des années 2000, s’est affirmée depuis lors comme puissance économique et commerciale mondiale. Alors qu’on la considère souvent comme une « Européenne de raison », Angela Merkel a su faire des pas importants en direction de l’Union européenne, comme la récente initiative franco-allemande pour le plan de relance européen. Par ailleurs, dans cette Allemagne qui change, elle a porté des réformes sociétales, parfois du bout des lèvres, mais qui sont généralement mises à son crédit. Cette chrétienne-démocrate de la CDU (Christlich Demokratische Union), souvent considérée comme pragmatique ou « OVNI politique », a pratiqué une approche du pouvoir conçue comme l’art de l’accommodement et des compromis. Mais elle a dû faire face aussi à des années difficiles, marquées par des défis importants. De plus, même si sa politique étrangère montre qu’elle a souhaité que l’Allemagne assume davantage de responsabilités, elle a eu tendance à rester en retrait sur la scène internationale. Ces paradoxes d’Angela Merkel peuvent nous faire nous interroger sur son héritage politique à l’approche des élections : que restera-t-il des seize années de gouvernement de la première femme chancelière ? Comment cet héritage pourra-t-il être assumé par son successeur ou sa successeuse ? En quoi cet héritage influencera-t-il la place et le rôle de l’Allemagne en Europe et dans le monde ?
Paul Maurice est chercheur au Comité d’études des relations franco-allemandes (Cerfa) à l’Institut français des relations internationales (Ifri).
Cet article est paru dans la revue Études 2021/9 (Septembre), pages 7 à 18.

Contenu disponible en :
Régions et thématiques
Utilisation
Comment citer cette publicationPartager
Centres et programmes liés
Découvrez nos autres centres et programmes de rechercheEn savoir plus
Découvrir toutes nos analysesPerspectives françaises et allemandes face aux défis géopolitiques dans le contexte de l’agression russe contre l’Ukraine
Les politiques étrangères, de défense et de sécurité de la France et l’Allemagne évoluent dans un contexte très tendu, marqué par le retour de conflits à haute intensité. Impensable au lendemain de la chute du Mur de Berlin qui symbolise la fin du conflit Est-Ouest, la guerre est aujourd’hui de retour en Europe, alors que les espaces terrestres et maritimes qui entourent le continent européen, de l’Arctique à l’Afrique en passant par le Moyen-Orient, sont devenus des théâtres de rivalité géopolitique, de guerres civiles et de conflits aussi bien hybrides que militaires.
La brigade franco-allemande et la relance de la défense européenne
Une chose est claire depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche : le projet d’unification européenne est menacé dans son existence même. À moins d’élaborer une politique de défense souveraine pour parer à la guerre en Ukraine et à l’affaiblissement des garanties de sécurité américaines, l’Union européenne verra se poursuivre l’érosion de sa dynamique de cohésion interne et de son attractivité externe.
Friedrich Merz et la Zeitenwende 2.0. Une « nouvelle ère » pour les relations transatlantiques ?
Le 23 février 2025, près de 60 millions d’électeurs ont été appelés à élire un nouveau Bundestag. Ces élections donneront également naissance à un nouveau gouvernement dans la première économie d’Europe.
Après les élections : l’Allemagne en quête d’une stabilité ébranlée ?
Avec 82,5 % de participation, l’Allemagne a enregistré un taux de mobilisation inédit depuis 1987, une hausse de 6,1 points par rapport à 2021. Comme en 2021, cette forte participation a profité à l’Alternative pour l’Allemagne (AfD), qui a su mobiliser un grand nombre d’anciens abstentionnistes.













