Les mouvements environnementaux en République démocratique allemande - La naissance d’une écologie politique dans l’Allemagne communiste des années 1980
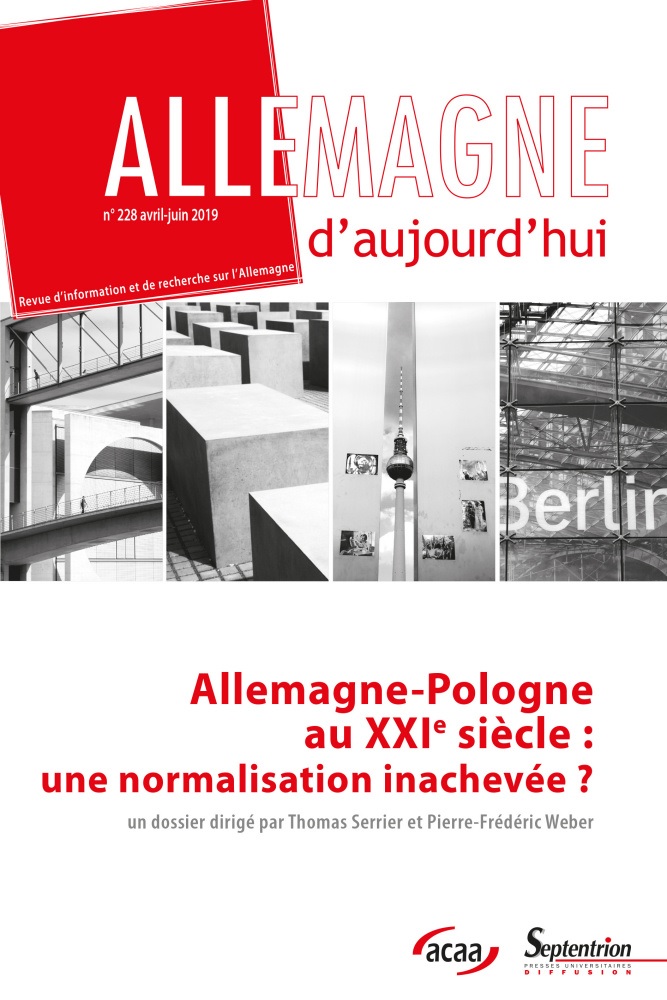
La République démocratique allemande (RDA) a été l’un des premiers pays en Europe à légiférer sur la question de la protection de l’environnement à la fin des années 1960. Cependant, moins de deux décennies plus tard, elle était considérée comme l’un des pays les plus pollués du continent.

Les questions écologiques rencontrèrent à partir des années 1980 l’intérêt croissant du grand public qui n’était plus disposé à accepter les dégradations environnementales en RDA. Bien qu’interdites, des associations de citoyens virent le jour en Allemagne de l’Est pour dénoncer les catastrophes écologiques passées sous silence par le régime. D’abord actives à l’échelle locale dans des initiatives ponctuelles et ciblées visant à informer la population, elles devinrent tout au long de la décennie 1980 plus politiques et leur champ d’action s’élargit à l’échelle nationale. Elles devinrent rapidement la cible d’une répression du parti, de l’État et de la Stasi et tentèrent de résister, en grande partie grâce à l’aide de l’Église évangélique luthérienne.
Les questions écologiques furent donc, dans une certaine mesure, le révélateur du fossé qui s’accrut tout au long des années 1980 entre les politiques étatiques et les attentes des populations, facteur indéniable de l’effondrement du régime dans les années 1989-1990.
La revue traite des grands problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels de l'Allemagne contemporaine sans négliger la dimension historique et la comparaison avec d'autres pays. Elle est aussi un forum franco-allemand. Elle s'adresse aux germanistes, historiens, politologues, économistes, étudiants comme enseignants, aux journalistes et aux décideurs politiques ainsi qu'au grand public intéressé par l'Allemagne.
Paul Maurice est chercheur au Comité d'études des relations franco-allemande (Cerfa) à l'Ifri.
Cet article est paru dans la revue Allemagne d'aujourd'hui, n° 228, avril-juin 2019 (page 144 à 159) intitulée "Allemagne-Pologne au XXIe siècle : une normalisation inachevée ?", co-dirigée par Thomas Serrier et Pierre-Frédéric Weber.

Contenu disponible en :
Régions et thématiques
ISBN / ISSN
Utilisation
Comment citer cette publicationPartager
Centres et programmes liés
Découvrez nos autres centres et programmes de rechercheEn savoir plus
Découvrir toutes nos analysesLa fabrique de la politique européenne de l’Allemagne
L’ambition européenne de Friedrich Merz est de faire de l’Allemagne, souvent perçue comme hésitante, un acteur de premier plan de l’Union européenne. À cette fin, le chancelier allemand a annoncé vouloir mettre un terme au « German vote ». Celui-ci incarne le paradoxe d’une Allemagne à la fois indispensable et fréquemment absente dans la décision européenne.

Sécuriser les chaînes de valeur des matières premières critiques (MPC) : une condition préalable à la résilience technologique de l'Europe
Au cœur de la sécurité économique, la résilience technologique est un pilier de la compétitivité de l'Union européenne (UE). Les transitions énergétique et numérique de l'UE dépendent des matières premières critiques (MPC).

Concilier compétitivité et évolution démographique : un impératif franco-allemand
La France et l'Allemagne sont confrontées à des changements démographiques parallèles qui pourraient remodeler l'avenir de leurs économies et de leurs modèles sociaux. Ces changements reflètent des tendances européennes plus larges, mais sont amplifiés par le rôle central que jouent ces deux nations dans la gouvernance et la compétitivité de l'Union européenne.
Imaginaires et réalités de la frontière franco-allemande : un laboratoire pour l’Europe de demain
En Europe, la question des frontières est loin d’être secondaire. Selon le Parlement européen, les régions frontalières couvrent environ 40 % du territoire de l’Union européenne (UE), concentrent 30 % de sa population et produisent près d’un tiers de son produit intérieur brut.











