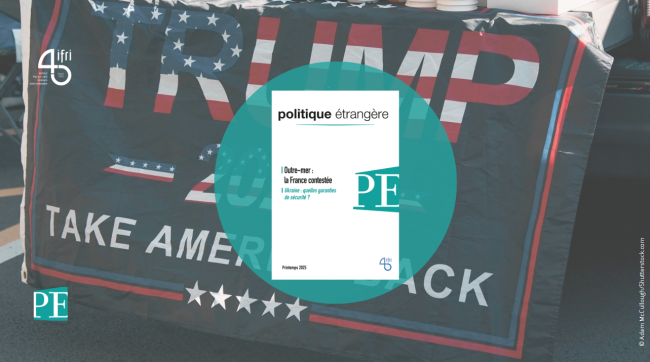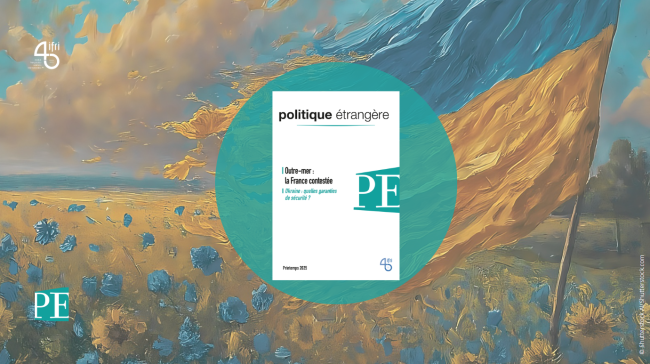L'Union européenne, la crise, l'euro – Au-delà des Etats : les nouveaux acteurs internationaux
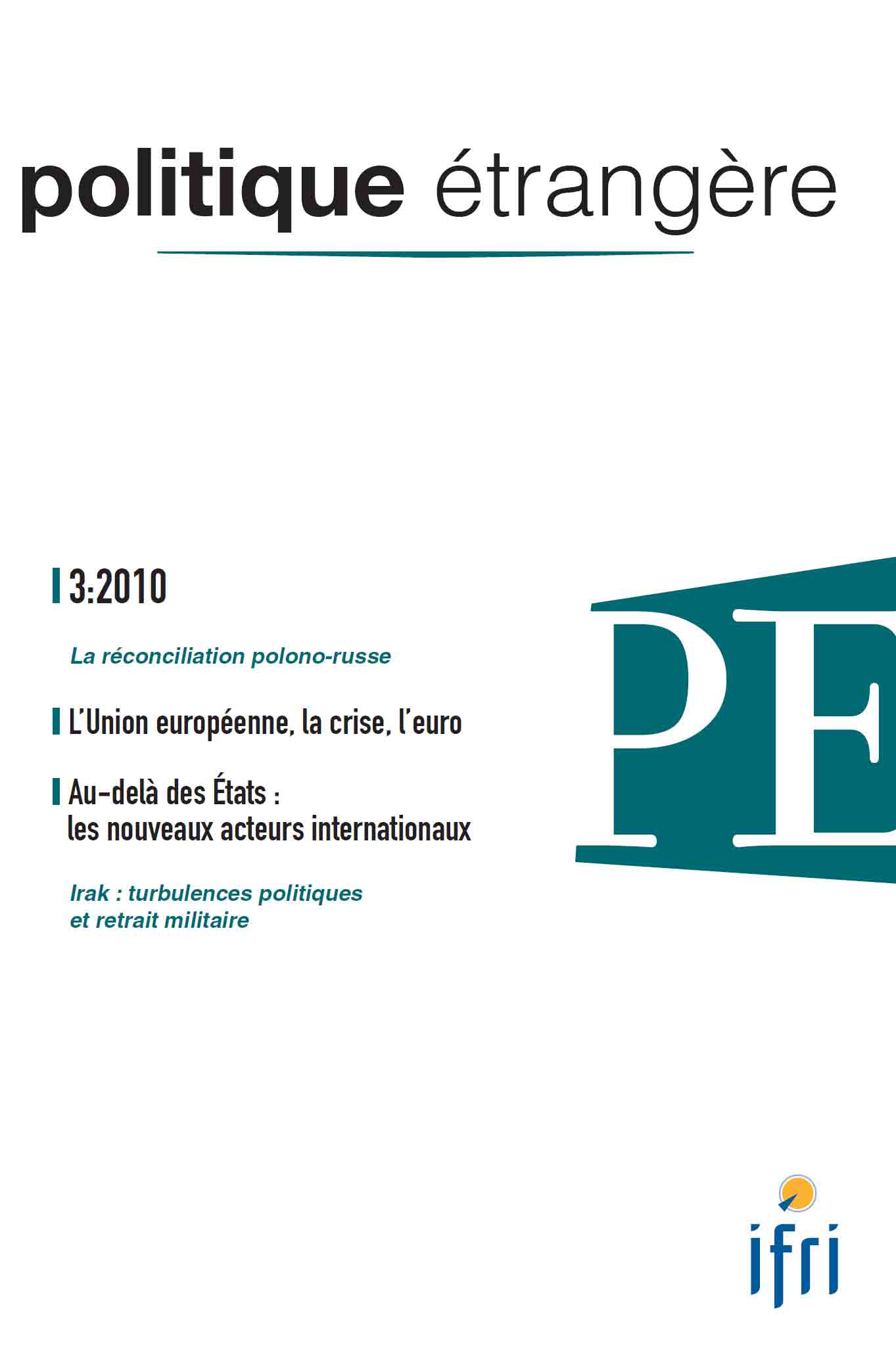
On trouvera dans ce numéro de quoi alimenter la réflexion sur trois lieux communs – parmi d’autres – qui comptent dans l’analyse contemporaine de la stabilité des sociétés, et donc de leurs relations internationales.
Le premier thème est celui des relations polono-russes. Les deux années 2009-2010 ont permis d’avancer à grands pas. Le second drame de Katyn a permis de couronner, peut-être pas définitivement mais de manière décisive, un processus resté peu visible aux yeux des sociétés, voisins et partenaires des deux pays – processus qui, devant être comparé par ses méthodes et ses résultats aux autres modèles de réconciliation politique des 20 dernières années, est crucial pour l’avenir des relations internationales en Europe. Sur ces retrouvailles russo-polonaises (qui pourront demeurer chaotiques encore un moment) peut s’édifier demain une nouvelle coopération continentale, de nouveaux liens entre l’Ouest européen et la Russie, enjeu essentiel de l’avenir du Vieux Continent.
Autre commonplace : la permanence, l’immuabilité du système politique britannique, de ses règles d’alternance bipartisane, non écrites mais réglées plus précisément que bien des dispositions constitutionnelles du continent. Après les élections de mai 2010, la question est bien : la longue négociation, les compromis qui ont préludé à la formation du gouvernement, resteront-ils comme un épisode erratique, ou comme l’ouverture d’une nouvelle logique ? et dans ce dernier cas, avec quel effet sur les mécanismes fondamentaux et réflexes qui gouvernent les choix du royaume, sur sa stabilité interne, sa politique étrangère, donc sa place dans le monde et ses relations avec les alliés ?
Troisième fausse évidence du temps : l’idée que les « guerres décomposées » de l’après-guerre froide seraient plus redoutables que les guerres « organisées » du temps clausewitzien, et que certains espaces, notamment l’Afrique – traversée de conflits d’autant plus sanglants que dépolitisés et dés-Étatisés –, en témoigneraient au premier chef. La comptabilité récupérée par la politique peut s’avérer redoutable ; et notre horreur exhibée ne justifier, au vrai, que notre sentiment d’impuissance ou notre soulagement à ranger le Continent noir dans un règne de sauvagerie « à part ». Les analyses ici publiées montrent que l’affaire n’est pas si simple : ni si inquiétante ni si rassurante...
***
Il est vrai que l’interrogation sur les formes et les acteurs des « nouvelles guerres » rejoint une analyse plus large sur les « nouvelles » relations internationales, censées être définies par la multiplication et la diversification des acteurs dues à la fin de la glaciation bipolaire. Nous consacrons un dossier entier à ces nouveaux acteurs, à leurs relations avec l’acteur-roi, la référence : l’État.
5Oui, les intérêts économiques transnationaux (sous leurs diverses formes : entreprises, agences, ententes, etc.) pèsent chaque jour davantage dans la mise au point des règles de plus en plus nombreuses exigées par la mondialisation : les États affectent ici de contrôler les processus de réglementation, sans toujours en préserver vraiment les moyens. Oui, les minorités issues de l’immigration en Europe occidentale jouent un rôle neuf, et de plus en plus présent, et complexe, dans les relations entre États. Ces derniers restent les maîtres du jeu mais sont contraints d’intégrer des mécanismes hier marginaux : revendications culturelles, constitution de groupes de pression transnationaux, organisations nationales de communautés, etc. Oui, les organisations non gouvernementales témoignent du développement de la catégorie « humanitaire » dans l’action diplomatique classique. Mais elles témoignent aussi de l’émergence d’un espace « diplomatique » particulier : elles articulent leur action à celle des diplomaties classiques, mais ont aussi pour effet de la modeler différemment – pour le meilleur ou pour le pire. […]
Licence d'abonnement numérique et pay per view : CAIRN

Contenu disponible en :
Régions et thématiques
ISBN / ISSN
Utilisation
Comment citer cette publicationPartager
Téléchargez l'analyse complète
Cette page ne contient qu'un résumé de notre travail. Si vous souhaitez avoir accès à toutes les informations de notre recherche sur le sujet, vous pouvez télécharger la version complète au format PDF.
L'Union européenne, la crise, l'euro – Au-delà des Etats : les nouveaux acteurs internationaux
En savoir plus
Découvrir toutes nos analysesKurdistan : l’indépendance en balance - Politique étrangère, vol. 82, n° 4, 2017
Depuis un siècle, les mouvements kurdes sont à la recherche des éléments constitutifs d’un État. Les Kurdes irakiens sont sans doute les plus avancés sur cette voie. Mais leur discours indépendantiste a connu plusieurs phases et des mutations considérables. Les conditions objectives, locales et internationales, sont aujourd’hui défavorables à l’indépendance du Kurdistan. La pan-kurdisme n’existe plus et l’indépendantisme kurde irakien aura du mal à se concrétiser en État.
L'impossible gestion de la diversité en Irak - Politique étrangère, vol. 87, n° 1, 2022
Éclaté entre logiques chiites, sunnites et kurdes, le système irakien ne peut trouver en soi la force de se réformer. Il fonctionne ainsi sous influences extérieures, des puissances globales (États-Unis) ou régionales (Iran, Turquie…). Les pays arabes, et particulièrement l'Arabie Saoudite, semblent vouloir renouer avec le pays ; et l'Union européenne développer une stratégie repensée. Ces parrainages pourraient favoriser un équilibre interne permettant à l'Irak d'éloigner le spectre de la guerre civile.
Trump 2 : les défis de la posture militaire américaine - Politique étrangère, n° 1, printemps 2025
La répartition des points d'appui opérationnels de la stratégie américaine a fortement évolué depuis deux décennies, avec une forte réduction. La prise de distance et les critiques répétées de Donald Trump vis-à-vis des alliances traditionnelles des États-Unis risquent de fragiliser l'ensemble de l'architecture de la présence américaine dans le monde, au-delà des impasses concrètes, réelles, en particulier industrielles, des dispositifs militaires de l'Amérique.
Ukraine : l'année de la paix incertaine - Politique étrangère, vol. 90, n° 1, printemps 2025
Lors de sa campagne électorale, Donald Trump a promis de régler la guerre en Ukraine en 24 heures. Alors que le président américain s'installe à la Maison-Blanche, différentes options se dessinent pour le futur de ce conflit. Certaines sont plus probables que d'autres, mais aucune ne peut être écartée. Les pays européens paraissent de plus en plus divisés à l'égard de la Russie, et l'Union européenne risque de payer le prix fort si elle ne parvient pas à faire émerger une stratégie commune solide.