L’Allemagne et le Partenariat oriental après la crise en Ukraine
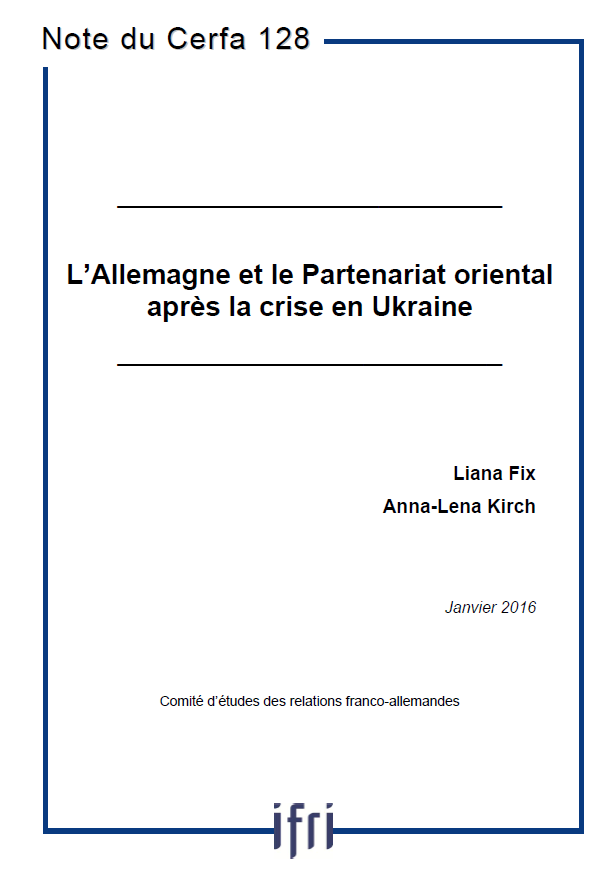
Le conflit en Ukraine et autour de ses enjeux a propulsé le Partenariat oriental (PO) de l’Union européenne sous les feux de la rampe de la scène internationale. Considérée dédaigneusement comme un instrument politique bureaucratique et technique, la Politique européenne de voisinage (PEV) et son volet régional couvrant l’Europe de l’Est au sens large, le Partenariat oriental, ont gagné en importance de façon tout à fait inattendue sur le plan géopolitique en l’espace de quelques mois.

Du même coup, l’Allemagne – pourtant réticente à se placer en première ligne de l’initiative du PO – s’est retrouvée au centre des efforts de gestion de crise déployés en Ukraine. Pourtant, la position générale de l’Allemagne vis-à-vis du PO n’en a pas été changée pour autant en ce qui concerne la perspective d’une possible adhésion à l’UE des pays les plus avancés. Pour l’Allemagne, le PO reste un outil d’Ordnungspolitik – dont l’objet est de ramener l’ordre dans la région – et non un instrument de pré-adhésion.
Le réexamen de la PEV 2015 reflète bien la position de l’Allemagne : il ne mentionne rien sur la possibilité d’une perspective d’adhésion et ne prévoit qu’un nombre limité de mesures incitatives supplémentaires pour les pays associés que sont l’Ukraine, la Géorgie et la Moldavie. Du point de vue de l’Allemagne, le soutien de l’UE doit se concentrer plus sur le renforcement de la conditionnalité pour éviter un recul dans les pays associés et moins sur de nouvelles incitations financières ou de nouvelles formes de coopération. Malgré le conflit qui secoue l’Ukraine, l’Allemagne reste convaincue que la stabilisation dans le voisinage ne peut être accomplie que grâce à la Russie, et non contre elle.
Il reste à savoir si cette approche suffit à mener le processus de transformation visé et à apporter la stabilité dans le voisinage dans le contexte d’une Russie qui prend de l’envergure. Pour les pays non associés (Arménie, Biélorussie et Azerbaïdjan), les aspirations de transformation de la PEV ont été abandonnées au profit d’une démarche plus pragmatique et transactionnelle : les coopérations différenciées offrent à ces pays un nouveau moyen de s’entendre avec l’UE au-delà des accords d’association ou des zones de libre-échange approfondi et complet. Au-delà de la gestion de crise, le défi que représente le cas ukrainien pour le leadership allemand reviendra à poser la question de savoir ce que l’Allemagne pourra faire de plus si Minsk II n’est pas mis en oeuvre et si le conflit dans l’est de l’Ukraine devient un conflit de plus dans la région, voué à durer et rester sans solution.
Liana Fix est membre du département de recherche Europe de l’Est et Eurasie de l’Institut allemand pour la politique internationale et la sécurité (SWP).
Anna-Lena Kirch est assistante de recherche au Programme Europe du German Marshall Fund of the United States (GMF).
Cette publication est également disponible en anglais ici.

Contenu disponible en :
Régions et thématiques
Utilisation
Comment citer cette publicationPartager
Téléchargez l'analyse complète
Cette page ne contient qu'un résumé de notre travail. Si vous souhaitez avoir accès à toutes les informations de notre recherche sur le sujet, vous pouvez télécharger la version complète au format PDF.
L’Allemagne et le Partenariat oriental après la crise en Ukraine
Centres et programmes liés
Découvrez nos autres centres et programmes de rechercheEn savoir plus
Découvrir toutes nos analysesPerspectives françaises et allemandes face aux défis géopolitiques dans le contexte de l’agression russe contre l’Ukraine
Les politiques étrangères, de défense et de sécurité de la France et l’Allemagne évoluent dans un contexte très tendu, marqué par le retour de conflits à haute intensité. Impensable au lendemain de la chute du Mur de Berlin qui symbolise la fin du conflit Est-Ouest, la guerre est aujourd’hui de retour en Europe, alors que les espaces terrestres et maritimes qui entourent le continent européen, de l’Arctique à l’Afrique en passant par le Moyen-Orient, sont devenus des théâtres de rivalité géopolitique, de guerres civiles et de conflits aussi bien hybrides que militaires.
La brigade franco-allemande et la relance de la défense européenne
Une chose est claire depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche : le projet d’unification européenne est menacé dans son existence même. À moins d’élaborer une politique de défense souveraine pour parer à la guerre en Ukraine et à l’affaiblissement des garanties de sécurité américaines, l’Union européenne verra se poursuivre l’érosion de sa dynamique de cohésion interne et de son attractivité externe.
Friedrich Merz et la Zeitenwende 2.0. Une « nouvelle ère » pour les relations transatlantiques ?
Le 23 février 2025, près de 60 millions d’électeurs ont été appelés à élire un nouveau Bundestag. Ces élections donneront également naissance à un nouveau gouvernement dans la première économie d’Europe.
Après les élections : l’Allemagne en quête d’une stabilité ébranlée ?
Avec 82,5 % de participation, l’Allemagne a enregistré un taux de mobilisation inédit depuis 1987, une hausse de 6,1 points par rapport à 2021. Comme en 2021, cette forte participation a profité à l’Alternative pour l’Allemagne (AfD), qui a su mobiliser un grand nombre d’anciens abstentionnistes.











