L'Europe et les réfugiés en 2015 : une crise de la mémoire ?
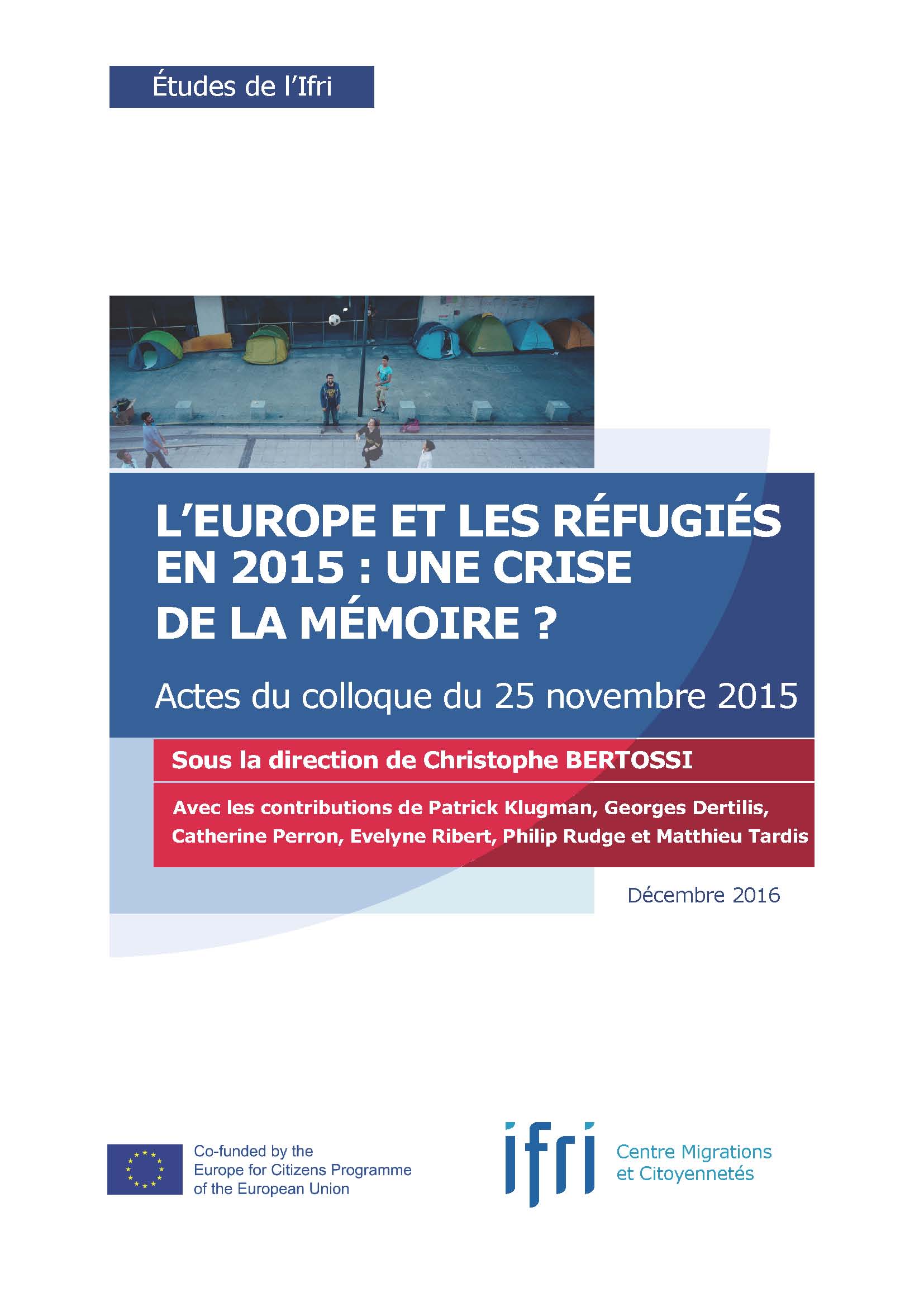
À la différence d’autres sociétés d’immigration comme les États-Unis, le Canada ou l’Australie, l’Europe n’a pas fait des migrations un élément central des récits au fondement de son identité commune. Chaque pays entretient ainsi un rapport particulier à son histoire migratoire et à la manière dont celle-ci est intégrée ou non au récit national. La question d'une mémoire européenne des migrations peine donc à être formulée.

L'accélération rapide des arrivées de réfugiés à partir du printemps 2015 et l'incapacité des gouvernements européens de se mettre d'accord sur une réponse commune constituent une nouvelle page de l'histoire migratoire de l'Europe. Cependant, la « crise des réfugiés » n’impose pas de débat sur la place de l’asile dans l’identité européenne. Pourtant, avec la Convention de Genève de 1951, le régime d’asile que le monde connaît aujourd’hui est né en Europe pour les réfugiés européens. L’Europe s’est construite à plusieurs reprises autour de cette question : réfugiés de l’après-guerre et de la guerre froide, boat-people et réfugiés sud-américains dans les années 1970, guerre dans les Balkans, etc. Si donc, par le passé, l’Europe s’est construite comme une terre d’asile, ce n’est pas comme telle que les Européens semblent l’envisager aujourd’hui.
C’est ce déficit de mémoire commune que la « crise des réfugiés » laisse voir également. C'est à cette question que cette étude est consacrée, à partir d'une comparaison des différents rapports à la mémoire de l'asile dans trois pays (Grèce, Allemagne et France) et d'une analyse de la relation entre les ONG et la mémoire de l'asile.
Ces textes sont issus d’un colloque intitulé « L’Europe et les réfugiés en 2015 : une crise de la mémoire ? » organisé par l’Ifri le 25 novembre 2015. Ce colloque s’inscrit dans le cadre du projet « mémoires et migrations en Europe » conduit par l’Ifri, en partenariat avec l’université d’Amsterdam, l’université de Warwick, la Fondation Calouste Gulbenkian et le Réseau français des instituts d’études avancés, avec le soutien du programme l’« Europe pour les citoyens » de l’Union européenne.

Contenu disponible en :
Régions et thématiques
Utilisation
Comment citer cette publicationPartager
Téléchargez l'analyse complète
Cette page ne contient qu'un résumé de notre travail. Si vous souhaitez avoir accès à toutes les informations de notre recherche sur le sujet, vous pouvez télécharger la version complète au format PDF.
L'Europe et les réfugiés en 2015 : une crise de la mémoire ?
Centres et programmes liés
Découvrez nos autres centres et programmes de rechercheEn savoir plus
Découvrir toutes nos analysesJapon : le raz-de-marée Takaichi et le nouveau visage du pouvoir
La Première ministre Sanae Takaichi a transformé sa popularité exceptionnelle en une victoire politique historique. Les élections anticipées du 8 février ont offert au Parti libéral démocrate (PLD) une majorité écrasante, grâce au soutien massif de jeunes électeurs séduits par son image iconoclaste et dynamique, et des conservateurs rassurés par sa vision d’affirmation nationale. Cette popularité pose les bases d’une stratégie ambitieuse tant sur le plan intérieur que sur le plan international.
Élections en Thaïlande : les conservateurs consolident leur ancrage
À rebours des sondages, le parti conservateur pro-business Bhumjaithai a dominé les élections législatives anticipées du 8 février 2026 et s’est imposé à la Chambre basse avec 193 sièges sur 500, enregistrant une progression record par rapport aux 71 députés élus en 2023.
Crise politique en Thaïlande : la tactique du chaos
La Thaïlande a replongé à l’été 2025 dans une crise politique profonde. La suspension de la Première ministre, Paetongtarn Shinawatra, par la Cour constitutionnelle a provoqué l’implosion de la coalition au pouvoir. Cette crise ressemble pourtant aux précédentes. Une banalité répétitive qui interroge à la fois le sens des responsabilités des principaux dirigeants et qui génère au sein de la population un cynisme mâtiné de résignation.

Ouverture du G7 à la Corée du Sud : relever les défis mondiaux contemporains
L'influence mondiale du G7 s'est affaiblie à mesure que des puissances telles que la Chine remodèlent la gouvernance internationale à travers des initiatives telles que les BRICS et l'Organisation de Coopération de Shanghai (OCS). Le G7 ne représentant plus aujourd'hui que 10 % de la population mondiale et 28 % du PIB mondial, sa pertinence est de plus en plus remise en question.















