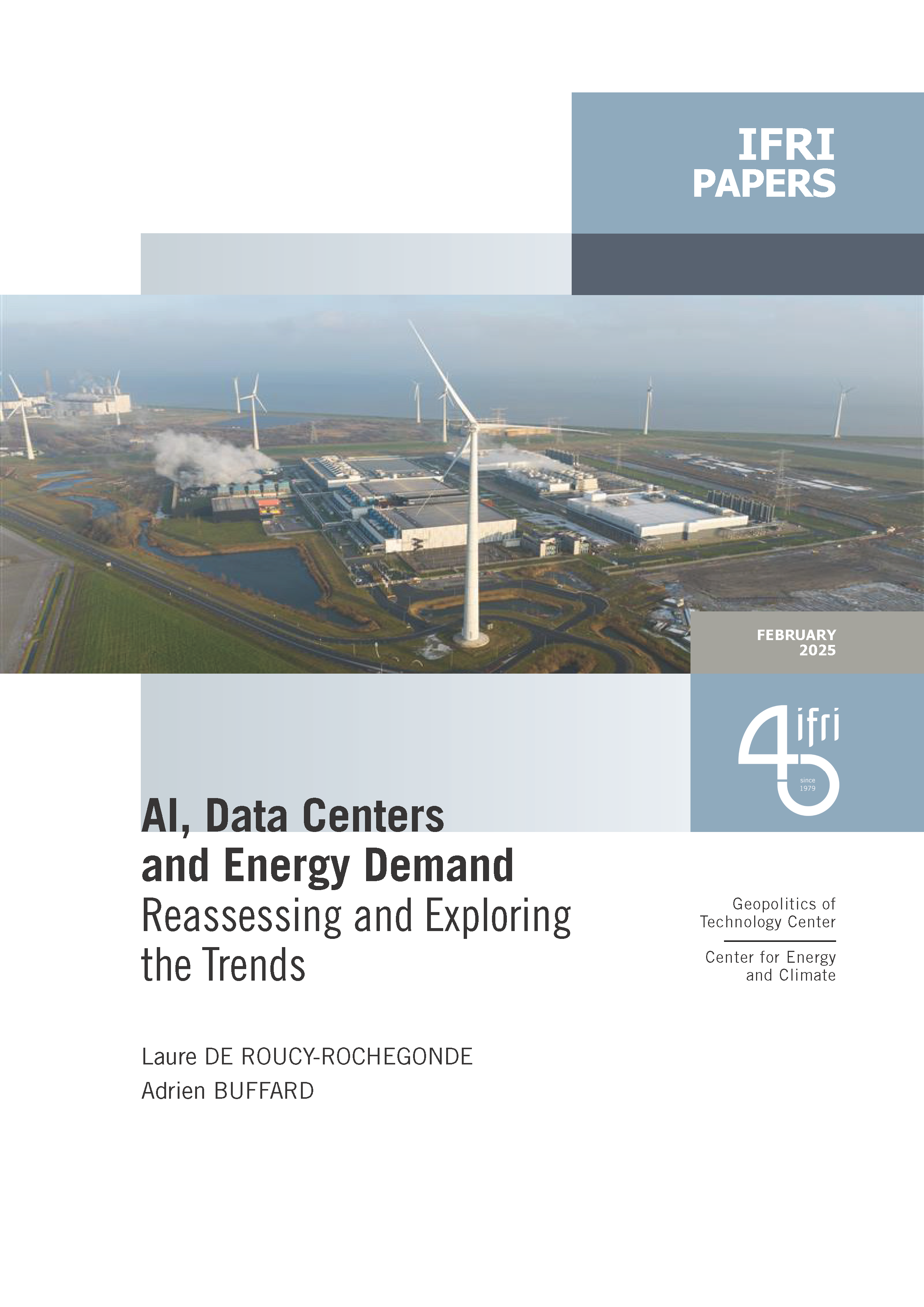The Skeptical Environnementalist: Measuring the Real State of the World
(This book review is published in French only)
Pour qui s’intéresse à ce que devient notre planète mais s’irrite du ton apocalyptique et des procédés cavaliers avec lesquels des personnages phares de la nébuleuse écologiste internationale se saisissent de faits, de données et d’éléments scientifiques de valeur très inégale pour concocter les 'vérités' qu’ils assènent à la face du monde, la lecture du livre de Bjorn Lomborg suscitera des moments de pure réjouissance, comme chaque fois que la légèreté est dévoilée, et l’imposture démasquée. S’il écoute sa première impression, ce lecteur aura alors envie d’applaudir ce nouveau Tintin au pays de l’écologie, ferraillant avec courage, intelligence et ingénuité contre les 'méchants' auxquels il reproche de vendre leurs projets idéologiques sous couvert de science. Au premier rang d’entre eux, il y a le Worldwatch Institute, le World Wildlife Fund (WWF), l’écologue radical Paul Ehrlich, mais aussi, de façon beaucoup plus intrigante, l’IPCC (Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution des climats [GIEC]), cette instance d’expertise scientifique mondiale dont les rapports forment, depuis 1990, le soubassement scientifique de l’action internationale en ce domaine.
Mais, si ce lecteur est un peu informé et qu’il commence à réfléchir sur ce qui lui est servi, il se laissera gagner par un autre sentiment, celui d’être l’objet d’une manipulation que dissimule le sourire juvénile et éclatant de l’auteur en quatrième de couverture. Comme un vin qui laisserait l’amertume en bouche une fois dissipée la joie capiteuse de l’instant, le livre de B. Lomborg distille un breuvage insidieux au goût nettement moins plaisant. Nous n’avons pas affaire à Tintin mais, comme dans le film Mission impossible, à un personnage qui en prend le masque.
D’où notre auteur tire-t-il son autorité à jouer les redresseurs de torts? Il n’est pas écologue ni climatologue. Il n’est pas plus économiste que biologiste ou physicien. Qu’est-il donc alors? Il se prétend écologiste, mais il est bien le seul à le penser dans son pays. Il enseigne la statistique dans un département de sciences politiques à l’Université d’Aarhus, au Danemark. Ainsi armé, il s’en va visiter toutes les grandes questions contemporaines suscitées par le devenir de l’environnement planétaire et portées comme emblèmes par le mouvement écologiste: épuisement des ressources naturelles, menaces d’insuffisance de la production alimentaire, disparition des forêts, érosion catastrophique de la biodiversité, bouleversement du climat de la planète, risques chimiques, etc.
Il en revient avec un gros livre bourré de chiffres, de notes et de références à la littérature publiée. Un travail d’apparence titanesque que l’auteur a pu réaliser en s’appuyant sur les travaux confiés à ses étudiants et sur quelques ouvrages qui l’ont beaucoup inspiré, comme le livre de R. Bailey, The True State of The Planet. Il en revient surtout avec un message simple: en dépit de ce que proclame la 'litanie', l’état du monde s’améliore sur à peu près tous les indicateurs; les problèmes montés en épingle le sont excessivement et abusivement, y compris ceux qui semblent le mieux établis en haut de l’échelle des préoccupations communes pour l’avenir de la planète, comme l’érosion de la biodiversité et le changement du climat. Il en revient aussi avec des recommandations tranchées, comme l’abandon pur et simple du fameux protocole de Kyoto auquel les Européens s’accrochent malgré la défection des Etats-Unis. Ainsi, à en croire B. Lomborg, il faudrait l’abandonner purement et simplement car mieux vaudrait se soucier d’améliorer concrètement et immédiatement le sort des populations les plus démunies des pays du Tiers-Monde (accès à l’eau, à l’énergie et aux soins) que de s’imposer des restrictions très coûteuses et totalement inefficaces: l’extension pour toujours des engagements pris à Kyoto par les pays industriels coûterait, nous dit-il, 2% du PNB annuel de ces pays aux alentours de 2050 et n’aurait d’autre effet que de repousser à l’année 2106 ce qui se passerait sans Kyoto en 2100? Ce à quoi on pourrait lui répondre: qu’y a t-il de dramatique sur le plan économique à ce que la population des pays industriels ne connaisse qu’en 2101 avec Kyoto le niveau de richesse économique qu’ils auraient en 2100 sans Kyoto? Autant dire que cela n’a guère de sens de faire des effets de manche avec des milliards de dollars brassés un siècle à l’avance.
Face à la bonne nouvelle d’une amélioration générale de l’état du monde, on se sent tout ragaillardi, et C. Allègre n’a pas voulu garder l’information pour lui. Reprenant les affirmations de B. Lomborg, il annonce: 'Aujourd’hui, si les Etats-Unis et les autres pays industrialisés appliquaient le protocole de Kyoto […], il en coûterait 1000 milliards de dollars. Pour ce prix, on fera peut-être baisser la température moyenne du globe de 0,15°C en 2100! Avec la même somme, on pourrait fournir de l’eau potable en quantité au monde entier et sauver 2 millions de personnes par an! Kyoto est-il vraiment nécessaire? En fait, ce n’est pas la science sans conscience qui est préoccupante aujourd’hui, c’est la conscience sans la science! C’est le manque de vision, de lucidité, de savoirs et de courage des politiques!' Sic. Cette nouvelle prise de position de notre héros national devrait conduire le lecteur de B. Lomborg à s’intéresser de plus près à la solidité de l’argumentation du faux Tintin danois.
Il faut d’abord reconnaître que c’est du bel ouvrage et qu’à plusieurs reprises notre auteur fait mouche. Les deux plus beaux exemples du travail de déconstruction qu’il nous offre touchent à la biodiversité et au risque biologique sur la fertilité masculine attribué à la pollution chimique. La biodiversité d’abord. Le chiffre le plus couramment cité quant au taux de disparition des espèces naturelles sous l’influence humaine est celui, catastrophique, d’une disparition de 40000 espèces par an. D’où vient-il? Le chiffre trouve son origine dans une spéculation à caractère circulaire de N. Myers, dans un livre publié en 1979: si un million d’espèces disparaissaient du fait de l’homme en 25 ans, cela ferait 40000 par an. Le raisonnement sous-jacent concernait la forêt tropicale: la destruction de plus de 50% de la forêt primitive pourrait faire disparaître un tiers des espèces puisque cette forêt est le principal siège de la diversité biologique. Or les recherches empiriques ne confirment ni une destruction aussi massive de la forêt tropicale, ni l’existence d’un phénomène de disparition rapide et massif des espèces, comme le reconnaît d’ailleurs l’Union internationale pour la conservation de la nature. Par différents recoupements, B. Lomborg aboutit à un taux de disparition de 0,7% pour les 50 ans à venir, soit quand même un taux 1500 fois plus élevé que le taux naturel moyen. Mais, avec un tel chiffre, il est erroné de poser le problème en termes de catastrophe pour la biosphère ou de survie pour l’espèce humaine.
Le second exemple concerne les menaces que la dissémination de DDT, de PCB et autres ferait peser, une fois disséminés dans l’environnement, sur la constitution sexuelle de la population humaine. Ces substances agiraient comme des œstrogènes et viendraient troubler la biologie de la sexualité animale et humaine. S’agissant de l’homme, l’inquiétude initiale a été amorcée par des études mettant en évidence une baisse de densité du sperme (de près de la moitié en 50 ans, d’après une étude danoise). Les produits chimiques et œstrogènes de synthèse ont été cités comme l’un des facteurs explicatifs possibles, au côté du changement dans les modes de vie et d’alimentation. Et c’est l’explication que les médias ont montée en épingle. Mais le fait de base est-il avéré? Il dépend de l’établissement et de la comparaison de données temporelles. Or il y a un biais: 84% des échantillons des études antérieures à 1970 proviennent des Etats-Unis; et ceux des quatre premières études à grande échelle couvrant la période 1938-1951 viennent d’une seule ville: New York. Or New York est une des villes au monde où la densité du sperme est la plus élevée. Pour les données visant les périodes postérieures à 1970, seuls 7% des échantillons proviennent de la ville de New York. Quand on corrige ce biais statistique, il n’est plus possible de faire apparaître une quelconque baisse de la qualité du sperme! Par ailleurs, on sait que la densité du sperme dépend de la fréquence des éjaculations. La durée des périodes d’abstinence entre deux éjaculations est donc une variable clé à considérer. Or, différentes enquêtes sur les pratiques sexuelles suggèrent un accroissement significatif (un quasi doublement) du taux d’activité entre les années 1940 et les années 1970 dans un pays comme la Suède… En combinant les deux éléments, le fait de l’effondrement de la qualité du sperme s’évanouit. Il n’y avait là qu’un artefact statistique.
Si tout était du même acabit chez B. Lomborg, il n’y aurait guère de réserve à formuler. Tel n’est cependant pas le cas. Le sous-titre du livre proclame l’ambition affichée par l’auteur: mesurer l’état du monde. Mais il ne se contente pas de cela. Sa thèse sur l’amélioration générale de la situation du monde et le renoncement aux actions lourdes de prévention, par exemple dans le domaine du risque climatique, ne peut se déduire des chiffres sur l’état présent du monde, même une fois redressés. Sous l’habillage d’une présentation objective des faits, Lomborg nous assène sa propre vision du futur: tout ce dont il nous dit que cela se produira ou que cela est très vraisemblable –likely est un mot qui revient sans cesse– contre des futurs autres, moins réjouissants, mais aussi ses modes de raisonnements et ses jugements normatifs, qui mobilisent généralement l’économisme le plus simplet. En outre, pour convaincre le lecteur qu’il y a mieux à faire que de bâtir une gouvernance mondiale de l’environnement planétaire puisque à ses yeux la situation s’améliore toute seule, l’auteur utilise de façon systématique un ensemble de procédés rhétoriques.
Parmi ces procédés, il y en a deux qui méritent qu’on s’y attarde. Le premier consiste à considérer qu’un problème donné n’existe pas puisque les générations futures qui y seront confrontées feront le nécessaire pour le résoudre et s’y adapter. Il en va ainsi des catastrophes naturelles (inondations, ouragans, etc.) ou de l’expansion géographique de vecteurs de maladies jusqu’alors confinées par le climat à certaines zones du globe. Des générations futures plus riches que nous auront tous les moyens de s’en prémunir. Il en va également ainsi des émissions de CO2. Pourquoi s’en préoccuper aujourd’hui, nous dit l’auteur, puisqu’il est plus que vraisemblable que l’énergie solaire va prendre le relais aux alentours de 2050? Ce faisant, il ne nous dit rien –hormis qu’il faut renforcer les programmes de recherche– des conditions économiques, techniques et institutionnelles qui rendraient effective l’évolution qu’il pose comme déjà là, alors qu’elle n’est qu’un scénario parmi d’autres, et pas du tout le plus vraisemblable, dont la survenue dépendra précisément des orientations et décisions qui seront prises par nos sociétés, non en 2050, mais aujourd’hui et dans les vingt ans à venir.
Le second procédé consiste à récuser une action déterminée parce qu’on pourrait faire un autre usage des mêmes ressources –concept classique et légitime de coût d’opportunité–, sans se demander si cette option alternative est concrètement possible ou si elle ne sert qu’à éliminer l’action réellement envisagée. Ainsi, plutôt que de s’infliger des coûts élevés de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui profiteront principalement, selon B. Lomborg, aux populations des pays en développement dans un siècle, mieux vaudrait investir les mêmes sommes dans la fourniture d’eau potable, d’énergie et de soins médicaux aux populations de ces pays : il faut donc abandonner Kyoto. Au-delà de l’argument du coût, Kyoto n’aurait de sens que comme premier pas dans l’établissement d’un régime international associant les pays en développement, qui vont rapidement constituer la principale source d’émission au monde. Or cela n’est pas possible, dit-il, pour deux raisons: d’une part ces pays, dont il écrit pourtant qu’ils seront les principaux bénéficiaires des actions de réduction des émissions, ne voudront jamais prendre un tel engagement; d’autre part, un accord global impliquerait des transferts financiers Nord-Sud tellement importants que cette solution est politiquement infaisable. Mais alors, l’idée d’investir les mêmes sommes dans l’équipement de base de ces pays en services aux populations démunies ne l’est pas non plus ! Elle n’a été employée que pour mieux écarter l’amorce d’une action internationale responsable vis-à-vis de l’enjeu climatique. Finalement, cette action est déclarée impossible et non souhaitable tout simplement parce que certains acteurs politiques que B. Lomborg représente ne la veulent pas. Etrange façon de rabattre le possible et le souhaitable sur le bon vouloir de quelques-uns.
Mais B. Lomborg utilise d’autres procédés. Il assimile abusivement, dans une même réprobation, des propos de militants individuels, fussent-ils aussi chercheurs, et des rapports collectifs d’instances scientifiques qui, eux, sont passés par un ensemble de débats et de relectures critiques, faites par de nombreux collègues aux opinions et aux origines géographiques variées. Il s’en prend ainsi à l’IPCC qui, selon lui, aurait abandonné la science pour se mettre au service d’un projet politique, oubliant que les rapports de l’IPCC, rédigés sous l’autorité de scientifiques, doivent être approuvés par des représentants de tous les pays du monde, y compris des Etats-Unis et de l’Arabie Saoudite; mais il cite à titre de preuve, lorsqu’il en ressent le besoin, des articles ou d’autres publications qui ne sont pas des textes officiels de l’IPCC. Il décerne des brevets de grandeur scientifique à tel ou tel chercheur qui a un avis qui lui plaît. Il trie avec attention les éléments de discussion introduits en ne retenant que ceux qui vont dans le sens de sa thèse ou disqualifie rapidement les autres. Ainsi, s’agissant d’apprécier la gravité possible des problèmes climatiques, il ne retient que les éléments en discussion qui pourraient jouer un rôle atténuateur. Il ne dit mot des hypothèses concernant les facteurs possibles d’aggravation ou les déclare invraisemblables tout en n’hésitant pas à déclarer vraisemblables les éléments potentiellement atténuateurs, scientifiquement incertains, qu’il met en avant. En matière économique, c’est l’inverse: il choisit de retenir les références soutenant l’idée que les politiques de réduction des émissions seront très coûteuses, et il récuse celles qui soutiennent l’idée inverse: existence de mesures dites 'sans regret'; possibilité de stratégies dites de 'double dividende' combinant, à partir d’une taxation des gaz à effet de serre ou d’une vente de permis d’émission, l’incitation à la maîtrise des émissions; nettoyage de la fiscalité générale dans un sens moins distorsif pour l’activité économique et l’emploi. C’est dire que B. Lomborg fait un usage opportuniste de la littérature scientifique disponible au service de la thèse qui est la sienne.
En outre, il ignore, quand cela l’arrange, des débats-clefs dont il est rendu compte dans les rapports de l’IPCC, comme par exemple celui sur la structure du problème de décision auquel la communauté internationale est confrontée avec la question du changement climatique: compte tenu des incertitudes nombreuses, certaines scientifiques et d’autres pas, qui entourent l’exercice de prospective du climat, les experts de l’IPCC tiennent dans leur rapport de 1995 pour illusoire de prétendre évaluer et optimiser une fois pour toutes le choix d’une trajectoire d’émission de gaz à effet de serre pour un siècle ou plus. Ils invitent les responsables à adopter une approche séquentielle des décisions à prendre: l’action à long terme doit être conçue comme une suite d’engagements limités dans le temps, destinés à être révisés et complétés, et capables de faire face aux surprises à venir; dans cet esprit, les décisions devront être périodiquement ajustées en fonction des informations et des possibilités nouvelles qui se présenteront à la suite des actions initiales et du progrès des connaissances. C’est ainsi que les responsables actuels de la communauté internationale ont à s’accorder sur une stratégie de précaution pour les 25 prochaines années, mais pas à choisir la stratégie optimale pour les 150 ans à venir. Or B. Lomborg s’en tient à la vision classique, mais irréelle, de la recherche d’une trajectoire optimale d’émission qui requiert une connaissance assurée des coûts et des avantages d’un réchauffement de la planète. Il reprend à son compte sans discussion les résultats de W. Nordhaus qui identifient comme optimale une trajectoire qui ne s’écarte que légèrement d’un scénario de laisser-faire et dont la réalisation suppose qu’on taxe initialement le carbone à 7,5 dollars seulement, pour l’accroître légèrement par la suite. Que cette évaluation soit contestée par de nombreux pairs, qu’en particulier elle ignore l’incertitude attachée aux phénomènes climatiques, aux surprises que ces derniers peuvent réserver, et aux perspectives de croissance à long terme; qu’en conséquence elle repose sur un taux d’actualisation trop élevé; qu’elle compte pour peu les dommages non marchands aux actifs naturels, tout ceci n’est pas mentionné. B. Lomborg en a décidé: la trajectoire proposée par Nordhaus est la trajectoire optimale.
Finalement, le livre de B. Lomborg soulève le problème de l’organisation de la transmission de l’information et du débat entre les scientifiques et la société. Son livre a eu un grand retentissement commercial. Il est mobilisé par tous ceux qui, pour diverses raisons, souhaitent ne rien changer à l’évolution du cours du monde et qui, pour la plupart, n’ont pas pris connaissance des travaux auxquels il s’en prend. Qui aura lu les rapports de l’IPCC qu’il critique? Les lecteurs français savent-ils que la contribution du groupe III aux aspects socioéconomiques des rapports de 1995 a été traduite en français et que beaucoup des points soulevés par B. Lomborg y sont abordés de façon documentée et discutés de façon précise? Ce qui fait la valeur scientifique d’un état des savoirs résulte du travail collectif de discussion et de critique, de la confrontation organisée de différentes sources et de différents modèles. Il en résulte une exigence majeure pour la manière de recevoir différents types d’écrits: le crédit à accorder à l’ouvrage d’un auteur seul, quels que soient sont talent et les plumes dont il peut se parer, est infiniment plus faible que celui qui mérite d’être accordé à des travaux collectifs rigoureusement organisés, comme c’est le cas, à l’échelle internationale, des travaux de l’IPCC pour le problème du changement climatique. Ce que met à jour le livre de Lomborg, c’est le besoin urgent de mettre sur pied des équivalents de l’IPCC pour les autres champs de problèmes dont est saisie la communauté internationale.